Déclaration d’achèvement & « modificatif balai » : jusqu’à quand peut-on légalement obtenir cette autorisation ?

La circonstance qu’un permis de construire modificatif ait été obtenu après la formulation de la déclaration d’achèvement n’a aucune incidence sur la légalité de cette autorisation dès lors que la conformité des travaux n’a pas été actée.
CAA. Nancy, 21 janvier 2011, M A…, req. n°09NC01896
Voici, un arrêt qui appelle peu de commentaires mais dont la solution, et surtout sa clarté et son absence d’ambiguïté, sont les bienvenus.
 Comme on le sait, en effet, la problématique de l’articulation du régime du permis de construire modificatif avec le régime applicable aux travaux sur existants n’est pas une question anodine puisqu’elle implique d’apprécier le moment à partir duquel la construction initialement autorisée peut être considérée comme achevée. En effet, tant que les travaux se rapportant à la construction objet du permis de construire initial ne sont pas achevés, toute modification de cette dernière ou toute adjonction d’un ouvrage attenant ou structurellement lié à celle-ci implique à toute le moins un « modificatif » ; y compris si pris isolément les travaux projetés relèvent du champ d’application de la déclaration préalable, voire sont dispensés de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme .
Comme on le sait, en effet, la problématique de l’articulation du régime du permis de construire modificatif avec le régime applicable aux travaux sur existants n’est pas une question anodine puisqu’elle implique d’apprécier le moment à partir duquel la construction initialement autorisée peut être considérée comme achevée. En effet, tant que les travaux se rapportant à la construction objet du permis de construire initial ne sont pas achevés, toute modification de cette dernière ou toute adjonction d’un ouvrage attenant ou structurellement lié à celle-ci implique à toute le moins un « modificatif » ; y compris si pris isolément les travaux projetés relèvent du champ d’application de la déclaration préalable, voire sont dispensés de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme .
En revanche, et a contrario, dès lors que la construction initialement autorisée est achevée, les travaux projetés sur celle-ci ne peuvent plus relever d’un « modificatif ». Il convient ainsi de la apprécier isolément au regard du régime des travaux sur existants résultant des articles R.421-13 et suivants du Code de l’urbanisme pour déterminer s’ils sont dispensés de toute formalité, impliquent la formulation d’une déclaration préalable ou exigent un nouveau permis de construire.
Mais en toute hypothèse, il convient donc de déterminer à partir de quand l’ouvrage peut-être considéré comme achevé au regard du droit du permis de construire.
C’est à cette question que répond clairement l’arrêté commenté.
Dans cette affaire, la partie défenderesse avait obtenu un permis de construire qu’elle exécuta avant de formuler une déclaration d’achèvement.
Toutefois, dans la mesure où les travaux réalisés n’étaient pas strictement conformes à ceux autorisés, le pétitionnaire formula une demande de « modificatif » ; aux fins de régulariser ces travaux, autorisation lui fut délivrée après la formulation de la déclaration d’achèvement.
Or, ce « modificatif » devait être contesté notamment sur le moyen tiré de sa prétendue illégalité résultant de sa délivrance postérieure à la déclaration d’achèvement précédemment formulée. Mais ce moyen devait être rejeté par le Tribunal administratif de Besançon puis par la Cour administrative de Nancy et ce, aux termes d’un considérant on ne peut plus clair :
« Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance qu'une déclaration d'achèvement des travaux a été adressée par le pétitionnaire, M. B, à la ville de Montbéliard, le 6 octobre 2007, ne fait pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire modificatif dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un certificat de conformité ait été délivré ou que le permis de construire initial soit devenu périmé du fait de l'interruption des travaux pendant un délai supérieur à une année ».
Une telle solution est difficilement contestable ; si ce n’est qu’une déclaration d’achèvement formulée le 6 octobre 2007 n’avait pas vocation à aboutir à un certificat de conformité…
A l’instar de l’ancien article R.460-1 du Code de l’urbanisme, l’actuel article R.460-2 prévoit en effet la formulation d’une déclaration spécifiquement instaurée aux fins d’acter de l’achèvement des travaux précédemment engagés, laquelle est principalement destinée à déclencher les opérations de contrôle portant sur la conformité des travaux réalisés.
Pour autant, cette déclaration ne suffit pas à établir l’achèvement de l’ouvrage réalisé. En effet, si les ouvrages illégaux ne sauraient valablement faire l’objet d’une déclaration d’achèvement de travaux, ne serait-ce que dans la mesure où l’article R.462-1. prévoit que cette déclaration « est signée par le bénéficiaire du permis de construire » – ce qui implique qu’il y’en ait un (en ce sens : CAA. Bordeaux, 9 mars 2006, M. Vivien X., req. n°02BX02177) – la formulation de cette déclaration ou son absence n’a à elle seule aucune incidence sur l’appréciation de l’état d’achèvement des constructions régulièrement autorisées ou, plus précisément, ne constitue par principe qu’un simple indice ou, dans certains cas, une simple présomption.
Il ressort en effet de la jurisprudence tant judiciaire qu’administrative que l’absence de déclaration d’achèvement ne s’oppose pas à ce que l’ouvrage soit considéré comme achevé et le cas échéant conforme au permis de construire ou, a contrario, inachevé malgré la formulation d’une telle déclaration (Cass.civ., 11 mai 2000, Mme Duguet, Bull. civ., III, p.107 ; CAA. Versailles, 21 avril 2005, René Cazals, req. n°02VE03315 ; CE. 30 janvier 1995, M. et Mme Lambourdière, req. n° 138907 ; CE. 18 janvier 1980, Boussard, req. n°12651 ; CE. 14 janvier 1983, M.Y, req. n°26022).
L’appréciation de l’achèvement ou de l’inachèvement d’une construction au regard du droit de l’urbanisme s’apprécie en effet de façon concrète, en considération de son état physique (Cass.civ., 11 mai 2000, Mme Duguet, Bull. civ., III, p.107).
Il est vrai cependant que la formulation d’une déclaration d’achèvement constitue un indice, voire même une présomption (art. R.600-3 ; C.urb).
Il reste que pour ce qui concerne tant le régime des travaux sur existants que celui du « modificatif », il existe un certain rapport d’indissociabilité entre l’achèvement de la construction et la conformité de cette dernière. En effet (voir ici) :
- Lorsque la construction existante a été exécutée en méconnaissance du permis de construire l’ayant autorisé, tout nouveau travaux ultérieurement projetée sur cette dernière impliquera, sous réserve du bénéfice de la prescription décennale introduite par l’article L.111-12 du Code de l’urbanisme, la régularisation préalable ou concomitante de celle-ci par un permis de construire dont la demande sera, sur la forme et sur le fond, instruire comme si elle portait sur une construction nouvelle à édifier ;
- Lorsque l’immeuble en cours de réalisation est édifiée en méconnaissance du permis de construire s’y rapportant, un « modificatif » ne saurait être légalement obtenu sans que celui-ci ne régularise les travaux irrégulièrement entrepris.
D’ailleurs, aux termes du nouvel article R.462-9 du Code de l’urbanisme : « lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée ».
Cet article induit donc lui-même qu’un « modificatif » – du moins de régularisation – peut être sollicité et légalement délivré, nonobstant la formulation préalable d’une déclaration d’achèvement.
Cette conclusion est d’ailleurs conforme à la nature de la déclaration d’achèvement telle qu’elle est actuellement régie par l’article R.462-1 du Code de l’urbanisme et dont il résulte qu’elle atteste non seulement de l’achèvement mais également de la conformité des travaux réalisés.
De ce fait, force est de donc de considérer que l’achèvement et la conformité des travaux sont deux notions indissociables et, par voie de conséquence, que tant que les travaux réalisés ne peuvent être regardés ou réputés conformes à l’autorisation obtenue, ils ne peuvent être considérés comme achevés.
En d’autres termes, un « modificatif » peut être sollicité et légalement obtenu tant que le délai ouvert à l’administration pour contester la conformité des travaux n’a pas expiré ou, du moins, tant que l’administration n’a pas délivré le certificat attestant de ce que la conformité de ces travaux n’a pas été contesté.
Reste maintenant le problème plus concret de l’articulation d’un tel « modificatif » avec l’objet et le déroulement des opérations de récolement…
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés


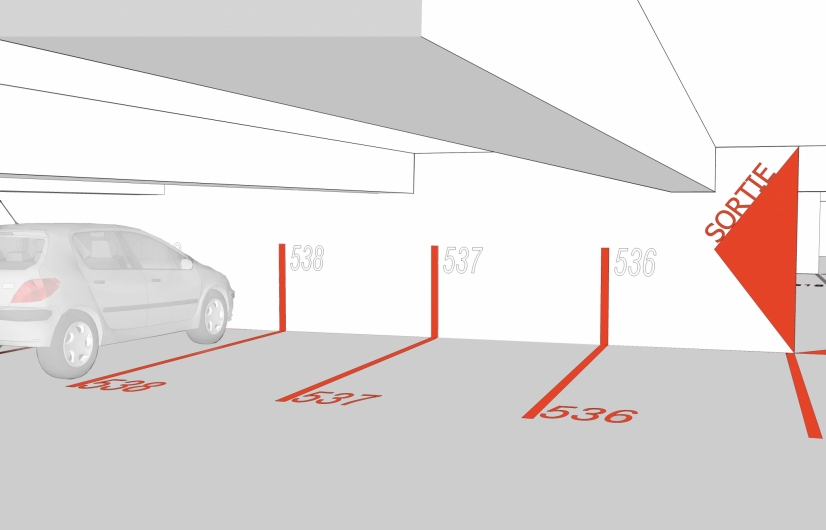
 Dans cette affaire, le pétitionnaire avait obtenu un permis de construire portant sur deux bâtiments de 28 logements comportant également des locaux professionnels, d'une SHON de 2147 mètres carrés ; ces locaux représentant un peu plus de 240 mètres carrés de cette SHON totale. L’article 12 du règlement de POS applicable prescrivant la réalisation d’une place de stationnement par logement et une place supplémentaire pour 60 mètres carrés de SHON affectée au commerce et à l'artisanat, la conformité du projet impliquait donc que la demande de permis de construire intègre la réalisation de 32 places de stationnement. Précisément, le projet présenté par le pétitionnaire à travers son dossier demande et le permis délivré au vu de ce dossier prévoyaient la réalisation de 32 places.
Dans cette affaire, le pétitionnaire avait obtenu un permis de construire portant sur deux bâtiments de 28 logements comportant également des locaux professionnels, d'une SHON de 2147 mètres carrés ; ces locaux représentant un peu plus de 240 mètres carrés de cette SHON totale. L’article 12 du règlement de POS applicable prescrivant la réalisation d’une place de stationnement par logement et une place supplémentaire pour 60 mètres carrés de SHON affectée au commerce et à l'artisanat, la conformité du projet impliquait donc que la demande de permis de construire intègre la réalisation de 32 places de stationnement. Précisément, le projet présenté par le pétitionnaire à travers son dossier demande et le permis délivré au vu de ce dossier prévoyaient la réalisation de 32 places.
 Quelle que soit l’importance et les caractéristiques intrinsèques de la construction, le pétitionnaire doit alors produire à son dossier de demande de permis de construire l’étude d’impact requise à ce titre. Il en va ainsi y compris lorsque les travaux objets de la demande de permis de construire porte sur une installation existante dès lors que ces travaux correspondent à une modification de ses conditions d’exploitation nécessitant une nouvelle autorisation au titre de la législation environnementale (CAA. Marseille, 21 février 2007, ANPER, req. n°03MA00068).
Quelle que soit l’importance et les caractéristiques intrinsèques de la construction, le pétitionnaire doit alors produire à son dossier de demande de permis de construire l’étude d’impact requise à ce titre. Il en va ainsi y compris lorsque les travaux objets de la demande de permis de construire porte sur une installation existante dès lors que ces travaux correspondent à une modification de ses conditions d’exploitation nécessitant une nouvelle autorisation au titre de la législation environnementale (CAA. Marseille, 21 février 2007, ANPER, req. n°03MA00068).