Que reste-t-il du principe d’indépendance des procédures ?
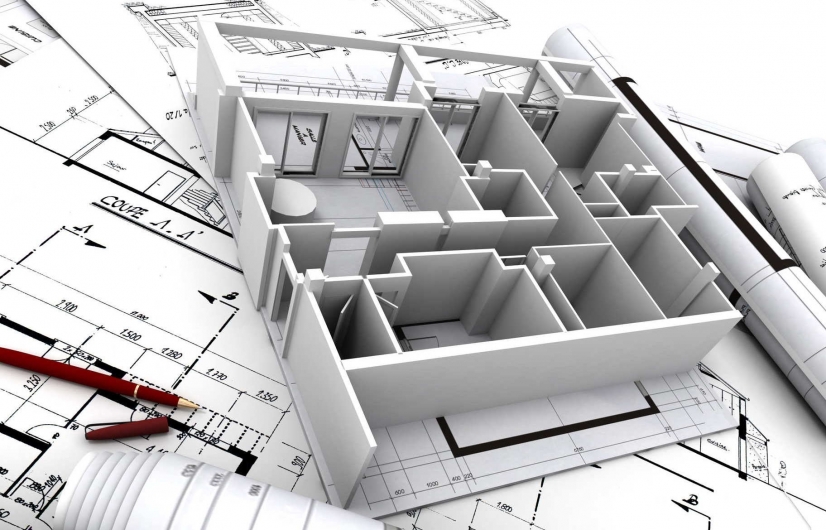
La conformité des dossiers des demandes d’autorisation se rapportant à une opération indissociable doit s’apprécier globalement. Partant, les documents joints au dossier de l’une des demandes peuvent pallier les carences de l’autre.
CE.30 décembre 2011, Cne de Saint-Raphaël, req. n°342.398
Comme on le sait, le permis de construire a pour seul objet d’autoriser le projet de construction tel qu’il ressort du dossier de demande produit par le pétitionnaire.
Partant, non seulement l’administration statuant sur la demande doit prendre parti sur la totalité des aspects du projet sanctionnés par l’article L.421-6 du Code de l’urbanisme mais en outre, et pour ce qui concerne le projet en lui-même, l’administration est réputée statuer au seul vu des pièces du dossier de demande ; ce dont il résulte d’ailleurs qu’au-delà des informations et des pièces prescrites par les articles R.431-5 à R.431-33 du Code de l’urbanisme, il incombe au pétitionnaire de produire l’ensemble des pièces nécessaires pour que les services instructeurs puissent apprécier en toute connaissance de cause la conformité du projet aux normes d’urbanisme lui-étant opposable.
Si la régularité formelle du dossier de demande s’apprécie de façon globale, et non pas isolément pièce par pièce donc, il n’en demeure donc pas moins que les services instructeurs ne peuvent en principe prendre en compte que les pièces produites par le pétitionnaire et, a contrario, ne peuvent s’en rapporter à leur connaissance du projet et de son environnement, ni même se référer aux pièces produites dans un dossier présenté concomitamment ou, bien plus, précédemment (voir toutefois : CAA. Paris, 28 septembre 1999, M. B…, req. n°96PA02676). C’est ainsi que la Cour administrative d’appel de Marseille vient de très récemment juger que :
« Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme (...). ;
Considérant que si le dossier de demande de permis de construire a pour objet principal de permettre à l'administration de procéder à l'instruction de la demande afin que le maire prenne sa décision en toute connaissance de cause, il doit également permettre aux tiers, grâce à sa composition complète, de prendre connaissance des éléments sur lesquels le maire a fondé sa décision, afin de pouvoir, le cas échéant, la contester ; que, par suite, la circonstance que le maire ait pu avoir connaissance des éléments du dossier à l'occasion de l'instruction d'une précédente demande n'autorise pas le pétitionnaire qui présente une nouvelle demande à s'écarter des prescriptions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, aucun document photographique ne permet de situer le terrain dans le paysage lointain ; que les documents produits n'ont pas permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis ; que les bénéficiaires du permis de construire attaqué n'établissent avoir été dans l'impossibilité de prendre lesdites photographies, dès lors que les demandeurs de première instance en ont produites ; que, d'autre part, les 6 photographies jointes à la demande sont prises sous des angles de vues qui ne permettent ni d'avoir une vision globale du vaste terrain d'assiette, ni d'apprécier la place qu'occupe ce terrain dans son environnement proche ; que, par suite, c'est en méconnaissance de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme que le permis de construire en litige a été délivré » (CAA. Marseille, 26 janvier 2012, M. A…, req. n°10MA01677).
Mais à l’occasion de la cassation d’un autre arrêt de la même Cour, le Conseil d’Etat vient à nouveau de s’écarter de cette application classique du principe d’indépendance des procédures en jugeant que :
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que le terrain d'assiette du projet en litige figure sur la liste des éléments architecturaux et paysagers à préserver annexée au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que dès lors, il se trouve dans l'une des zones dans lesquelles s'appliquent les prescriptions de l'article R. 430-3 du même code ; que M. C a déposé le même jour ses demandes concernant les deux permis de démolir et le permis de construire nécessaires à la réalisation de l'extension de son habitation ; que si le dossier joint à la demande qui concernait le permis de démolir annulé par l'arrêt n° 08MA03502 ne comportait qu'un nombre limité de documents photographiques, d'autres photographies répondant aux prescriptions de l'article R. 430-3 précité figuraient dans le dossier joint à la demande qui concernait le permis de construire ; que les demandes, qui concernaient un projet de démolition partielle et de reconstruction en vue d'extension relative à une seule et même opération, n'étaient pas dissociables, alors même qu'elles étaient instruites distinctement ; que, dans ces conditions, en jugeant que le dossier de demande de permis de démolir ne comportait pas les documents photographiques requis faisant apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants, et en particulier dans le parc au sein duquel il est implanté, sans tenir compte des documents figurant dans le dossier de demande de permis de construire présenté le même jour, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ».
Ce faisant le Conseil d’Etat a donc redonné à l’ancien article R.421-3-4 et à l’actuel article R.431-21 b) du Code de l’urbanisme leur pleine logique dès lors que ces dispositions ont pour seul but d’assurer la coordination entre la procédure d’instruction de la demande de permis de construire et de permis de démolir. Telle est la raison pour laquelle, compte tenu du principe d’indépendance des procédures, le seul fait que l’administration ait effectivement été précédemment saisie d’une demande de permis de démolir avant de délivrer un permis de construire n’assure pas la légalité de ce dernier au regard de l’article R.431-20 du Code de l’urbanisme mais qu’en revanche, le fait que la demande de permis de démolir n’ait pas été jointe au dossier de demande permis de construire est sans incidence si le permis de démolir a été délivré avant la délivrance du permis de construire puisqu’alors l’administration est réputée avoir eu connaissance de la première autorisation avant de délivrer la seconde (CE. 26 octobre 1994, OPHLM du Maine-et-Loire, req. n°127.718).
En raison de cette coordination des procédures, il est donc normal que la régularité formelle des dossiers soit appréciée globalement, comme s’ils n’en formaient qu’un, et que ce soit au regard de cet ensemble que les services instructeurs apprécient la conformité du projet objet de la demande sur laquelle ils statuent.
Cette conclusion logique n’est toutefois pas sans limite. D’autres dispositions du Code de l’urbanisme imposent en effet au pétitionnaire de produire à son dossier de demande les justificatifs se rapportant aux demandes d’autorisations administratives requises pour la mise en œuvre de son projet.
On pense notamment à l’ancien article R.421-3-2 et à l’actuel article R.431-20 imposant notamment que le cas échéant le pétitionnaire produise à son dossier de demande de permis de construire le justificatif de la demande d’autorisation d’exploiter exigées pour les installations classées pour la protection de l’environnement. Or, si cette production est également justifiée par la nécessaire coordination de la procédure d’instruction de la demande de permis de construire et de l’autorisation d’exploiter, il reste que l’on a un certain mal ici à en saisir l’utilité dès lors qu’au-delà du principe d’indépendance des législations, l’une et l’autre de ces deux autorisations n’ont pas le même objet ; à la différence d’un permis de construire et d’un permis de démolir qui chacun se rapporte à l’exécution de travaux.
En outre, la délivrance de ces autorisations relève en principe de la compétence d’autorité distincte ; le permis de construire étant en principe délivré par le Maire, l’autorisation d’exploiter par le Préfet.
Malheureusement , on voit donc mal, notamment, comment le défaut de production de l’étude d’impact au dossier au vu duquel le Maire doit statuer sur la demande de permis de construire pourrait être pallié par la présence de l’étude jointe au dossier de demande d’autorisation d’exploiter soumis au Préfet...
… Sans compter, précisément, que l’arrêt du Conseil d’Etat objet de la note de ce jour ne vise en fait pas l’article R.421-3-4 du Code de l’urbanisme alors applicable. Et pour cause puisque la décision contestée en l’espèce n’était pas le permis de construire mais le permis de démolir dont le dossier de demande n’avait pour sa part pas à justifier d’une demande d’autorisation de construire…
Le Conseil d’Etat a en effet retenu la solution commentée non pas en raison des dispositions relatives à la coordination des instructions des demandes de permis de construire et de permis de démolir mais en considération du fait que « les demandes, qui concernaient un projet de démolition partielle et de reconstruction en vue d'extension relative à une seule et même opération, n'étaient pas dissociables, alors même qu'elles étaient instruites distinctement ».
C’est donc l’indissociabilité (déjà reconnue) des travaux de démolition et de construction projetés qui justifie que l’administration soit réputée être en mesure de puiser dans l’un des dossiers de demande lui étant soumis la pièce qui manque dans l’autre.
Or, comme on le sait, c’est au premier chef ce principe d’indépendance des procédures qui explique qu’en principe, un ensemble immobilier unique, et donc indissociable, doive faire l’objet d’une seule et même demande de permis de construire de sorte à ce que l’administration puisse apprécier la matérialité et la conformité du projet dans sa globalité.
Paradoxalement, cette nécessité ressort au premier chef de l’arrêt « Ville de Grenoble » qui a certes permis le fractionnement de la réalisation d’un ensemble immobilier unique en plusieurs permis de construire lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifie et que ce fractionnement a vocation à s’opérer à l’égard de composante du projet dotée d’une autonomie fonctionnelle mais ce, « sous réserve que l'autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés ».
L’administration doit donc vérifier que pris dans sa globalité, et non pas composante par composante, et demande par demande, le projet respecte l’ensemble des règles projet lui étant opposables et, en d’autres termes, que le fractionnement de sa réalisation en plusieurs autorisations n’aboutit pas à contourner une ou plusieurs de ces règles (pour l’exemple d’un fractionnement frauduleux : CAA. Paris, 18 octobre 2001, MM. Frack & Pinvin, req. n° 98PA02786).
Par cette réserve il s’agit donc de compenser le fractionnement d’une opération indivisible en autorisations distinctes en globalisant leur instruction malgré un principe d’indépendance des procédures s’opposant à un tel fractionnement.
Mais si dès lors que les demandes d’autorisations se rapportant à une opération indissociable doivent en toute hypothèse être appréciées dans leur globalité, force est d’admettre que l’on voit maintenant mal pourquoi il faudrait réserver cette exception aux seuls cas visés par l’arrêt « Ville de Grenoble ».
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés



