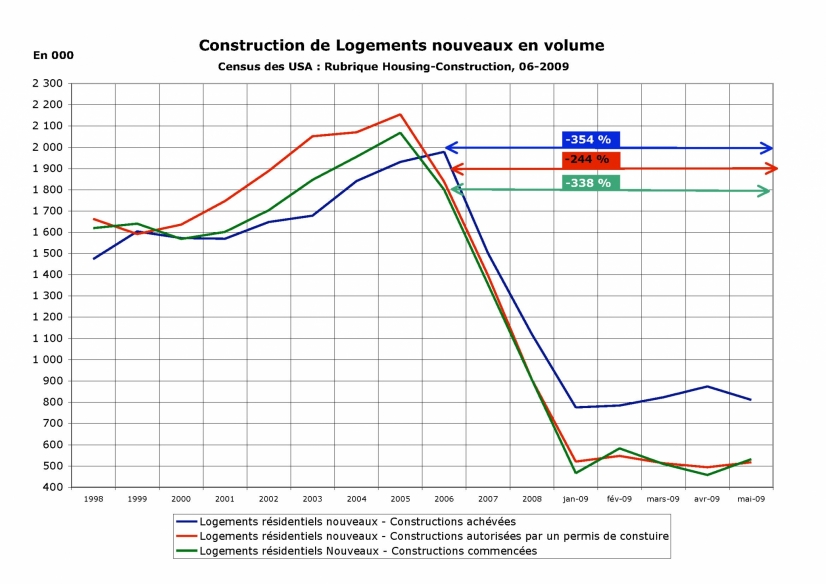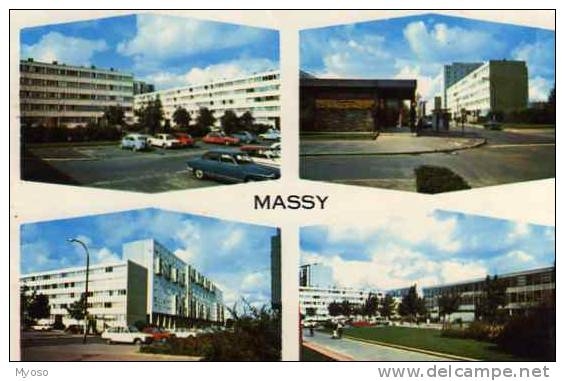INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :
CAA. Marseille, 10 novembre 2011, M. & Mme A…, req. n°09MA03131 : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. et Mme A consiste, selon les termes de l'imprimé de leur déclaration de permis de construire, en une pergola abri-voiture avec chauffage solaire, sur une dalle sous laquelle sera aménagée une salle de jeu ; que ce projet d'environ 7 mètres sur 7 d'emprise au sol, selon le plan de masse joint à la demande de permis de construire, est implanté en limite parcellaire sans faire corps avec le bâtiment principal d'habitation dont il est distant d'environ 5 mètres ; qu'eu égard à l'affectation et aux dimensions limitées de cette construction, à usage principal d'abri voiture dont l'entresol sera affecté à une salle de jeux pour enfants, et compte tenu de l'absence de tout lien fonctionnel avec la maison d'habitation dont elle ne constitue que l'accessoire, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Nice l'a qualifiée d'annexe ».
CAA. Marseille, 10 novembre 2011, Sylvain D…, req. n°09MA03829 : « Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UJ8 du règlement du plan d'occupation des sols : Entre tout point de chaque construction non contiguë, doit toujours être respectée une distance au moins égale à la hauteur de la plus haute des constructions sans être inférieure à 8 m ; qu'il ressort toutefois du plans de masse et des plans de coupe, que la maison d'habitation et la piscine qui en est le prolongement et dont elle n'est pas séparée, doivent être regardées comme formant une seule construction ; que dès lors, en l'absence de l'existence de deux constructions distinctes sur le terrain d'assiette, les dispositions de l'article UJ8 du règlement du plan d'occupation des sols ne sont pas applicables à ce projet ».
CAA. Lyon, 8 novembre 2011, Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble l’Ancolie, req. n°09LY02144 : « Considérant que la superficie du terrain d'assiette du projet est de 2 868 m2 de sorte que l'emprise au sol maximale ne peut dépasser 1 434 m2 ; que le projet comporte l'aménagement d'une piscine intérieure en sous-sol, dont la dalle de couverture constitue une terrasse formant une superstructure élevée au dessus du sol naturel ; qu'ainsi, dès lors que les dispositions du plan d'occupation des sols ne prévoient aucune exception en faveur de cette catégorie d'ouvrages, cette terrasse constituant un élément indissociable de la construction doit être prise en compte pour le calcul du coefficient d'emprise au sol ; que l'emprise au sol du projet atteint ainsi 1 865 m2 dépassant le coefficient de 0,5 fixé par l'article UC 9 précité pour les établissements hôteliers, même en s'abstenant de tenir compte des auvents, hôtels, balcons et débords de toiture, ainsi que la rampe d'accès au parc de stationnement souterrain ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 9 du plan d'occupation des sols ».
CAA. Lyon, 11 octobre 2011, Cne de Fontaines, req. n°10LY01953 : « Considérant, en premier lieu, que, si l'article UI 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE FONTAINES, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites, n'interdit pas expressément les piscines couvertes, l'article UI 2 de ce même règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol admises sous conditions, dispose que les piscines non couvertes et les locaux liés à cet équipement sont admis s'ils respectent l'ensemble des conditions d'implantation et d'emprise suivantes (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que seules les piscines non couvertes peuvent être autorisées en zone UI et que les piscines couvertes, ou les couvertures de piscines, sont interdites dans cette zone ».
CAA. Marseille, 6 octobre 2011, Cne de Camps la Source, req. n° 09MA03338 : « Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement de la zone 1AU du plan local d'urbanisme de la commune relatif aux implantations par rapport aux voies et aux emprises publiques, 1) Les constructions doivent s'implanter à une distance supérieure ou égale à 5 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, à modifier par emplacement réservé ou plan d'alignement, ou à créer. Toutefois des implantations différentes peuvent être admises ou imposées si l'aménagement proposé ne compromet pas l'ordonnancement des voies (...) ; que pour annuler l'arrêté du 5 novembre 2007, le tribunal administratif de Toulon a considéré que ces dispositions n'étaient pas opposables aux voies de circulation internes au terrain d'assiette du projet dont la vocation était de desservir le bâtiment d'habitation ou les garages ;
Considérant que si les dispositions de l'article 6 du règlement peuvent trouver matière à s'appliquer à des projets impliquant la création d'une voirie interne privée destinée à desservir plusieurs habitations, c'est à la condition que cette voirie ait une fonction de desserte générale, ou qu'elle soit ouverte à la circulation publique ; que ne sauraient en revanche être qualifiés de voies au sens de ces dispositions, les accès goudronnés qui, comme en l'espèce, donnent directement depuis l'entrée du terrain sur des garages et un bâtiment collectif d'habitation ; que le maire de Camps la source ne pouvait, dès lors, comme l'a jugé le tribunal, légalement se fonder sur ces dispositions pour refuser, au regard des caractéristiques de cette desserte, la demande de permis de construire de l'E.U.R.L. Sud Immo Promotion ».
CAA. Nantes, 30 septembre 2011, M. et Mme Y…, req. n° 10NT00675 : « Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la ville de Caen : 1- Pour toutes les affectations, les normes se réfèrent à la surface hors oeuvre nette, à l'exception des hôtels (...) pour lesquels les normes se réfèrent au nombre de chambres (...). Chaque tranche entamée de plus de 25 % donne lieu à l'application de la norme. (... ) Lorsqu'une opération comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des critères pris en compte (SHON, chambre, lit ou logement créé). / 2 - Sans préjudice de l'application des dispositions d'ordre public de l'article R. 111-4 du Code de l'Urbanisme, afin d'assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations en dehors des voies publiques, il est exigé de réaliser sur la propriété : a) Pour les constructions à usage d'habitation collective, une place de stationnement par tranche de 70 m² de SHON, avec au minimum une place par logement (...) ; qu'aux termes des dispositions du même article UA 12, en son paragraphe 12.4 relatif aux opérations de réhabilitation : Dans le cadre d'opérations de réhabilitation, les places de stationnement préexistantes sur le terrain doivent être maintenues. / a) Pour les opérations de réhabilitation portant sur des constructions à usage d'habitation : - lorsqu'il n'y a pas de création de logement nouveau, il n'est pas exigé de places de stationnement supplémentaires - lorsqu'il y a création de logement nouveau, il est exigé une place de stationnement par logement créé. / b) Pour les opérations de réhabilitation portant sur un changement de destination : - lorsqu'il n'y a pas création de SHON nouvelle, il n'est pas exigé de places de stationnement supplémentaires ; - lorsqu'il y a création de plus de 15 m² de SHON, il est exigé un nombre de places de stationnement supplémentaires conformément aux dispositions définies au paragraphe 12.2 ci-dessus ; que le nombre de places de stationnement supplémentaires, exigées en application de ces dernières dispositions, est déterminé en fonction de la seule surface hors oeuvre nette (SHON) créée pour une opération donnée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération autorisée par le permis de construire contesté nécessitait, en application des dispositions précitées, la création de 14 places de stationnement pour les 13 logements créés dans le bâtiment à édifier au 52, rue Damozanne, qui entraînent la création de 974 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en l'absence de création de SHON, aucune place de stationnement nouvelle n'était requise pour les 5 logements créés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble réhabilité rue de Bayeux, correspondant à une surface hors oeuvre nette de 385 m² se substituant à la surface hors oeuvre nette de 460 m² antérieurement utilisée en bureaux ; qu'ainsi, en admettant que des places de stationnement nouvelles soient exigibles pour chacun des 9 logements aménagés dans les étages de cet immeuble, où préexistait un nombre indéterminé de logements, le projet autorisé ne nécessitait, en vertu des dispositions précitées de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la ville de Caen, que la construction de 25 places de stationnement, compte tenu des deux places à reconstruire du fait de la démolition autorisée ; que, par suite, en prévoyant la réalisation de 26 places de stationnement, le projet n'a pas méconnu ces dispositions ».
CE. 30 septembre 2011, Cne de Saint-Maur-les-Fossés, req. n°339.619 : « Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux plans d'occupations des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : Les plans d'occupation des sols fixent (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols. (...) Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; qu'aux termes de l'article R. 123-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le règlement du plan d'occupation des sols doit : b) Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et autres constructions ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, le règlement du plan d'occupation des sols doit fixer des règles précises d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives ; que, lorsque le règlement contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d'implantation qu'il fixe, ces règles d'exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 123-1 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'article UE 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, après avoir fixé en son premier alinéa les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques en imposant le respect de distances minimales de retrait, dispose en son deuxième alinéa que : Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l'amélioration des constructions existantes ; qu'une exception identique est prévue au II de l'article UE 7 de ce même règlement, pour ce qui concerne les règles générales d'implantation par rapport aux limites séparatives, fixées par le I du même article ; qu'ainsi qu'il a été dit, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que ces exceptions étaient illégales faute d'être suffisamment encadrées et que le permis de construire délivré à M. et Mme B, dont la délivrance n'était possible que sur leur fondement, devait, en conséquence, être annulé ;
Considérant cependant que, compte tenu de l'objet limitativement énoncé de ces exceptions, tenant à l'harmonie urbaine avec les constructions voisines et à l'amélioration des constructions existantes, objectif conforté par les termes de l'annexe à ce règlement qui définit les travaux d'amélioration de l'habitabilité , ces règles d'exception figurant aux articles UE 6 et UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES doivent être regardées comme suffisamment encadrées, eu égard à leur portée ; qu'en écartant leur application, la cour administrative d'appel a, dès lors, commis une erreur de qualification juridique ».
CE. 30 septembre 2011, Christian B…, req. n°336.249 : « Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gignac-la-Nerthe, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 1. Implantation par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies. / En bordure des voies, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite séparative à l'autre. / (...). 2. Implantation par rapport aux limites de fonds de propriété. Sauf création de la servitude prévue à l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche d'une limite séparative n'aboutissant pas aux voies doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à trois mètres (3 m). ; que, pour l'application de ces dispositions, les limites séparatives s'entendent comme les limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent ; que la limite entre deux propriétés situées en bordure d'une même voie doit être regardée comme une limite séparative aboutissant à cette voie ; que la circonstance qu'une telle limite séparative soit constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux est sans influence sur sa qualification de limite séparative aboutissant aux voies ».
EMPLACEMENT RESERVE :
CAA. Marseille, 10 novembre 2011, Cne de Rocbaron, req. n°09MA04718 : « Considérant qu'il soutient que la parcelle 170 est grevée depuis 1987 d'un emplacement réservé, sans que la commune ait jamais pris la moindre initiative pour réaliser des équipements ayant motivé l'institution d'une réserve ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle 170 a été grevé de 1987 à 2008 par un emplacement réservé n° 26 de 2 200 m² pour la réalisation d'un réservoir d'eau ; que le plan local d'urbanisme en litige prévoit un emplacement réservé n° 40 de 1640 m² destiné à accueillir des équipements publics scolaires ; qu'en effet, après avoir abandonné l'idée de construire un réservoir d'eau, la COMMUNE DE ROCBARON a désormais l'intention d'étendre le groupe scolaire situé à proximité ; que la circonstance qu'un permis de construire ait été délivré le 27 novembre 1989 sur une parcelle comprise dans l'emplacement réservé n° 26 et qu'une parcelle ait été vendue en 2007 par la commune sur cet emplacement réservé ne signifie pas que la réservation de cet emplacement pour un nouveau projet ne serait pas justifiée ; qu'à cet égard, les orientations générales du rapport de présentation du plan local d'urbanisme témoignent du souci des autorités locales d'attirer sur le territoire de la commune une population active jeune, ce qui devrait avoir pour effet d'induire un accroissement des effectifs scolaires ; que, dans ces conditions, le choix de réserver un emplacement situé à proximité du groupe scolaire pour procéder à son extension, fondé sur la situation particulière de la parcelle et sur des motifs d'urbanisme, répond à un intérêt général et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ».
CAA. Bordeaux, 8 novembre 2011, SCCV Troisset, req. n°10BX01118 : « Considérant qu'en vertu du plan local d'urbanisme de la commune des Trois Ilets, la parcelle servant de terrain d'assiette au projet de la SCCV TROISSET était classée en emplacement réservé au profit du département aux fins de construction d'une déviation de la route départementale 7 ; qu'un tel classement emportant interdiction de construire, sauf à titre précaire, c'est à bon droit que le maire a refusé à la société requérante la délivrance d'un permis de construire sur cet emplacement ; que la circonstance que le département aurait renoncé à son projet, si elle peut être utilement opposée au refus de modifier le plan local d'urbanisme et de déclasser ladite parcelle, est sans influence sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un permis de construire ».
CONCESSION D’AMENAGEMENT :
CE. 18 novembre 2011, SNC EIFFAGE AMENAGEMENT, req. n°342.147 : « Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée, excluaient les conventions d'aménagement, contrats par lesquels une personne publique délègue la réalisation d'une opération d'aménagement comportant la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements, des règles de publicité et de mise en concurrence prévues pour la passation des délégations de services publics ; que ces conventions devant néanmoins être soumises à des règles de publicité et de mise en concurrence, tant en vertu des exigences découlant des principes généraux du droit communautaire de non-discrimination et d'égalité de traitement que des règles applicables à la conclusions des concessions de travaux au sens du droit de l'Union européenne, la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement a modifié cet article L. 300-4 afin de le mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne, en soumettant l'attribution des conventions d'aménagement à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes ; que l'article 11 de cette loi du 20 juillet 2005 a cependant prévu, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la validation de l'ensemble des conventions d'aménagement signées avant la publicité de la loi, en tant que leur légalité serait contestée au motif que la désignation de l'aménageur n'a pas été précédée d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes :
Mais considérant que les dispositions de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 tendent à soustraire les conventions d'aménagement à l'exigence d'une publicité préalable à la conclusion de ces contrats, découlant, ainsi qu'il a été dit, tant du respect des principes généraux du droit de l'Union européenne de non-discrimination et d'égalité de traitement que des règles applicables à la conclusion des concessions de travaux au sens de ce droit ; que le principe de sécurité juridique, s'il est susceptible de permettre aux cocontractants de poursuivre leurs relations contractuelles durant une période transitoire, afin de les dénouer dans des conditions acceptables, ne saurait autoriser la validation pure et simple de ces conventions ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant illégale la décision de signer la convention litigieuse au motif tiré de ce que, en l'absence au cas d'espèce d'un motif impérieux d'intérêt général, l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 ne pouvait faire obstacle à l'application du droit de l'Union européenne ».
DROIT DE PREEMPTION :
CE. 2 décembre 2011, Pascal A…, req. n°343.104 : « Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que le motif de préemption qu'elles instituent au profit des communes détentrices d'un droit de préemption peut s'appliquer à tout immeuble à usage d'habitation, et non pas seulement aux immeubles de plus de dix logements visés par l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par l'arrêt attaqué, que la commune d'Alfortville avait légalement pu fonder la décision de préemption en litige sur le fait qu'elle entendait assurer, conformément à l'article L. 210-2 du code de l'urbanisme, le maintien des locataires dans les lieux, alors même que l'immeuble préempté ne comportait que huit logements et ne relevait ainsi pas du champ d'application de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'applicabilité à l'ensemble des immeubles à usages d'habitation du motif de préemption prévu par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme résulte des termes mêmes de cet article ; que la cour n'était, dès lors, pas tenue de motiver davantage sa décision au regard des développements, même très circonstanciés, consacrés sur ce point par le requérant aux travaux préparatoires de la loi du 13 juin 2006 ; qu'elle n'a pas, ce faisant, dénaturé les termes de la requête qui lui était soumise ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ».
LOTISSEMENT & DIVISIONS FONCIERES :
CAA. Marseille, 20 octobre 2011, Jean-Claude A…, req. n°09MA03777 : « Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. (...) Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : a) Les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de dix ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai (...) ; qu'aux termes de l'article R. 315-3 du même code alors en vigueur : La création d'un lotissement est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions définies au présent chapitre ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, les parcelles bâties B 4444 et B 4445, qui supportent des bâtiments achevés depuis moins de dix ans, doivent être prises en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division de la parcelle initiale B 4411, nonobstant le caractère postérieur au permis de construire de cette division ; qu'il s'ensuit que celle-ci a eu pour effet de porter à plus de deux lots le nombre de terrains constructibles issus de la propriété foncière appartenant à la S.A.R.L. Azurea ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir qu'en l'absence d'autorisation de lotir, le permis de construire délivré le 12 janvier 2007 à ladite société est entaché d'illégalité ».
AUTORISATIONS D’URBANISME :
CAA. Bordeaux, 18 octobre 2011, France Nature Environnement, req. n°10BX03015 : « Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 applicable au permis de construire en litige : Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code: La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ; que l'association requérante se prévaut de la méconnaissance de l'article R. 423-1 mais ne conteste pas pour autant la présence de l'attestation que cet article et l'article R. 431-5 requièrent dans le dossier de la demande de permis de construire déposé par la société Groupe Victoria ; que la circonstance que certaines des parcelles composant le terrain d'assiette du projet auraient encore été à la date de cette demande et même à la date de la délivrance du permis la propriété de tiers, faute que les projets de vente les concernant aient été formalisés , ne suffit pas à faire regarder la société pétitionnaire comme dépourvue de qualité, au regard de l'article R. 423-1, pour déposer cette demande ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme créé par le décret précité du 5 janvier 2007 : Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis en litige, y compris pour ce qui est des aires de stationnement attachées audit projet, porterait, à la date à laquelle il a été délivré, sur une dépendance du domaine public ; que, si l'association requérante entend contester, par la voie de l'exception d'illégalité, la procédure au terme de laquelle ont été décidés la désaffectation et le déclassement de parcelles appartenant au domaine public communal, le permis de construire en litige ne constitue pas une application de ces décisions ; que, par suite, une telle exception d'illégalité ne peut être accueillie à l'appui du recours dirigé contre ce permis ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 doit être écarté ».
CE. 14 octobre 2011, Dominique A…, req. n°331.886 : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. (...) Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Sont exemptés du permis de construire (...) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : m) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : qui n'ont pas effet de créer une surface de plancher nouvelle ; ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors œuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés. ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que sont exemptés de permis de construire les travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors œuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés ;
Considérant que la transformation du toit terrasse d'une maison d'habitation en terrasse accessible n'a pas pour effet de changer la destination de la construction au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, en jugeant que de tels travaux changeaient la destination de la construction et ne pouvaient être réalisés sans l'obtention préalable d'un permis de construire, le tribunal administratif de Montpellier a inexactement qualifié les faits de l'espèce et, par suite, commis une erreur de droit ».
CONTENTIEUX DE LA LEGALITE :
CAA. Lyon, 8 novembre 2011, Cne de Limonest, req. n°10LY01135 : « Considérant que la commune soutient que le retrait du permis tacite du 25 mars 2007 était soumis aux dispositions du 3°) de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 susvisée aux termes duquel : Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé ; qu'elle fait en conséquence valoir que le retrait intervenu était possible à la date du 15 octobre 2007, dès lors qu'un recours contentieux avait été formé à son encontre le 27 juillet 2007 par l'Association syndicale libre du hameau de Mathias ;
Considérant que les règles de procédure visées par le décret du 5 janvier 2007 précité ne visent que l'instruction des demandes de permis de construire jusqu'à l'intervention d'une décision sur celles-ci ; qu'en revanche, elles ne sauraient régir une décision de retrait intervenue postérieurement au 1er octobre 2007 qui est soumise aux dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme précité ; qu'en l'espèce, la décision du 15 octobre 2007 valant retrait du permis de construire tacite dont la SCI Résidence du Mathias était titulaire depuis le 25 mars 2007 est intervenue tardivement, dès lors qu'il a été effectué le 15 octobre 2007 au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce et alors que l'autorité administrative ne disposait plus du pouvoir pour ce faire ; qu'ainsi la COMMUNE DE LIMONEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a accueilli le moyen présenté par la SCI Résidence du Mathias tiré de la tardiveté de l'arrêté du 15 octobre 2007 ».
DIVERS :
CAA. Paris, 4 novembre 2011, Sté CONFINFO, req. n°10PA04025 : « Considérant que le conseil d'administration de la S.I.E.M.P., par délibération en date du 9 mars 2006 se référant à la convention publique d'aménagement en date du 30 mai 2002, modifiée par plusieurs avenants, en vertu de laquelle la ville de Paris avait confié à cette société d'économie mixte une mission d'éradication de l'habitat insalubre en lui déléguant ses pouvoirs en matière d'expropriation pour l'exercice de cette mission, a demandé au préfet de Paris l'ouverture d'une procédure de déclaration d'utilité publique aux fins d'expropriation de l'immeuble sis au 3 et 5 rue Godefroy Cavaignac se trouvant dans un état de délabrement général , en vue d'y réaliser une vingtaine de logements sociaux et trois locaux d'activité en rez-de-chaussée ; qu'une telle délibération, prise par l'organe compétent d'une personne morale de droit privé chargée de l'exécution d'une mission de service public et investie à cette fin de prérogatives de puissance publique, dont elle a fait usage à cette occasion, constitue une décision administrative, premier élément de l'opération complexe à l'issue de laquelle sont intervenus les arrêtés préfectoraux litigieux portant déclaration d'utilité publique et déclaration de cessibilité ; que, par suite, sa légalité peut être utilement contestée, devant la juridiction administrative, à l'appui d'une demande dirigée contre ces arrêtés préfectoraux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que suite à des travaux réalisés d'office aux frais et risques du propriétaire en 2003, l'immeuble n'était plus, à la date de la délibération du 9 mars 2006, exposé à des risques d'intoxication au plomb ; que d'autre part, si la notice explicative du dossier d'enquête publique rédigée par la S.I.E.M.P. et le rapport du commissaire enquêteur font valoir que l'immeuble était dans un état particulièrement dégradé, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment d'un rapport d'huissier du 13 mars 2007, d'un rapport d'audit d'un cabinet d'architectes, des termes de la notice jointe à la demande de permis de construire déposée par la S.I.E.M.P. pour la réhabilitation de l'immeuble après sa prise de possession, et des termes mêmes du jugement du juge des expropriations du Tribunal de grande instance de Paris en date du 25 juin 2007, rendu après visite approfondie de l'immeuble effectuée le 28 mars 2007, que si cet immeuble nécessitait d'importants travaux d'entretien, dont l'absence durant plusieurs années était d'ailleurs largement imputable aux décisions par lesquelles le préfet de police avait refusé, à plusieurs reprises, d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion judiciairement ordonnée dès le 22 mars 2000 d'occupants sans titre, il ne pouvait, sans erreur d'appréciation, être regardé comme insalubre ni en état de délabrement général ni même comme particulièrement dégradé ; que, dès lors, la délibération précitée qui se fonde sur un état d'insalubrité ou de dégradation avancée qui ne correspond pas à la réalité, et qui avait d'ailleurs pour but d'engager une procédure d'expropriation au profit d'un organisme qui, aux termes de la convention précitée, ne pouvait ainsi mettre en œuvre les pouvoirs qui lui avaient été délégués en matière d'expropriation en-dehors du cadre fixé par sa mission d'éradication de l'habitat insalubre, a été prise pour un motif erroné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en raison de l'illégalité de la délibération précitée du 9 mars 2006, l'arrêté en date du 28 décembre 2006 portant déclaration d'utilité publique de l'immeuble sis 3 et 5 rue de Godefroy Cavaignac est entaché d'illégalité, de même, par voie de conséquence, que l'arrêté en date du 11 juillet 2007 portant déclaration de cessibilité de cet immeuble ».
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés