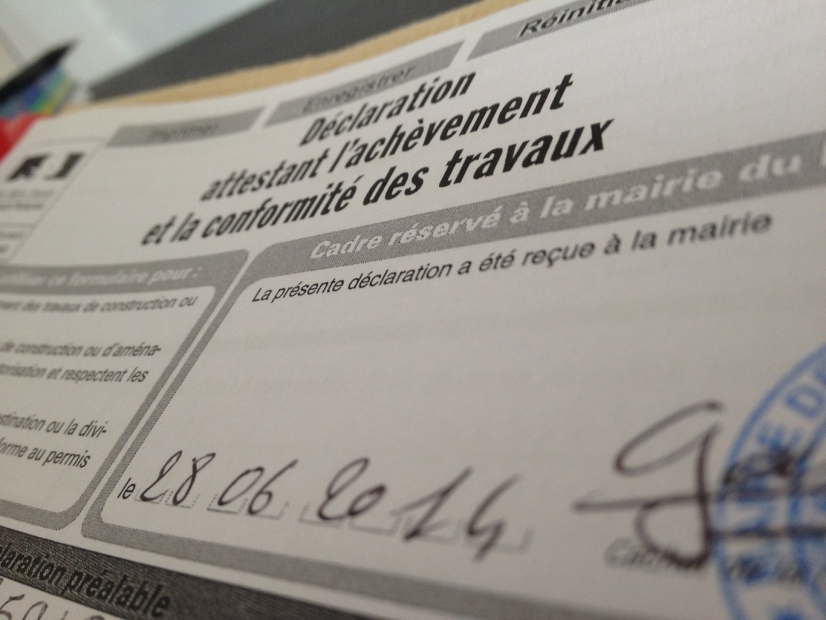Veille administrative – Réponse ministérielle : Bonne foi du requérant & Recours abusif

Texte de la question publiée au JO le : 26/04/2011 page : 4163
« M. Raymond Durand attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conséquences de l'augmentation des procédures de recours en matière d'autorisations du droit des sols. Ces procédures, le plus souvent déclenchées par les associations de protection de la nature et/ou particuliers, revêtent un caractère systématique notamment lorsqu'il s'agit d'autorisations préalables ou de permis de construire relevant de leurs sphères d'influence. Elles engendrent un coût financier non négligeable, tant pour les collectivités que pour les administrés et entreprises. Les délais de jugement étant relativement longs en raison de l'engorgement des tribunaux administratifs, les projets concernés sont bloqués ce qui n'est pas sans conséquences sur la situation de l'emploi. L'intervention d'avocats spécialisés représente un coût non négligeable dans la mesure où aucune indemnité compensatrice n'est due à la collectivité quelle que soit l'issue de la procédure. Le contribuable est, quant à lui, doublement pénalisé, ces associations étant très souvent subventionnées par l'État et/ou collectivités territoriales. Aussi, dans un souci de protection des finances publiques, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette question et les mesures qu'il envisage de prendre afin de réduire notablement la recevabilité des recours intentés dans ce domaine ».
Texte de la réponse publiée au JO le : 23/08/2011 page : 9189
« Tout d'abord, la juridiction administrative a effectué un effort considérable pour réduire ses délais moyens de traitement de l'ensemble des affaires qui lui sont soumises. Le délai moyen de jugement par les tribunaux administratifs a ainsi diminué de trois mois entre 2007 et 2010, pour s'établir aux alentours de onze mois en 2010. On ne peut donc parler d'engorgement des tribunaux administratifs. En outre, les recours contentieux à l'encontre des autorisations d'urbanisme n'étant pas suspensifs, ils n'ont pas pour effet de geler les projets contestés. Ce gel résulte du choix du titulaire de l'autorisation de ne pas initier les travaux prévus, ce qui a pour effet pernicieux d'encourager la multiplication des recours dilatoires. S'agissant du coût, pour les collectivités, des recours contre leurs autorisations d'urbanisme, il convient de rappeler que, s'agissant d'un contentieux de la légalité, elles peuvent assurer elles-mêmes leur défense, la représentation par un avocat devant le tribunal administratif n'étant pas obligatoire pour ce type de contentieux (art. R. 431-2 du code de justice administrative). La condamnation de la partie perdante au paiement des frais irrépétibles relève de la libre appréciation du juge. En effet, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour condamner la partie perdante d'une instance au paiement des frais irrépétibles, « le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Dès lors que cette appréciation doit reposer sur des considérations d'équité et tenir compte de la situation économique de la partie perdante, il n'est pas anormal que ces dispositions ne soient pas appliquées de manière symétrique selon que celle-ci est une personne physique ou une collectivité territoriale. Cela ne fait cependant pas obstacle à ce que la collectivité défenderesse porte à la connaissance du tribunal administratif la nature et le montant des frais qu'elle a été amenée à exposer à raison de l'instance. Enfin, le Gouvernement n'envisage pas de prendre des mesures visant à réduire la recevabilité des recours. Celles-ci risqueraient de porter atteinte au droit à un recours effectif, protégé tant constitutionnellement (art. 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789) que conventionnellement (art. 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme). Elles auraient en outre pour effet de pénaliser l'ensemble des requérants, alors que l'immense majorité d'entre eux est de bonne foi ».
Outre que la réponse ministérielle susvisée n’est pas nécessairement révélatrice de ce que pourrait être le contentieux des autorisations d’urbanisme à l’issue de la prochaine réforme liée à « l’urbanisme de projet », celle-ci doit être nuancée en ce qu’elle précise qu’un renforcement des conditions de recevabilité des recours aurait « pour effet de pénaliser l'ensemble des requérants, alors que l'immense majorité d'entre eux est de bonne foi » et induit ainsi, au regard de l’économie générale de cette réponse, qu’un recours exercé par un requérant de bonne foi ne présente pas un caractère abusif, alors que, même si l-on peut partager ce constat de fait sur les intentions d'une majorité de requérants, tel n’est pas nécessairement le cas.
Bien que cette réponse n’aborde pas cette question, qui ne lui était d’ailleurs pas posée, il faut en effet rappeler que l’auteur d’un recours en annulation à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme n’agit pas en totale impunité puisque non seulement il peut se voir condamner par le juge administratif, outre au paiement des frais dits irrépétibles (mais qui, donc, le sont), à une amende pour recours abusif (art. R.742-1 ; C.urb) mais qu’en outre celui-ci peut lui-même s’exposer à une action civile pour recours abusif qui sera le plus souvent exercée par le titulaire de l’autorisation d’urbanisme contestée et ce, sur le fondement de l’article 1382 du Code de civil ; le caractère abusif de son recours étant alors appréciée au regard de l’article 32-1 du Code de procédure.
Or, si est vrai que traditionnellement la jurisprudence considérait que l’exercice d’une action en justice ne dégénérait en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que si cette action procédait d’une mauvaise foi caractérisée ou d’une erreur grossière équivalente au dol (voir pour exemple : Cass. Civ, 19 octobre 1943, S. 1944, I, p.43), il reste que tel n’est plus le cas.
En effet, l’exigence systématique d’une faute grossière ou dolosive a été abandonnée par la Cour de cassation, laquelle considère dorénavant qu’une « simple légèreté blâmable » peut constituer une faute au sens des articles.32-1 du Code de procédure civile et e l’article 1382 du Code civil (voir pour exemple : Cass. 30 octobre 1968, JCP. 1969, II, p. 19954 ; Cass. 12 janvier 1976, JCP. 1977, II, p. 18378 ; Cass. 5 mai 1978, Bull. II, n° 416).
Ainsi toute faute dans l’exercice d’une voie de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur (Cass. civ., 18 janvier 2001, pourvoi n°00-12.230) puisqu’à titre d’exemple et à l’encontre de l’auteur d’un recours en annulation à l’encontre d’un permis de construire, la Cour de cassation a pu jugé que :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont saisi le tribunal administratif de Marseille de plusieurs procédures pour solliciter le sursis à exécution et l'annulation de deux permis de construire délivrés à MM. Z..., propriétaires de parcelles contiguës à leur immeuble ; qu'ils se sont désistés des appels formés contre les jugements ayant rejeté leurs demandes ; que MM. Z... les ont assignés en responsabilité et dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que, si l'exercice d‘une action en justice peut être constitutif d'abus, celui qui s'en prévaut doit démontrer que ce droit a été exercé dans l'intention de nuire, cette intention pouvant se caractériser dès lors que le titulaire de ce droit ne devait en tirer aucun avantage ni aucune utilité appréciable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass. civ., 11 septembre 2008, pourvoi n°07-18.483) ;
En résumé, la bonne foi du requérant de l’affranchit pas des conséquences éventuelles de la faute qu’il a pu commettre dans l’exercice de son recours.
Et pour le reste, on est heureux d’apprendre à la lecture de cette réponse que « les recours contentieux à l'encontre des autorisations d'urbanisme n'étant pas suspensifs, ils n'ont pas pour effet de geler les projets contestés » et, donc, qu’en fait, « ce gel résulte du choix du titulaire de l'autorisation de ne pas initier les travaux prévus », si bien qu’ainsi, c’est ce choix « qui a pour effet pernicieux d'encourager la multiplication des recours dilatoires » ; étant toutefois précisé que même à l’admettre « ce choix » ne s’opposera pas à ce que le pétitionnaire obtienne du requérant la réparation des préjudices susceptibles de résulter de ce gel (Cass. civ. 2 décembre 2008, pourvoi n°07-19.645).
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés