Quels sont les éléments de construction à prendre en compte pour apprécier l’implantation d’un bâtiment par rapport aux limites séparatives ?

Dès lors qu’un abri de jardin et une marquise sont indissociables du bâtiment d’habitation, ceux-ci doivent être pris en compte pour apprécier si ce bâtiment est ou non implanté en limite séparative.
CE. 8 juillet 2011, Claude A…, req. n°317.462
Dans cette affaire, le propriétaire d’une maison individuelle avait formulée une déclaration préalable de travaux en vue de « la construction d'un abri de jardin et d'une marquise attenants à » son pavillon. Cette déclaration donna lieu à un arrêté de non-opposition, lequel devait faire l’objet d’un recours en annulation exercé par un voisin contestant la régularité du projet au regard des prescriptions de l’article UE.7.1.2 du POS communal relatives à l’implantation des bâtiments en retrait des limites séparatives.
Toutefois, ce recours devait être rejeté par le Tribunal administratif de Versailles pour un motif que devait donc ultérieurement confirmé le Conseil d’Etat pour la raison suivante :
« Considérant qu'aux termes du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry ART. UE 7. -Implantation des Constructions par Rapport aux Limites Séparatives / 7.1. -Bâtiments d'habitation : / Ces constructions sont autorisées : / 7.1.1. -Sur les limites séparatives, si la façade sur la limite ne comporte pas de baies autres que des jours de souffrance. / 7.1.2. En retrait des limites séparatives : dans ce cas, elles devront s'écarter des limites d'une distance égale : / à un minimum de 8 m si la façade sur la limite comporte des baies principales, cette distance étant mesurée normalement à la façade, / à un minimum de 3 m en tout point. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Versailles qu'en estimant que l'abri de jardin et la marquise à construire sur la propriété de M. B constitueraient des éléments indissociables du pavillon existant, prolongeant son implantation jusqu'à la limite séparative du fonds propriété de M. A, celui-ci n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ; qu'en jugeant par suite que les prescriptions de l'article UE 7.1.2. du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry ne pouvaient s'appliquer au cas de l'espèce, le tribunal administratif de Versailles n'a pas davantage commis d'erreur de droit ; qu'il n'appartenait pas par ailleurs aux juges du fond d'examiner d'office la conformité de l'arrêté aux dispositions de l'article UE 7.1.1. du plan d'occupation des sols dont la violation n'était pas invoquée devant eux par le requérant ; que ce dernier ne saurait utilement se prévaloir de ce moyen nouveau devant le juge de cassation ».
Cet arrêt confirme tout d’abord que l’ensemble des éléments de construction d’un bâtiment doivent être pris en compte pour apprécier l’implantation de celui-ci dès lors qu’ils en sont indissociables (pour exemples sur des escaliers extérieurs : CAA. Paris, 30 décembre 2010, EFIDIS, req. n°P9VE01798. CAA. Marseille, 27 novembre 2008, Françoise Z, req. n°06MA02699. Voir également, sur le muret d’une rampe d’accès : CAA. Nancy, 11 octobre 2007, Cne de Wolfisheim, req. n°06NC00685), y compris lorsque ces éléments ne sont pas en eux-mêmes des bâtiments. A titre d’exemple, le Conseil d’Etat avait déjà jugé que :
« Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Venosc relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'escalier de secours extérieur et l'auvent qui le surmonte, tels qu'ils sont autorisés par le permis de construire en cause, forment une saillie située au milieu de la façade ouest du bâtiment et que l'escalier est implanté en limite séparative ouest de la parcelle d'assiette de l'immeuble, et à une distance de 6 mètres de la limite séparative nord de cette parcelle ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'escalier et l'auvent doivent être regardés comme des éléments indissociables de l'immeuble lui-même ; que, par suite, et dès lors que le bâtiment ainsi décrit se trouve implanté en limite séparative ouest de la parcelle, la distance le séparant de la limite parcellaire nord n'a pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, à être prise en considération pour l'application de ces dispositions ; que la commune de Venosc et L'ASSOCIATION LE FONVAIROUS sont, par suite fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, le permis de construire litigieux » (CE. 23 août 2006, Assoc. Le Fonvairous, req. n°267.578).
Le seul fait de prévoir un élément de construction indissociable implanté en limite séparative permet donc de faire regarder l’ensemble du bâtiment comme sis en limite séparative et ce, quelles que soient la nature et l’importance de cet élément et donc, indépendamment, de toute considération liée au caractère éventuellement « artificiel » d’un tel aménagement au regard de l’objet et de la finalité de la règle en cause. D’ailleurs, ce mode d’appréciation a également vocation à être mise en œuvre pour à l’égard des autorisations de régularisation puisqu’à titre d’exemple il a pu être récemment jugé que :
« Considérant que, par un arrêté du 2 août 2004, le maire de Villeneuve de Marc a, autorisé M. A et à Mlle B à édifier une maison d'habitation ; que l'exécution de ce permis a été suspendue par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble du 27 octobre 2004 ; qu'après avoir retiré ce permis par arrêté du 7 décembre 2004, le maire a délivré à M. A et Mlle B le permis litigieux qui, à la différence du premier permis retiré, prévoit la réalisation d'une terrasse venant jouxter au nord-ouest la limite séparative ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cette terrasse aménagée en avancée mais bien intégrée au reste de la construction ne fait pas obstacle à ce que l'ensemble de la construction soit regardée comme implantée sur la limite séparative ; que, par suite, le maire de la commune de Villeneuve d'Arc n'a pas méconnu les dispositions de l'article UB 7 précité du POS en délivrant un permis de construire M. A et à Mlle B » (CAA. Lyon, 28 décembre 2010, Albert C., req. n°08LY02249).
Mais ensuite, il n’est pas inintéressant de relever que l’article 7.1 du POS communal avait spécifiquement trait aux bâtiments d’habitation.
Or, s’il est vrai que les articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l’urbanisme disposent que « les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal », il reste que ces dispositions ne concernent que le champ d’application des autorisations de travaux sur construction existante et, par voie de conséquence, édictent une règle d’ordre procédural qui n’a a priori pas vocation à valoir pour l'application des règles de fond édictées en considération de la destination de l’ouvrage.
Pour autant, le Conseil d’Etat semble donc avoir considéré que dans la mesure où le pavillon existant, d’une part, et la marquise et l’abri de jardin projetés d’autre part, étaient indissociables, cet ensemble devait être considéré pour son tout comme un bâtiment d’habitation au sens de l’article 7.1 du POS communal.
Enfin, il faut s’intéresser à la raison pour laquelle cet ensemble a été qualifié d’indissociable.
Dès lors qu’il n’y avait aucun rapport d’interdépendance fonctionnelle entre ce pavillon, cette marquise et cet abri de jardin – lequel aurait d’ailleurs été sans incidence à l’égard des modalités d’application de l’article 7 d’un règlement local d’urbanisme – ce ne peut bien entendu être qu’en raison du « lien physique » les unissant.
Or, en l’espèce, la marquise et l’abri de jardin à aménager n’étaient pas structurellement liés à la maison existante mais en étaient seulement « attenants », ce qui a donc néanmoins suffit pour les considérer comme indissociables.
Mais ce constat vaut à notre sens également pour ce qui concerne la caractérisation du « lien physique » pouvant participer à la constitution d’un ensemble immobilier unique au sens de l’arrêt « Ville de Grenoble ».
En effet, la règle de principe maintenue par cet arrêt – selon laquelle un tel ensemble doit relever d’un permis de construire unique – explique également selon nous la règle selon laquelle toute modification d’un projet de construction en cour d’exécution doit à tout le moins donner lieu à un « modificatif » alors même que cette modification relèverait isolément du champ d’application de la déclaration préalable (CAA. Marseille, 15 mai 2008, SCI Les Hautes Terres, req. n°05BX02700) puisqu’à défaut un tel projet relèverait de deux autorisations distinctes ; étant rappelé qu’un permis de construire et ses « modificatifs » forment pour leur part une autorisation unique (CAA. Paris, 30 octobre 2008, M. Gilbert Y., req. n°05PA04511).
Il reste que cette règle procédurale ne s’impose que lorsque l’aménagement modificatif projeté est « attenant ou structurellement lié » à la construction en cours d’exécution (CE. 9 janvier 2009, Ville de Toulouse, ADJA n°11/2009).
D’une façon générale, deux constructions ou éléments de construction qui nous ne pas être structurellement liés sont néanmoins attenants sont donc en principe indivisibles au regard du droit de l’urbanisme.
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés


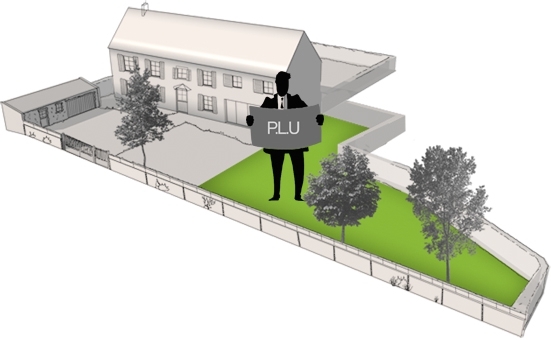

 Dans cette affaire, l’association requérante avait obtenu un permis de construire un foyer d’hébergement sur un terrain d’une superficie de 5.230 mètres carrés, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l’article 5 du POS subordonnant la constructibilité des terrains à la condition qu’ils présentent une superficie supérieure à 4.000 mètres carrés. Il reste qu’à l’origine l’association était propriétaire de deux unités foncières distinctes – voisines mais séparées par une bande de terre tierce – dont chacune présentait une superficie inférieure à ce seuil.
Dans cette affaire, l’association requérante avait obtenu un permis de construire un foyer d’hébergement sur un terrain d’une superficie de 5.230 mètres carrés, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l’article 5 du POS subordonnant la constructibilité des terrains à la condition qu’ils présentent une superficie supérieure à 4.000 mètres carrés. Il reste qu’à l’origine l’association était propriétaire de deux unités foncières distinctes – voisines mais séparées par une bande de terre tierce – dont chacune présentait une superficie inférieure à ce seuil.