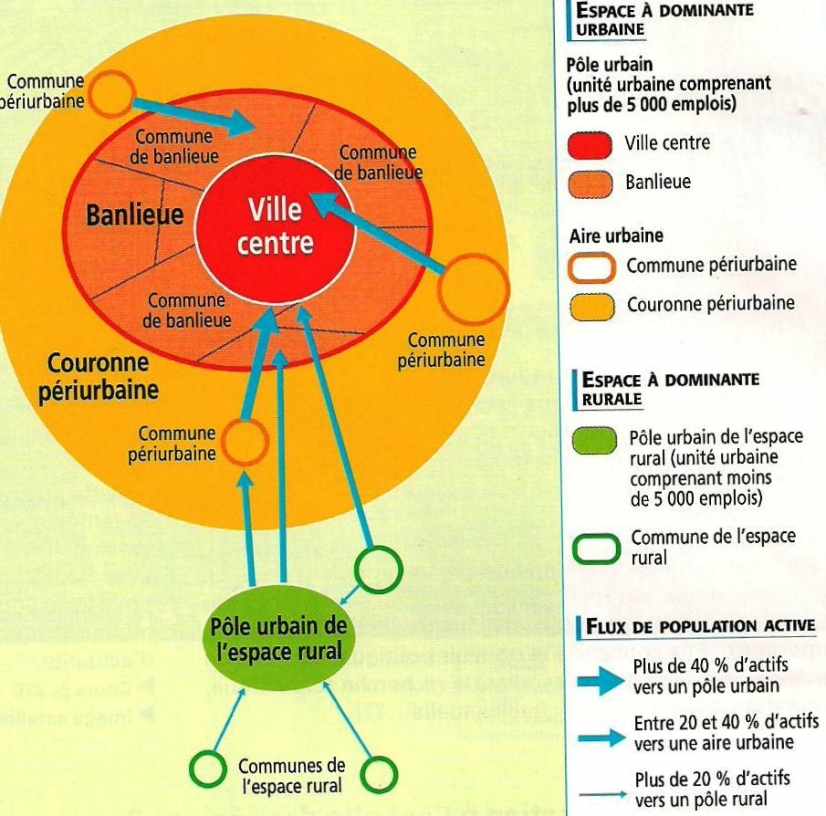INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :
CE. 26 décembre 2012, Cne de Montrouge, req. n°347.458
« Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UEb 6.5 du règlement de plan d'occupation des sols de la commune de Montrouge, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance des arrêtés litigieux : " A l'exception des plantations et des garages (...), aucune construction du sol ni du sous-sol n'est autorisée dans les marges de reculement de type A. " ;
Considérant qu'aucun texte ni principe ne fait par lui-même obstacle à ce que les règlements des plans d'urbanisme prescrivent, pour des motifs d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, des interdictions de construire, y compris en sous-sol, dans les marges de reculement qu'ils définissent ; qu'il résulte des dispositions rappelées au point 2 que toutes les constructions en sous-sol sont interdites dans les marges de reculement de type A, sans qu'il soit opéré de distinction entre celles entièrement enterrées et celles qui comportent des parties aériennes ; que, par suite, en jugeant que les dispositions de l'article UEb 6.5 précitées s'opposaient à la présence d'un local technique de ventilation en sous-sol entièrement enterré dans la marge de reculement de type A de la construction projetée, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ou d'une erreur de qualification juridique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'aucune exception n'est prévue à la règle d'inconstructibilité dans les marges de reculement de type A instituée par le règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, en relevant que la terrasse dallée, dont la construction était également projetée dans la même marge de reculement, était indissociable de l'immeuble faisant l'objet de la demande de permis de construire, puis en jugeant que les dispositions de l'article UEb 6.5 s'opposaient également à la réalisation de cet ouvrage, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur de qualification juridique ».
CAA. Lyon 13 novembre 2012, SARL Proponnet, req. n°11LY00956
« Considérant que, pour annuler le permis de construire, délivré le 24 août 2009 à la SARL Proponnet par le maire de Beaurepaire, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le fait que la centrale d'aspiration autorisée, qui ne pouvait pas faire l'objet d'une adaptation mineure rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, constituait un bâtiment au sens de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme qui excédait par sa hauteur, soit 7,76 mètres la hauteur maximale autorisée par les dispositions précitées de ce document d'urbanisme ;
4. Considérant qu'il ressort du plan de coupe de la centrale d'aspiration et de dépoussiérage, des plans de façade de l'ouvrage et des photographies jointes au volet paysager figurant au dossier de demande de permis de construire présentée par la SARL Proponnet que le bâtiment litigieux est essentiellement constitué par une machinerie du sol au sommet du toit et ne comporte aucun ouvrage technique accessoire, tels que cheminée ou autre super-structure pouvant être exclus de la hauteur maximale autorisée pour l'application de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Beaurepaire ; que cette construction ne peut non plus être regardée dans son ensemble comme un ouvrage technique au sens des mêmes dispositions ».
CE. 29 octobre 2012, Association culture et citoyenneté, req. n°332.257
« 2. Considérant, en premier lieu, que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Torcy, dans sa rédaction en vigueur à la date du 18 août 2003, présente la zone 1NA comme " réservée à une urbanisation future destinée, en fonction du secteur de zone, aux habitations et à leurs équipements d'accompagnement, aux activités sportives et de loisirs ou aux activités économiques " et divisée en sept secteurs, dont " le secteur 1NAx, destiné à l'accueil du futur boulevard urbain, à la réalisation d'une aire des gens du voyage, aux activités et aux bureaux " ; que l'article 1NA 1 de ce règlement, qui précise les occupations et utilisations du sol admises dans la zone 1NA, comporte un tableau mentionnant, pour chaque secteur de la zone, les constructions autorisées ; que ce tableau indique, pour le secteur 1NAx, "activités - boulevard urbain - bureaux - aire des gens du voyage - logements liés au fonctionnement des activités " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces mentions que le plan d'occupations des sols n'excluait pas de la zone 1NA les activités cultuelles ; que, par suite, en jugeant que seules étaient admises dans le secteur 1NAx les activités économiques à l'exclusion des activités sportives et de loisirs et que la construction d'un édifice cultuel ne figurait pas au nombre des occupations et utilisations du sol admises, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " (...) La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire (...) " ; que l'article 1 NA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Torcy prévoyait la réalisation, en ce qui concerne les établissements recevant du public autres que ceux qu'il énumérait, d'une place de stationnement pour 20 m² de surface hors oeuvre nette ; qu'il est constant que la construction autorisée par le permis de construire délivré à l'association requérante, qui portait sur une surface hors oeuvre nette de 1567 mètres carrés et prévoyait la réalisation de 80 places de stationnement, satisfaisait à ces prescriptions ; que la cour a estimé que le permis délivré était entaché d'un erreur d'appréciation au regard de l'appréciation des besoins de stationnement de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que, cependant, la satisfaction des exigences de l'article R. 111-4, relatives au stationnement, par les dispositions du permis de construire litigieux, était assuré par ses dispositions qui exigeaient le nombre de places prévu par le règlement du plan d'occupation des sols dont il n'était pas allégué qu'il n'auraient pas adéquatement apprécié les besoins de stationnement mentionné à l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a entaché sur ce point son arrêt d'une erreur de droit ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l'article 1NA 10 du règlement du plan d'occupation des sols prévoyaient que la hauteur des constructions était mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit ou jusqu'au sommet de la construction, cheminées et autres superstructures exclues, et limitaient à 10 mètres à l'égout du toit la hauteur maximale des constructions dans le secteur 1NAx ; que l'annexe 1 au règlement du plan d'occupation des sols définissait les superstructures comme des ouvrages techniques de faible emprise tels les souches de cheminées, les machineries d'ascenseurs et les paratonnerres ; que la cour a jugé que le permis de construire litigieux méconnaissait ces dispositions eu égard à la hauteur prévue, de 14 mètres, du minaret de la mosquée ;
9. Considérant, d'une part, que la cour, qui, contrairement à ce que soutient l'association requérante, n'a pas jugé que seuls les souches de cheminées, les machineries d'ascenseurs et les paratonnerres pouvaient être regardés comme des superstructures, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossiers en estimant que le minaret, alors même qu'il n'avait pas pour fonction d'assurer le clos et le couvert, ne pouvait être regardé, compte tenu de ses caractéristiques, comme une superstructure au sens des dispositions de l'article 1NA 10 mais devait être pris en considération au titre de la totalité de sa hauteur ».
CAA. Nancy, 25 octobre 2012, Cne d’Erstien, req. n°11NC01764
« Considérant qu'aux termes de l'article 12 UB règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Erstein : " le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. 1. Le nombre de places à réaliser doit répondre aux normes suivantes : type d'occupation du sol (...) Autres équipements : centre culturel, salle de réunion : pour 5 places : nombre de places : 1 (...) Equipements publics non précisés ci-dessus : défini au cas par cas en fonction des besoins estimés; 3. Cas de travaux entrainant un changement de destination des locaux : Les normes indiquées à l'alinéa 1 ci-dessus sont à applique (...) " ;
3. Considérant que le 22 mars 2010, l'association culturelle et sportive franco turque a déposé une demande de permis de construire pour la " création par changement d'affectation d'un lieu de culte dans un ancien local industriel et portant agrandissement partiel " ; que la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la sous préfecture de Sélestat-Erstein, consultée sur ce projet, a, dans un procès verbal en date du 8 juillet 2010, relevé, conformément au dossier présenté par l'association, que " l'établissement " Mosquée Turque " exploité par l'association culturelle franco-turque est un établissement de troisième catégorie comportant un effectif de 404 personnes " et " (...) qu'il comprend une salle de prière de 149 m², 2 salles culturelles de 23 et 21 m², une salle commune de 63 m² avec une cuisine, un bureau, un local de rangement, des sanitaires, un logement de deux pièces (...) " ;
4. Considérant que si la commune d'Erstein soutient qu'elle peut définir, au regard des dispositions du 1° de l'article UB12 précité relatives aux " établissements publics non précisés " , le nombre de places de stationnement nécessaires, et fait valoir que le service instructeur de la ville a estimé que le projet rentrait dans la rubrique " équipements publics non précisés ", il ressort toutefois, tant des statuts de l'association culturelle et sportive franco-turque d'Erstein et environs que de la présentation sur internet des activités de l'association pétitionnaire, qu'elle entend y créer, entre autres activités " un centre culturel, cultuel et sportif ", mettre en place " un soutien scolaire et une salle de formation " ainsi que " des actions pour coopérer avec les différents représentants des associations, mairie ... " et " promouvoir la connaissance de la Turquie, encourager et valoriser la production artistique et littéraire des jeunes talents, partager les connaissances cultuelles et encourager les manifestations culturelles " ; que, nonobstant l'objet susrappelé de la demande de permis de construire, l'équipement projeté par l'association, qui ne porte pas uniquement sur un lieu de culte, comme il vient d'être dit, doit ainsi être regardé comme étant à vocation principalement culturelle ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, pour le calcul des places de stationnement nécessaires, les dispositions de l'article 12 UB relatives aux " autres équipements - centre culturel, salle de réunion " devaient s'appliquer ».
CE. 8 octobre 2012, Cne de Lunel, req. n°342.423
« Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. " ; que l'article 5 de la Charte dispose : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. " ; que par ailleurs, l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui se réfère au principe de précaution " selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions ainsi rappelées que le principe de précaution s'applique aux activités qui affectent l'environnement dans des conditions susceptibles de nuire à la santé des populations concernées ; que, par suite, en jugeant, par un motif qui n'était pas surabondant, que la circonstance, à la supposer établie, que les champs radioélectriques émis par les relais de téléphonie mobile porteraient atteinte à la santé humaine n'était pas de nature à faire regarder les dispositions de l'article 5 de la Charte comme ayant été méconnues, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que la commune de Lunel est, dès lors, fondée à demander pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation du jugement qu'elle attaque ».
PLU/POS & « Assimilés » :
CE. 14 novembre 2012, Mandelieu La Napoule, req. n°342.327
« 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;
5. Considérant que la cour a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que la commune avait adressé aux membres du conseil municipal une note relative à la révision du plan local d'urbanisme, synthétisant les différentes étapes de sa procédure d'adoption, mentionnant l'avis favorable du commissaire enquêteur et proposant de tenir compte de certaines observations des personnes consultées à l'issue de l'enquête publique ; que cette note était notamment accompagnée d'un document portant sur les modifications pouvant être apportées au plan pour donner suite à ces différentes remarques, dont une rubrique mentionnait le projet de création d'un secteur Nx autorisant les affouillements et exhaussements de sol au titre des installations et travaux divers et proposait une modification du règlement du plan par l'adjonction d'un article N 2-8 ainsi rédigé : " Sont admis dans les seuls secteurs Nx/ - les dépôts de matériaux inertes à l'exclusion de toute structure technique destinée à l'accueil des déchets " ; qu'en jugeant que, en dépit de la communication de ces différents documents et nonobstant la très faible superficie, de quelques 3 hectares, du secteur dont s'agit, qui représentait moins d'un millième de celle de la commune, il n'avait pas été satisfait à l'obligation prescrite par l'article L. 2121-12, faute pour les membres du conseil municipal de connaître les motifs du choix de ce secteur et d'avoir disposé d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de l'emplacement retenu pour ce site d'accueil de déchets inertes, la cour s'est méprise sur la portée cet article, qui n'imposait nullement de telles justifications ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et a ainsi commis une erreur de droit ».
CE. 12 novembre 2012, Agence Charles Katz, req. n°344.365
« Considérant que, selon le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Louveciennes, la zone UG est une zone à caractère principal d'habitat individuel dans laquelle sont admises les " maisons d'habitation individuelles " ; qu'aux termes des dispositions de l'article UG 5 A de ce règlement, applicables au secteur UGa : " (...) le nombre de maisons individuelles que peut contenir une parcelle ne peut dépasser / - une maison par parcelle de 1 000 mètres carrés au moins ; / une maison supplémentaire par tranche de 750 mètres carrés au-delà des 1 000 mètres carrés de base contenus dans cette même parcelle, à la condition qu'il n'y ait ni division, ni détachement de parcelle. " ;
2. Considérant que si ces dispositions ont légalement limité la densité de l'habitat dans la zone à laquelle elles s'appliquent, elles n'ont pas pour objet et n'auraient pu légalement avoir pour effet de limiter le nombre de logements que ces constructions peuvent comporter ;
3. Considérant, par suite, que si le nombre de logement que comporte une construction est au nombre des critères qui permettent de la caractériser comme " maison individuelle " au sens de l'article UG 5 A cité ci-dessus du règlement du plan d'occupation des sols de Louveciennes, la cour a cependant entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant qu'une " maison individuelle " au sens de cet article ne pouvait comporter qu'une seule unité d'habitation, et en assimilant en conséquence une demande de permis de construire pour une maison individuelle comportant trois logements à une demande de permis de construire pour trois maisons individuelles au sens de cet article ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, son arrêt doit être annulé ».
CE. 7 novembre 2012, Ministre de l’écologie, req. n°3337.755
« 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les documents graphiques des plans de prévention des risques naturels prévisibles, dont les prescriptions s'imposent directement aux autorisations de construire, doivent, au même titre que les documents d'urbanisme, être suffisamment précis pour permettre de déterminer les parcelles concernées par les mesures d'interdiction et les prescriptions qu'ils prévoient et, notamment, d'en assurer le respect lors de la délivrance des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol ; que ces dispositions n'ont, toutefois, ni pour objet ni pour effet d'imposer que ces documents fassent apparaître eux-mêmes le découpage parcellaire existant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les documents graphiques du plan de prévention des risques naturels prévisibles de type inondation de la vallée du Gapeau comportaient, en l'espèce, un tracé suffisamment précis des limites des différentes zones que le plan avait pour objet de délimiter ; que, par suite, en estimant que les documents graphiques du plan de prévention des risques naturels prévisibles ne permettaient pas de reporter sur chaque parcelle cadastrale les éventuelles servitudes dont elle était grevée, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ».
DROITS DE PREEMPTION :
CE. 26 octobre 2012, Pascale B…, req. n°346.947
« 4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption (...) sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement " ; qu'aux termes de l'article L. 212-2 du même code, dans sa version alors applicable : " Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, (...) est ouvert à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation (...) / L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'acte de création d'une zone d'aménagement différé, qui rend applicable au sein de cette zone les dispositions du code de l'urbanisme qui régissent l'exercice du droit de préemption, constitue une base légale des décisions de préemption prises dans son périmètre ; que l'illégalité de cet acte est, par suite, susceptible d'être utilement invoquée au soutien de conclusions dirigées contre une décision de préemption ; que toutefois cet acte, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, ne forme pas avec les décisions individuelles de préemption prises dans la zone une opération administrative unique comportant un lien tel que les illégalités qui l'affecteraient pourraient, alors même qu'il aurait acquis un caractère définitif, être régulièrement invoquées par la voie de l'exception »
LOTISSEMENT & DIVISIONS FONCIERES :
CAA. Bordeaux, 4 décembre 2012, req. n°11BX02650
« Considérant que, comme qu'il a été dit, l'arrêté du 26 avril 2010 a pour objet de changer la vocation du lotissement en litige, en le destinant à recevoir des activités à caractère libéral, commercial et artisanal, alors que le permis d'aménager délivré le 30 avril 2009 réservait les lots à un usage d'habitation, excluant toute activité à l'exception, à titre dérogatoire et seulement pour une partie de l'habitation, de l'exercice d'une profession libérale ; que, compte tenu de l'importance du changement ainsi autorisé, l'autorisation du 26 avril 2010 doit être regardée, non comme un simple modificatif du permis délivré le 30 avril 2009, mais comme un nouveau permis se substituant au premier ; que la circonstance que cet acte ait été inexactement qualifié de permis modificatif n'implique pas, par elle-même, qu'il soit illégal ».
TRAVAUX SUR EXISTANT :
CAA. Versailles, 18 octobre 2012, jean-Michel A…, req. n°11VE00980
« Considérant qu'aux termes de l'article UA1-II du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Orgeval : " Sont notamment admises les occupations et utilisations des sols ci-après : 1. Les constructions anciennes à usage d'habitation pourront, si elles sont en trop mauvais état pour être restaurées, être reconstruites avec toutes leurs caractéristiques quelles que soient les surfaces des parcelles sur lesquelles elles sont édifiées. Une extension mesurée pour travaux d'habitabilité sera admise sans toutefois dépasser le COS de la zone. / 2. Les constructions nouvelles à usage d'habitation, y compris leurs annexes, les équipements collectifs, les locaux de commerce et d'artisanat, des emplacements de stationnement de véhicules, sous réserve des conditions fixées au § III ci-après. " ; qu'aux termes de l'article UA5 du même plan : " Pour supporter une construction individuelle nouvelle, toute parcelle doit avoir une superficie au moins égale à 400 m² (...) Dans le cas d'extension de construction existante, il ne sera pas fait application de la surface minimale sous réserve du respect des autres règles. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux tend, en fait, à la construction d'une nouvelle maison de 190,75 m² de surface hors oeuvre brute après démolition partielle de trois constructions existantes d'un total de 49,48 m² de surface hors oeuvre brute dont, selon le dossier de demande de permis, seulement 16,58 m² de surface hors oeuvre nette correspondaient à une ancienne habitation ; qu'ainsi le bâtiment, objet de la demande de permis de construire, n'est pas un simple agrandissement de la construction existante mais constitue, après destruction autorisée par un permis de démolir délivré le 8 septembre 2007 de la majeure partie des constructions anciennes, une construction essentiellement nouvelle sans rapport, tant par sa conception que par son importance, avec l'existant ; que, dans ces conditions, nonobstant l'absence de limite posée par le plan d'occupation des sols à l'accroissement de la surface des constructions existantes, et même si la nouvelle construction devait être édifiée à l'emplacement de l'un des deux bâtiments qui avaient été démolis, celle-ci ne pouvait être regardée comme constituant une extension pour laquelle aucune superficie minimale de parcelle n'était requise par l'article UA 5 mentionné ci-dessus ; qu'il suit de là qu'eu égard à la superficie du terrain d'assiette, dont il est constant qu'elle était inférieure à 400 m2 , la construction envisagée ne pouvait être autorisée ».
PARTICIPATIONS D’URBANISME :
CE. 10 décembre 2012, Marie-Hélène B…req. n°338.708
« Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juillet 1985 applicable à la date de l'arrêté contesté : " L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire. / Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d'une taxe ou d'une contribution aux dépenses d'équipements publics " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre du pourvoi de la commune de Brétigny-sur-Orge tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris l'ayant condamnée à verser à la société la totalité de la participation mise à sa charge au titre de la réalisation du lotissement par l'arrêté du 18 juin 1986 et par un commandement de payer du 15 juin 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé par la décision du 16 février 2005 que les contributions avaient été imposées au lotisseur par la commune en violation des dispositions du code de l'urbanisme alors applicables et qu'elles étaient réputées sans cause ; que, dès lors, en retenant que le maire de cette commune avait pu prendre, le 20 mai 2005, sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme, un arrêté mettant à la charge du lotisseur une nouvelle contribution aux dépenses d'équipements publics, alors que les dispositions de cet article imposent à l'autorité qui a délivré l'autorisation d'urbanisme de prendre un nouvel arrêté portant la prescription d'une telle contribution, sous réserve que les dispositions du code de l'urbanisme applicables à la date de l'arrêté initial le permettent, uniquement dans le cas où la participation financière est annulée pour illégalité et non dans l'hypothèse où elle a été réputée sans cause, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, Me B est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué »
AUTORISATIONS D’URBANISME :
CAA. Lyon, 18 décembre 2012, Mlle Dominique, req. n°12LY00016
«9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'aux termes de ce dernier article : " Les demandes de permis (...) sont adressées (...) : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de démolir, et notamment de l'indication selon laquelle le mur mitoyen existant sur la parcelle cadastrée AL 114 sera conservé sur une hauteur de 4,25 mètres et de la photographie des lieux mentionnant une " arase du mur conservé ", que les travaux de démolition projetés devaient affecter ce mur mitoyen ; qu'en attestant avoir qualité pour présenter la demande d'autorisation, alors qu'il savait que les travaux portaient sur un mur mitoyen, hypothèse dans laquelle, en application de l'article 662 du code civil, les travaux ne peuvent être entrepris qu'avec le consentement de l'autre copropriétaire, le maire, dans les circonstances particulières de l'espèce, liées au fait qu'il lui incombait de statuer sur la demande, s'est livré à une manoeuvre destinée à donner une apparence de légalité au permis demandé ; que, dès lors, Mlle est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, délivré dans ces conditions, est entaché d'illégalité ;
23. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 par lequel le maire de la Voulte-sur-Rhône a délivré un permis de démolir à la commune et tant que cet arrêté autorise des travaux sur le mur mitoyen séparant sa propriété du terrain d'assiette du projet ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler dans cette mesure ce jugement, ainsi que cet arrêté, en tant qu'il autorise ces travaux »
CAA. LYON 18 décembre 2012, Association Lac d’Annecy Environnement, req. n°12LY00656
« Considérant qu'aux termes de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du permis de démolir initial : " La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du bâtiment pour cause d'utilité publique " ; qu'ainsi qu'en attestent les mentions de l'arrêté du 13 février 2007, lequel vise la promesse de vente consentie à la société Monné-Decroix Promotion par le centre hospitalier de la région d'Annecy, cette société a justifié, à l'appui de sa demande de permis de démolir, du titre en vertu duquel elle a déposé cette demande ; que le maire d'Annecy, en l'absence de toute disposition régissant spécifiquement le cas de la démolition de bâtiments antérieurement soumis au régime de la domanialité publique, n'avait pas à exiger la production complémentaire d'actes ou documents relatifs au déclassement des immeubles en cause ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration du centre hospitalier de la région d'Annecy avait approuvé ce déclassement, en son principe, par une délibération du 16 juin 2006 à laquelle se réfère expressément la promesse de vente susmentionnée ; que la disposition précitée du code de l'urbanisme n'a dès lors pas été méconnue ;
4. Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme, applicable au permis de démolir modificatif délivré le 30 septembre 2009, les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir sont déposées " par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Monné-Decroix promotion a régulièrement attesté être autorisée à exécuter les travaux faisant l'objet du permis ; qu'au vu de cette attestation, et alors que ne lui était révélé aucun risque de manoeuvres frauduleuses, le maire d'Annecy n'avait pas à exiger la production de justificatifs complémentaires ni à vérifier, en l'absence de disposition le prescrivant, l'existence d'une mesure de déclassement du domaine public ; que sur ce point, au surplus, l'allégation de l'association Lac d'Annecy environnement selon laquelle les locaux en cause demeuraient inaliénables faute d'avoir été déclassés, est contredite par les pièces du dossier, le conseil d'administration du centre hospitalier de la région d'Annecy ayant approuvé en son principe, ainsi qu'il a été dit, le déclassement du site par délibération du 16 juin 2006 et l'ayant ensuite effectivement prononcé par délibération du 3 octobre 2008 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article R. 423-1 précité du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli ».
CAA. Lyon, 30 octobre 2012, M. et Mme Rob, req. n°11LY03045
« Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes : - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ; - les motifs qui ont fondé la décision ; - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet " ;
4. Considérant que l'article 26 du décret susvisé du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005, en vertu duquel les demandes de permis de construire formées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt, concerne uniquement la présentation et l'instruction de ces demandes d'autorisations d'urbanisme ; qu'il ne saurait dès lors faire échec à la mise en oeuvre des dispositions issues de ladite ordonnance qui régissent les décisions d'urbanisme elles-mêmes, et qui sont dès lors applicables à l'ensemble des décisions postérieures à cette date ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est soumis, contrairement à ce que soutient le ministre de l'égalité des territoires et du logement, à la prescription fixée par l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme ;
5. Considérant, toutefois, que cette disposition, quant bien même elle figure dans le chapitre du code de l'urbanisme relatif à l'adoption de la décision prise sur la demande de permis de construire et impose une formalité qui lui est concomitante, ne saurait être interprétée comme imposant une motivation en la forme de cette décision qui serait une condition de sa légalité ; que, par suite, la circonstance que les informations prévues par les dispositions précitées de l'article L 122-1 du code de l'environnement n'ont pas été jointes à l'arrêté contesté est sans incidence sur la légalité de celui-ci ».
CE. 26 octobre 2012, Cne de Saint-Jean Cap Ferrat, req. n°350737
« 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. " ; qu'aux termes de l'article R. 425-17 du même code : " Lorsque le projet est situé dans un site classé (...), la décision prise sur la demande de permis de construire ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : a) Cet accord est donné par le préfet, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 424-2 du même code : " Par exception au b) de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : / a) Lorsque les travaux sont soumis (...) à une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'une déclaration préalable est situé dans un site classé, la décision de non-opposition à cette déclaration ne peut légalement intervenir que sous réserve de l'accord exprès du préfet, après avis de l'architecte des Bâtiments de France ; que nonobstant la circonstance que de tels travaux sont ainsi soumis, en vertu de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme, à une autorisation au titre des sites classés, l'exception prévue par l'article R. 424-2 de ce code et prévoyant la naissance d'une décision implicite de rejet ne leur est, en vertu de son texte même, pas applicable ; qu'ainsi, le silence gardé par l'autorité compétente pour statuer sur cette déclaration préalable au terme du délai d'instruction vaut, conformément aux dispositions de l'article R. 424-1 du même code, décision tacite de non-opposition ».
CAA. Lyon 13 novembre 2012, Cne de Saint-Bel, req. n°12LY01114
« Considérant, en troisième lieu, qu'un permis d'aménager un lotissement de onze lots a été délivré à une autre société avant que le maire de la commune de Sain-Bel accorde le permis d'aménager litigieux à la SCI Les Jardins de Saint-Fortunat ; que la circonstance que deux lotissements aient été successivement autorisés sur des terrains contigus débouchant sur une même voie communale n'implique pas, par elle-même, que ces lotissements présentent entre eux des liens physiques ou fonctionnels imposant, en principe, la délivrance d'un permis d'aménager unique ; qu'en outre, même dans l'hypothèse d'un projet immobilier unique, la délivrance de plusieurs permis n'est pour autant pas exclue, sous réserve du respect de certaines conditions ; qu'en conséquence, M. ne peut soutenir que le maire de la commune de Sain-Bel ne pouvait en l'espèce légalement délivrer deux permis d'aménager successifs »
CAA. Versailles, 18 octobre 2012, Pierre A…, req. n°11VE00983
« Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " les demandes de permis (...) de démolir (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : (...) c) soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ; que, conformément à ces dispositions, qui impliquent que le maire d'une commune ne peut solliciter, au nom de sa commune, une demande de permis de démolir, acte de disposition et non de simple administration, d'une propriété de la commune, sans y avoir été expressément autorisé par le conseil municipal, le conseil municipal de la commune de Levallois-Perret a, par une délibération en date du 14 mai 2007, autorisé son maire ou l'adjoint délégué à déposer un permis de démolir les bâtiments situés 125-127 rue Anatole France afin de permettre la construction d'un programme de 27 logements sociaux ; que, cependant, la demande de permis de démolir a été signée par Mme C, 4ème adjoint chargée, aux termes d'un arrêté du maire de Levallois-Perret en date du 30 septembre 2002 d'exercer, conjointement avec le maire, les fonctions relatives aux " travaux, environnement, espaces verts et voirie " alors que, par ailleurs, le maire avait décidé d'exercer seul les compétences relatives à l'urbanisme et à la gestion du domaine communal ; que, par suite, et compte tenu de l'imprécision de l'intitulé de sa délégation qui ne peut être entendue comme lui donnant une compétence pour les opérations intéressant le domaine privé de la commune, Mme C n'était pas habilitée à solliciter, au nom de la commune, conformément à l'autorisation délivrée par le conseil municipal, la délivrance d'un permis de démolir les bâtiments devant être acquis par la commune par la voie de l'expropriation ; que, par suite, la décision par laquelle le maire de Levallois-Perret a accordé à cette commune un permis de démolir une propriété communale était irrégulière en raison de l'absence de qualité de l'auteur de la demande pour agir au nom de ladite commune »
CAA. Versailles, 20 septembre 2012, Cne de Maison-Laffite, req. n°11VE01120
« Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " ;
Considérant qu'aucune disposition de l'ordonnance susvisée du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ou de son décret d'application susvisé du 3 mai 2006 ne confère aux associations syndicales autorisées de compétence pour édicter des règles en matière d'urbanisme ; que si les statuts de l'association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte, qui ont acquis valeur réglementaire du fait de leur approbation par l'arrêté préfectoral du 20 mars 2008, prévoient qu'" elle assure la gestion, la préservation, la garde et la surveillance générale de son patrimoine, et en réglera l'utilisation selon les clauses, charges et conditions du cahier des charges du 16 février 1834 et de tous règlements édictés ", cet établissement public administratif ne saurait, sur ce seul fondement, édicter des normes qui s'imposeraient à d'autres personnes que les membres de l'association ;
Considérant, au surplus, que le règlement du Parc de Maisons-Laffitte a été approuvé par une délibération de l'assemblée générale des propriétaires du 17 juin 2000 ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une approbation, au demeurant prévue par aucun texte, par l'autorité préfectorale ; que ce règlement n'est par conséquent opposable qu'aux membres de l'association syndicale autorisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le règlement du Parc de Maisons-Laffitte n'est pas un règlement en vigueur au sens des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ; que c'est par conséquent à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que les dispositions de ce règlement, prévoyant une consultation préalable du conseil syndical de l'association syndicale autorisée pour tout projet de permis de construire, s'imposaient à la commune ».
RETRAIT & CONTENTIEUX :
CE. 12 décembre 2012, SCEA Pochon, req. n°339.220
« Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 423-23 et R. 424-1 du code de l'urbanisme, à défaut d'opposition notifiée dans le délai d'un mois suivant le dépôt d'une déclaration préalable présentée en application de l'article R. 421-23, le pétitionnaire est autorisé à réaliser les aménagements ou travaux ayant fait l'objet de la déclaration ; que, selon l'article R. 424-15 du même code, mention de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la date à laquelle la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquise et pendant toute la durée du chantier ; que, par ailleurs, il résulte de l'article R. 424-13 qu'en cas de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont présenté le 29 novembre 2007 au maire de Bosc-Mesnil une déclaration préalable portant sur la division en lots d'une parcelle ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration sur cette déclaration, dont il est résulté, au terme du délai l'instruction, une décision tacite de non-opposition, M. et Mme A ont obtenu le 5 février 2008 du maire la délivrance d'un certificat attestant de l'existence de cette décision ; que, saisi par la SCEA Pochon et le GFA Pochon d'un recours pour excès de pouvoir contre ce certificat, le tribunal administratif de Rouen l'a rejeté comme irrecevable au motif que le certificat prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ne constitue pas une décision faisant grief ;
3. Considérant toutefois qu'il ressort de la demande de première instance que les requérants faisaient état de l'affichage sur le terrain du certificat et invoquaient des moyens tirés non de ce qu'aucune décision tacite n'était acquise mais de l'illégalité de cette décision ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a méconnu son office en ne regardant pas cette demande comme dirigée contre l'autorisation dont l'existence leur avait été révélée par l'affichage du certificat ; que les requérants sont par suite fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent ».
CAA. Versailles, 22 novembre 2012, req. n°11VE02254
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'introduction de leur requête le 17 novembre 2010, le greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a invité Mme B et M. A, par des courriers en date du 19 novembre 2010, à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de 15 jours suivant réception de ces lettres ; qu'après avoir constaté que ces demandes, adressées à Mme B et à M. A à l'adresse indiquée dans leur requête, avaient fait l'objet d'un retour à l'envoyeur avec la mention " non réclamée ", le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette requête au motif que les demandes adressées à Mme B et M. A devaient être regardées comme leur ayant été régulièrement notifiées le 20 novembre 2010, date de leur présentation, et que faute pour les requérants d'avoir procédé à sa régularisation dans le délai de 15 jours qui leur avait été imparti, leur demande était irrecevable ;
4 - Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non-distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non-distribution et le nom du bureau de mise en instance ;
5 - Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné au tribunal administratif auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
6 - Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de réception retournés par les services postaux au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, s'ils portent la mention " présenté / avisé " le 20 novembre 2010 et une étiquette portant la mention " non réclamé " sous la rubrique " pli non distribuable ", ne précisent pas le motif pour lequel ces plis n'ont pu être remis à leurs destinataires lors du premier passage du facteur à leur domicile ; qu'au surplus, il n'a pas davantage été porté sur ces avis de réception ou sur les enveloppes retournées au tribunal le nom et l'adresse du bureau de poste dans lequel les plis ont été mis en instance ; qu'il suit de là que les mentions portées sur ces pièces ne permettent pas de considérer que les plis ont été régulièrement notifiés à l'adresse des requérants ; qu'ainsi, et alors même que la demande de régularisation faite aux requérants pouvait être consultée sur le site Sagace, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait estimer que Mme B et M. A n'avaient pas satisfait à la demande de régularisation dans le délai requis et en conséquence rejeter la requête pour ce motif ».
CE. 14 novembre 2012, Cne de Lunel, req. n°342.389
« Considérant, en premier lieu, qu'à l'issue du jugement du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le retrait par le maire de Lunel de sa décision tacite de non opposition à déclaration préalable de travaux, la société APS France Pare-Brise s'est trouvée rétablie dans le droit à construire qui résultait de la décision originelle ; que les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme citées ci-dessus doivent être regardées comme s'appliquant également au recours exercé contre une décision juridictionnelle dont résulte le rétablissement d'un droit à construire ; qu'il appartenait, dès lors, à la commune de Lunel, dont le pourvoi tend à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier, de notifier son recours au bénéficiaire de cette décision, la société APS France Pare-Brise ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces de la procédure que le pourvoi ait été notifié par la commune de Lunel à la société APS France Pare-Brise ;
5. Considérant, en second lieu, que la commune de Lunel soutient que l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut lui être opposée dès lors qu'il n'a pas été fait mention de cette obligation par un affichage sur le terrain postérieurement au jugement du 11 juin 2009, ainsi que le prescrit, depuis le 1er octobre 2007, le deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du même code ; que, toutefois, les obligations d'affichage prévues par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme sont destinées à informer les tiers et non l'auteur de la décision ou le bénéficiaire de la décision prise sur la réclamation préalable ; que, par suite, la commune de Lunel, qui est l'auteur de la décision de non-opposition dont le retrait a été par la suite annulé, ne peut se prévaloir de la méconnaissance des obligations d'affichage qui résultent des dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ».
CAA. Lyon, 13 novembre 2012, Mme Suzanne …, req. n°12LY00626
« Considérant que Mme soutient qu'en retirant, par son arrêté du 8 juin 2010, le refus de permis de construire du 2 mai 2008 fondé sur l'article NDl 1 du règlement du plan d'occupation des sols, pour immédiatement, par ce même arrêté, lui substituer un nouveau refus, cette fois fondé sur les articles Nl 1 et Nl 2 du règlement du plan local d'urbanisme, sans lui laisser la possibilité de confirmer sa demande de permis, le maire de la commune de Lugrin a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, ces dispositions, qui organisent pour l'instruction des demandes de permis de construire un régime dérogatoire lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le code de l'urbanisme a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, ne peuvent être interprétées que strictement ; que, dès lors, ce régime dérogatoire ne peut être appliqué dans l'hypothèse particulière dans laquelle, comme en l'espèce, un refus opposé à une demande de permis de construire a fait l'objet d'un retrait, et non d'une annulation juridictionnelle ; que le moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que la commune de Lugrin s'est livrée à des manoeuvres dans le but d'échapper à l'application de l'article L. 600-2 précité du code de l'urbanisme, en devançant une possible annulation par le tribunal du premier refus de permis de construire du 2 mai 2008 pour opposer à la demande de permis, après retrait de ce premier refus, un nouveau refus fondé sur les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme, intervenues postérieurement au refus initial et qui suppriment la possibilité de construire des " garages liés à un bâtiment existant ", antérieurement prévue dans le secteur NDl du plan d'occupation des sols ; qu'aucun élément sérieux ne vient cependant établir le bien-fondé de ces allégations ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, dès lors, être écarté ».
CAA. Lyon 13 novembre 2012, SCI Les Trois Glaciers, req. n°12LY01549
« Considérant toutefois qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Bellentre : " La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres " ; qu'il ressort des plans contenus dans le dossier du permis de construire litigieux que l'angle Est de l'aile " B " de la résidence hôtelière projetée, où la hauteur du bâtiment, qui doit être déterminée par rapport au terrain naturel suivant les prescriptions de l'article UB 10, est de 12,61 mètres, est implanté à seulement 4,95 mètres de la limite séparative de la propriété voisine, au lieu des 6,30 mètres qu'impose la disposition précitée ; que si l'arrêté contesté comporte le rappel de celle-ci, sa simple citation, dépourvue de toute référence précise à un aspect du projet examiné, ne saurait être lue comme prescrivant d'en modifier l'implantation au droit de la limite séparative en cause, à supposer d'ailleurs qu'une telle modification fût réalisable sans apporter audit projet des changements d'une ampleur telle qu'il en résultât la nécessité de déposer une nouvelle demande de permis de construire ; qu'ainsi, le second motif d'annulation retenu par le tribunal, fondé sur la méconnaissance de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Bellentre, ne saurait être infirmé ; que cette illégalité suffit, les corps de bâtiments étant reliés par différents éléments de construction, en particulier par un sous-sol commun affecté au stationnement dont l'unique entrée est aménagée, précisément, dans l'aile " B ", et formant ainsi un ensemble indissociable, à justifier l'entière annulation du permis de construire contesté ».
CAA. Lyon 16 octobre 2012, Copropriété de la Crisette, req. °12LY00608
« 9. Considérant, d'autre part, que le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette soutient que, après avoir relevé que les chalets n° 2 et n° 4 méconnaissent l'article 18 des dispositions générales, le Tribunal aurait dû annuler en totalité le permis de construire attaqué ; que le fait, invoqué par ce syndicat de copropriété, que l'arrêté litigieux autorise la construction d'une résidence de tourisme est cependant sans incidence particulière sur la divisibilité des dispositions de cet arrêté ; que, même si des équipements communs sont prévus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les chalets n° 2 et n° 4 ne pourraient pas être supprimés sans remettre en cause la construction des autres bâtiments autorisés par le permis ; que, dans ces conditions, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le Tribunal administratif de Grenoble s'est borné à procéder à une annulation partielle de l'arrêté attaqué ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété La Crisette n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Praz-sur-Arly a délivré à la société Les Portes du Soleil un permis de construire en tant que cet arrêté autorise la construction des chalets n° 1, n° 3, n° 5 et n° 6 ; que, d'autre part, l'appel incident de cette société doit, sans même qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, être rejeté ».
CAA. Marseille, 27 septembre 2012, M. et Mme A…, req. n°10MA04041
« Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, applicable au présent litige en application du 3° de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 susvisé : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1. " ;
Considérant qu'il est constant que M. et Mme A n'ont pas établi de déclaration d'achèvement des travaux, conformément aux dispositions de l'article R 462-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, la construction ne saurait être considérée comme achevée, au sens et pour l'application des dispositions sus-énoncées de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que la demande présentée par M. et Mme B aurait été introduite plus d'un an après l'achèvement de la construction en litige ne peut qu'être écartée ».
CONFORMITE DES TRAVAUX :
CAA. Bordeaux, 18 décembre 2012, Jérôme X…, req. n°11BX02835
« Considérant, d'autre part, que, si l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme limite à une durée de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux, le délai dans lequel l'autorité compétente doit s'assurer de la conformité des travaux à l'autorisation, cette règle n'a ni pour objet, ni pour effet de faire naître, à échéance de ce délai, un accord tacite dont le certificat de conformité délivré ultérieurement serait purement confirmatif ; que, par suite, la décision par laquelle cette autorité atteste de l'absence d'opposition, seule décision dont les tiers peuvent avoir connaissance, est au nombre des actes susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir ».
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés