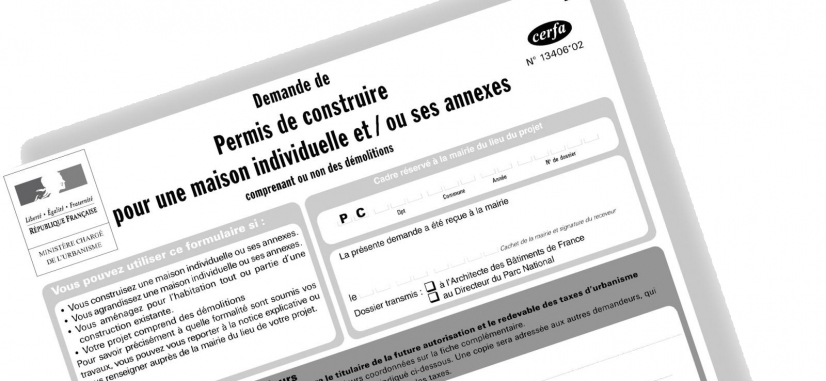Sur le délai de validité des autorisations de lotir (délivrées avant le 1er octobre 2007)

Le délai de validité des autorisations de lotir délivrées avant le 1er octobre 2007, et encore en vigueur à cette date au regard de l’ancien article R.315-30 du Code de l’urbanisme, est depuis régi par l’article R.424-17 et, partant, celles qui étaient alors encore en vigueur ont pu bénéficier de la majoration d’un an instituée par le décret du 19 décembre 2008.
CAA. Marseille, 20 juin 2013, M.M…B…, req. n°12MA03952
Comme on le sait, le régime entrée en vigueur le 1er octobre 2007 a supprimé les « autorisations de lotir » pour y substituer deux formes d’autorisations distinctes – le permis d’aménager et la décision de non-opposition à déclaration préalable – mais ce, sans prévoir aucune disposition transitoire spécifique à l’égard des premières.
Si l’entrée en vigueur de ce régime ne pouvait bien entendu pas avoir pour effet de rendre immédiatement caduques les autorisations de lotir encore en vigueur au 1er octobre 2007 (dont les demandes présentées avant cette date restées d’ailleurs encore valables et instruites au regard des dispositions antérieures), il était plus difficile de déterminer les dispositions régissant leur délai de validité et, plus précisément, d’établir si elles demeuraient régies par l’ancien article R.315-30 ou si elles s’en trouvaient soumises au régime découlant des nouveaux articles R.424-17 et suivants du Code de l’urbanisme.
Au demeurant, la doctrine administrative sur ce point était d’ailleurs relativement « floue » puisque sur son site le Ministère avait précisé que :
« en application de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, le permis de construire d’aménager ou de démolir est périmé si, passé un délai de deux ans à compter de la date de notification du permis ou de la date de décision tacite, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Ces dispositions s’appliquent quel que soit le permis, qu’il soit ou non réalisé par tranches. Le décret n° 2007-817 relatif à la restauration immobilière et portant diverses dispositions modifiant le code de l’urbanisme indique dans son article 4 que "les demandes de permis de construire et d’autorisations prévues par le code de l’urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de dépôt". En revanche, une fois les autorisations délivrées, ces dernières sont soumises au droit en vigueur au jour de la décision. C’est le cas pour le délai de validité » ;
alors que dans le cadre d’une réponse ministérielle il avait estimé que :
« l'article 1 du décret n° 2008-1353 fixe précisément le champ d'application de la prorogation du délai d'un an des autorisations de construire en indiquant que cette disposition concerne « le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 ». Compte tenu du régime particulier de caducité des autorisations de lotir, délivrées en application des règles en vigueur avant la réforme du1er octobre 2007, celles-ci ne figurent pas au nombre des actes énumérés par ledit décret. En conséquence, les autorisations de lotir régies par la législation antérieure à la réforme évoquée ne peuvent bénéficier des dispositions dérogatoires introduites par le texte réglementaire du 19 décembre 2008. Leur durée de validité reste fixée à dix-huit mois et trois ans, en application de l'ancien article R. 315-30 du code de l'urbanisme. En revanche, les lotissements ayant fait l'objet d'un permis d'aménager ou d'une non-opposition à déclaration préalable depuis le 1er octobre 2007 en bénéficient » (Rép. Min n°57338 ; JOAN, 15/12/2009, p.12075).
Or, s’il est vrai que ces deux réponses portaient sur des dispositifs distincts (l’article R.424-17, d’une part, et le décret du 19 décembre 2008, d’autre part) et étaient relatives pour la première aux autorisations de lotir sollicitées avant le 1er octobre 2007 mais obtenues après cette date alors que la seconde, avaient trait à celles délivrées avant cette échéance, il reste que cette dernière était exclusivement fondée sur le fait que le décret du 19 décembre 2008 ne visait pas expressément les « autorisations de lotir » alors que la première concluait à l’article R.424-17 qui lui-même ne mentionnait pourtant pas ces autorisations.
De même, l’examen des arrêts d’appel rendus au sujet du régime applicable à la durée de validité des permis de construire pouvait en première analyse générer certaines interrogations puisqu’il a pu être jugé que :
« Considérant que, pour contester le jugement susvisé, M. X fait valoir que le permis de construire en litige, délivré le 23 juillet 2003, n'avait fait l'objet d'aucun commencement d'exécution dans les deux ans de sa notification à sa bénéficiaire et était caduc depuis juillet 2005 ; que cette affirmation n'est ni contestée ni démentie par les pièces du dossier ; que le délai de validité du permis de construire en litige n'est pas régi, contrairement à ce que prétend la commune de Gardanne, par les dispositions de l'article R. 424-19 introduites dans le code de l'urbanisme par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, entrées en vigueur le 1er octobre 2007 postérieurement au permis de construire et au jugement attaqués, mais par celles de l'alinéa 1er de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme alors en vigueur" (CAA. Marseille, 10 juillet 2009, Ph. X…, req. n°07MA00341) ;
mais en revanche que :
« Considérant (…) qu’ il ne ressort pas des pièces du dossier que des travaux de construction de la grange et de l'atelier se sont poursuivis après la fin août 2007 ; que si le maire de Gouvieux s'est fondé, pour édicter l'arrêté de péremption litigieux, sur une interruption de travaux comprise entre le 21 mars 2007 et le 5 septembre 2008, il résulte de ce qui précède qu'il aurait pu prendre la même décision en se fondant sur une interruption de travaux d'au moins une année en retenant une période comprise entre le 4 septembre 2007 et le 5 septembre 2008 ; que, par suite, le maire de Gouvieux a pu à bon droit, sur le fondement de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, constater, par sa décision du 9 septembre 2008, la péremption du permis de construire délivré à M. A le 31 octobre 2000 en tant qu'il portait sur la grange et l'atelier ; que, par suite, la COMMUNE DE GOUVIEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, dans son jugement, le tribunal administratif d'Amiens a retenu le motif que l'interruption de travaux n'était pas établie pour prononcer l'annulation de l'arrêté de son maire en date du 9 septembre 2008 » (CAA. Douai, 19 juillet 2012, Cne de Gouvieux, req. n°11DA01326) ;
en outre, sans aucune référence à l’ancien article R.421-32 du Code de l’urbanisme.
Cela étant, force est de relever que dans la première affaire le permis de construire en cause avait été délivré, ainsi que l’a d’ailleurs souligné la Cour, avant le 1er octobre 2007, avait été frappé d’un recours avant cette même date et surtout, à cette date, était déjà caduc au regard du régime découlant de l’ancien article R.421-32 précité. La question n’était donc pas de déterminer si les articles R.424-17 et suivants étaient applicables à ce permis de construire mais d’apprécier s’ils pouvaient avoir pour effet de faire « revivre » cette autorisation ; ce qui ne pouvait évidemment pas être le cas.
En revanche, dans la seconde, si le permis de construire en cause avait été obtenu avant le 1er octobre 2007, il reste que son délai de validité expirait après cette date, soit à une époque où l’article R.421-32 du Code de l’urbanisme n’était plus en vigueur et avait été « remplacé » par l’article R.424-17 du Code de l’urbanisme.
Tel était le cas de l’autorisation de lotir en litige dans l’arrêt objet de la note de ce jour puisque délivrée le 9 août 2006, cette autorisation était au regard de l’article R.315-30 alors applicable encore en vigueur au 1er octobre 2007 et, au regard de l’article R.424-17 applicable depuis cette date, toujours valable à la date d’entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2008. Et précisément, la Cour administrative d’appel de Marseille a donc jugé que :
« Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision en litige " L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R. 315-21. Il en est de même si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté et qui ne peut être supérieur à une durée de trois ans décomptée comme il est dit à l'alinéa précédent. Toutefois, dans le cas où la réalisation des travaux par tranches a été autorisée, les délais impartis au lotisseur en application des alinéas ci-dessus s'appliquent aux travaux de la première tranche. Les délais impartis pour réaliser les travaux des autres tranches sont fixés par l'arrêté d'autorisation sans qu'ils puissent excéder une durée de six ans décomptée comme il est dit à l'alinéa premier du présent article. (...) Lorsque l'autorisation est devenue caduque, l'opération ne peut être poursuivie qu'en ce qui concerne les tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme " ; que l'article R. 424-17 du même code applicable depuis le 1er octobre 2007 aux autorisations de lotir encore en vigueur à cette date prévoit : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ... " que le décret du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable prévoit enfin dans son article premier que " par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 et à l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 est porté à trois ans. " et dans son article deux que " Le présent décret s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication. " ; que pour l'application de ces dispositions, le point de départ du délai au terme duquel une autorisation de lotir devient caduque s'apprécie à compter de la notification de l'arrêté de lotir ou à défaut de la présomption d'une telle notification résultant de la connaissance qu'en aurait manifestée le bénéficiaire ;
Considérant, d'une part, que la date de notification de l'arrêté du 9 août 2006 ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; que, d'autre part, en application des dispositions combinées des articles R. 315-30 et R. 424-17 du code de l'urbanisme, l'arrêté du 9 août 2006 était encore en vigueur au 20 décembre 2008 et pouvait ainsi bénéficier du régime spécifique de péremption de 3 ans institué par le décret du 19 décembre 2008, d'application immédiate ; que M. D...n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'autorisation de lotir qu'il conteste serait frappé de caducité du seul fait que le bénéficiaire de cette autorisation n'a engagé aucun travaux avant le 9 février 2008 ; que s'il affirme, dans ses dernières écritures produites juste avant clôture de l'instruction, que la Cour observera qu'aucun travaux significatifs n'ont été réalisés depuis 2004, il ne produit aucun élément pour permettre une telle constatation ; que le présent litige conserve, dès lors, son objet » ;
et partant que cette autorisation de lotir pouvait donc bénéficier de la majoration d’un an instituée par ce décret.
Une telle analyse nous parait difficilement contestable.
Il faut en effet rappeler que l’article R.421-32 comme l’ancien article R.315-30 du Code de l’urbanisme ont été abrogés, sans aucune forme d’exception, ni mesure transitoire dès le 1er octobre 2007. En effet, l'article 4 du décret du 11 juin 2007 non seulement ne visait que les demandes en cours d’instruction à la date du 1er octobre 2007 mais en outre se bornait à disposer que « les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt ».
Or, le délai de validité constitue une règle de fond et, en toute hypothèse, concerne le régime des autorisations obtenues et non pas le traitement des « demandes » qui seules sont visées par l’article précité.
D’ailleurs, le Tribunal administratif de Lyon a pu juger « qu’en absence de dispositions transitoires contraires, ces dispositions combinées sont applicables aux autorisations et déclarations d’urbanisme nées antérieurement à leur entrée en vigueur, lorsque ces autorisations et déclarations ne sont pas entachées de péremption au regard des règles antérieurement applicables » (TA. Lyon, 10 mai 2012, req. n°10-05100). Et de même, le Tribunal administratif de Nice a pour sa part jugé que la prorogation exceptionnelle d’un an institué par le décret du 19 décembre 2008 était néanmoins applicable à un permis de construire obtenu avant le 1er octobre 2007 (TA. Nice, 19 avril 2012, req. n°09-02188) ; ces deux jugements apparaissant parfaitement conformes à l’arrêt par lequel le Conseil d’Etat avait jugé, en l’absence de toute disposition transitoire contraire, que l’extension du délai de validité de l’article R.421-38 du Code de l’urbanisme résultant du décret du 12 août 1981 était applicable à tous les permis de construire alors en cours de validité (CE. 27 novembre 1987, Association des amis des sites de la baie de BANDOL, req. n°66.287).
Il est vrai, toutefois, que l’ensemble de la jurisprudence précitée antérieure à l’arrêté commenté a été rendue au sujet du délai de validité du permis de construire, soit au sujet d’une forme d’autorisation d’urbanisme existante avant comme après le 1er octobre 2007 alors qu’à cette date, l’autorisation de lotir a pour sa part disparu au profit du permis d’aménager et de la déclaration préalable de lotissement ; ce dont il résulte que les articles R.424-17 du Code de l’urbanisme ne visent pas ces autorisations.
Il reste que si les termes « permis de construire » ont été maintenus, il n’en demeure pas moins que cette forme d’autorisation n’avait pas strictement le même champ d’application et n’étaient pas soumis au même régime - notamment de péremption - avant le 1er octobre 2007.
Malgré cette identité d’intitulé, il s’agit donc de deux types d’autorisations distinctes ou, à tout le moins, d’autorisations au régime aussi différent qu’une autorisation de lotir et qu’un permis d’aménager.
D’ailleurs, si l’on considère qu’une autorisation de lotir ne saurait bénéficier du régime applicable depuis cette date, et notamment de celui-ci applicable au permis d’aménager, il s’ensuivrait qu’une telle autorisation ne pourrait plus faire l’objet d’un arrêté modificatif puisque :
- les seules autorisations susceptibles d’être délivrées en tant qu’autorisation de lotir après cette même date sont celles répondant à une demande présentée avant le 1er octobre 2007 ;
- le régime des autorisations d’urbanisme modificatives est celui en vigueur à la date à laquelle l’administration statue sur la demande s’y rapportant et non pas donc celui en vigueur à la date de délivrance ;
si bien qu’une autorisation de lotir obtenu suivant le régime applicable avant cette date ne saurait ensuite être modifiée par un permis d’aménager modificatif.
Pour autant, il a pu être jugé qu’une telle autorisation non seulement pouvait donner lieu à un permis d’aménager modificatif mais, bien plus, pouvaient être régularisée, tant pour ses vices de forme (CAA. Nantes, 4 mai 2010, Cne de Belz, req. n°09NT01343) que ses vices de fond (CAA. Marseille, 24 novembre 2011, Sté Barkate Promotion, req. n°09MA03035), par un tel permis obtenu selon le régime applicable depuis le 1er octobre 2007.
C’est donc bien que le régime et les droits découlant d’un permis d’aménager sont transposables à une autorisation de lotir ; ce qui nous semble d’ailleurs selon nous également valoir pour les dispositions de l’article R.424-19 du code de l’urbanisme.
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés