Des liens entre permis de construire modificatifs successifs
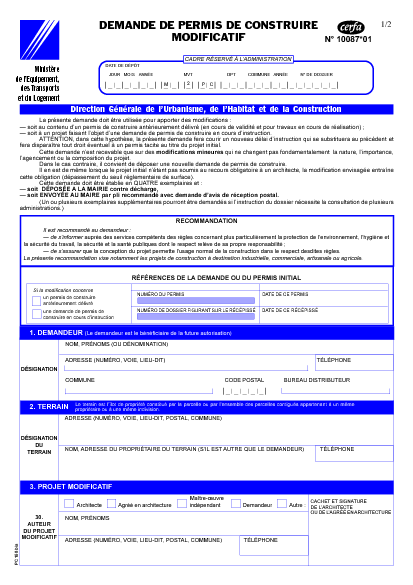
En cas de contentieux à l'encntre de ces deux autorisations, l'annulation d'un premier permis de construire modificatif n'emporte pas nécessairement l'annulation du second.
CAA. Nancy, 22 janvier 2009, M. Gilbert X., req. n°08NC00223
Dans cette affaire, le pétitionnaire avait obtenu un permis de construire puis un premier « modificatif » et, enfin, un second « modificatif ». Ces deux autorisations modificatives devaient toutefois être attaquées. Mais seule la première de ces deux autorisations devait être annulée en première instance. Le requérant décida toutefois d'interjeter appel à l'encontre de ce jugement et soutint à son encontre qu'il était entaché d'une erreur de droit dans la mesure où l'annulation d'un premier modificatif emportait nécessairement l'annulation du second.
Comme on le sait, en effet, un permis de construire modificatif ne se substitue pas au permis de construire modificatif mais s’y intègre pour former avec lui une « autorisation unique » (TA. Versailles, 22 février 1994.pdf, SCI Les Ormes, req. n°93-05140) ; ce dont il résulte que, d’une part, « le permis de construire initialement délivré pour l'édification d'une construction et le permis modificatif ultérieurement accordé pour autoriser des modifications à cette même construction constituent un ensemble dont la légalité doit s'apprécier comme si n'était en cause qu'une seule décision » (CAA. Paris, 30 octobre 2008, M. Gilbert Y., req. n°05PA04511) et que, d’autre part, le bénéficiaire de ces autorisations doit exécuter le projet tel qu’il résulte de la combinaison de ces deux permis et, donc, ne saurait régulièrement exécuter le projet tel qu’il avait été initialement été autorisé (Cass. crim., 29 juin 2004, Association pour la sauvegarde de la commune de Favières-la-Route, Bull. crim., n°176 ; CAA. Marseille, 21 janvier 1999, Sté Terre & Pierre, req. n°96MA02171).
Compte tenu de cette intégration du « modificatif » au « primitif », on pouvait donc penser en premier analyse que l’annulation d’un premier modificatif emporte, par voie de conséquence, l’annulation du second et ce, de la même façon que l’annulation d’un « primitif » emporte par voie de conséquence celle de son « modificatif ».
Mais la Cour administrative d'appel de Nancy devait donc rejeter ce moyen et ce, au motif suivant :
« Considérant qu'un permis de construire modificatif ne constitue pas une mesure d'application d'un précédent permis modificatif et qu'il n'existe par ailleurs pas entre ces deux actes un lien tel que l'annulation de celui-ci entraîne par voie de conséquence l'annulation de celui-là ; que, par suite, les premiers juges pouvaient, sans entacher la régularité de leur jugement, annuler l'arrêté du 29 avril 2004 par lequel le maire de la commune de Coin-lès-Cuvry a accordé à la coopérative agricole de production de viande un permis de construire modificatif d'un permis initial délivré le 21 août 2003 et rejeter les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 2005 par lequel le maire a accordé à ladite coopérative un second permis de construire modificatif ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 8 novembre 2005 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 24 décembre 2002 : « Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés : à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'exploitation de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) (...) » et qu'aux termes de l'article 2 dudit arrêté : « (...) Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent, dans le cas des extensions des installations déjà autorisées, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles. Elles ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation autorisée avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note descriptive du projet présentée au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, au vu de laquelle l'inspecteur des installations classées de la direction départementale des services vétérinaires de la Moselle a émis le 28 octobre 2005 l'avis que le projet entrait dans la procédure de mise aux normes des bâtiments d'élevage et de maîtrise des effluents agricoles, que la construction du nouveau bâtiment autorisé par le permis de construire modificatif du 8 novembre 2005, destiné à la réception, à l'identification, à la pesée, au tri et au stockage des bovins de boucherie, s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation de l'ensemble de l'installation permettant de mettre celle-ci en conformité avec les exigences de l'arrêté du 24 décembre 2002 concernant le stockage des effluents, grâce à la transformation en fumière couverte du bâtiment précédemment affecté à la réception et au tri des bovins et à la réalisation dans le nouveau bâtiment d'une fosse à lisier répondant aux exigences réglementaires ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M. X, le projet ainsi autorisé entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté en cause, qui permettent de déroger à la règle fixée par les dispositions de l'article 4 du même arrêté, lesquelles interdisent l'implantation d'un bâtiment d'élevage à moins de 100 mètres d'une habitation occupée par un tiers ».
Une telle solution apparaît difficilement contestable. En effet, si un « modificatif » d’intègre le « primitif », il n’en demeure pas moins que la légalité d’un permis de construire modificatif ne peut être contestée qu’en considération de ses vices propres (pour exemple : CE. 4 juin 1997, Ville de Montpellier, req. n°131.233) et, notamment, sur le fond, qu’au regard des irrégularités affectant les modifications ainsi autorisées du projet initial (pour exemple : CAA. Paris, 16 février 1995, Sté Sogébail, Rec., p.509).
A contrario, le recours à l’encontre d’un « modificatif » ne peut donc être utilement fondé sur une irrégularité affectant le seul permis de construire primitif (CE. 3 avril 1997, Mme Monmarson, req. n°53.869) dès lors que celui-ci était définitif à la date d’introduction du recours contre le « modificatif » (CE. 30 novembre 1966, Dme Martin, Rec., p.1038 ; CE 25 avril 1975, SCI Le Clos des Loges, Rec., p.259 ; CAA. Nancy, 12 juin 1997, SEP Lorraine, req. n°95NC00363).
C’est donc bien qu’isolément, un « modificatif » a un objet et un effet limités aux seules modifications qu’il autorise. Telle est la raison pour laquelle l’illégalité et l’annulation subséquente d’un « modificatif » n’ont en elles-mêmes aucune incidence sur la légalité et la pérennité du « primitif » puisque, compte tenu de son objet et de ses effets limités, un « modificatif » ne saurait contaminer un « primitif » qui, par définition et à tous les égards, se suffit à lui-même.
Il s’ensuit que par principe seul le « primitif », tel qu’initialement délivré, constitue la base légale de l’ensemble des « modificatifs » auxquels il donne ultérieurement lieu et qu’a contrario, un premier « modificatif » ne constitue pas par principe la base légale d’un second : l’annulation du premier n’emporte donc pas nécessairement l’annulation du second.
Deux cas doivent cependant être réservés.
D’une part, il va sans dire que lorsque le premier « modificatif » a été obtenu aux fins de régulariser le « primitif » son annulation prive le « primitif » de cette régularisation et l’annulation subséquence de celui-ci emporte nécessairement l’annulation des autres « modificatifs » ultérieurement obtenus.
Il reste qu’il ne s’agit là que d’une application du principe selon lequel c’est le « primitif » qui constitue la base légale de tout « modificatif ».
Mais d’autre part et plus spécifiquement, il nous semble également que l’annulation d’un premier « modificatif » devrait emporter l’annulation du second lorsque les modifications autorisées par le premier ont rendu possibles celles opérées par le second.
A titre d’exemple, il nous parait en effet difficilement concevable que l’annulation d’un premier « modificatif » ayant pour objet d’adjoindre un huitième étage à l’immeuble initiale n’emporte pas l’annulation d’un second ayant pour objet d’en ajouter un neuvième.
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés



