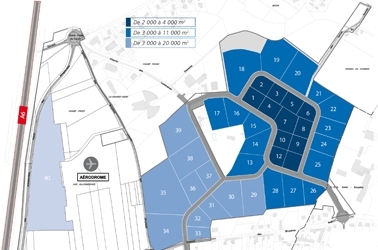Sur l’appréciation de l’impact d’un « modificatif » au regard de l’objet du permis de construire

Un « modificatif » ayant pour objet d’augmenter le nombre d’aires de stationnement projetées peut être requalifié en nouveau permis de construire alors même qu’il ne porte pas sur le bâtiment objet du « primitif »
CAA. Bordeaux, 30 juillet 2009, Association de défense du site de Bilaa, req. n°08BX00323 (135e note)
Dans cette affaire, une commune s’était « auto-délivrée » un permis de construire ayant pour objet de rénover un château sis dans un site boisé et, prévoyant, notamment la création de 57 places de stationnement, lequel devait être attaqué par une association de défense de l’environnement ainsi que le « modificatif » ultérieurement obtenu par la commune aux fins de supprimer ces 57 places pour en créer 207 ailleurs.
Mais en première instance, le recours en annulation à l’encontre du « modificatif » devait être rejeté comme irrecevable au motif tiré de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme – ce que l’association requérante ne contesta pas en appel … Quant au recours contre le « primitif », celui-ci devait lui-même être rejeté après que le juge administratif eu statué sur les conclusions de l’association requérante, laquelle interjeta appel de ce jugement ; requête que la Cour administrative d’appel devait donc rejeter au motif suivant :
« Considérant que le projet autorisé par le permis de construire délivré le 19 décembre 2006 portait sur la rénovation et la réhabilitation du château du Bilaa, situé dans un site boisé, en vue d'y créer une salle convivialité ; que ce projet incluait la réalisation sur le site de 57 places de stationnement ; que le permis de construire délivré le 28 mai 2007 supprime les divers sites de stationnement initialement prévus et prévoit, sur d'autres emplacements, la création de 207 places de stationnement, ce qui entraîne l'abattage de nombreux arbres ; que, compte tenu de l'ampleur des modifications ainsi apportées au projet initial, et même si ces modifications n'affectent pas le projet architectural relatif au château, ce permis doit être regardé non pas comme un simple modificatif au permis initialement délivré, mais comme un nouveau permis ; que ce nouveau permis a implicitement mais nécessairement retiré le permis délivré le 19 décembre 2006 ; que ce retrait, définitif faute d'avoir été contesté, a privé d'objet les conclusions de l'association dirigées contre le permis de construire du 19 décembre 2006 ; que, par suite, le tribunal administratif aurait dû, par son jugement du 4 décembre 2007, prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de ce permis ; que ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; qu'il convient, après évocation, de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ».
A titre liminaire, on soulignera que le « modificatif » en cause – requalifié en nouveau permis de construire et considéré comme ayant emporté le retrait implicite mais nécessaire du précédent – avait été édicté le 28 mai 2007.
La légalité de cet arrêté ayant vocation à être appréciée en considération des circonstances de droit et de fait présentes à sa date d’édiction, tant en ce qu’il valait permis de construire qu’en ce qu’il valait retrait de permis, il n’y avait donc pas lieu d’appliquer l’article L.424-5 du Code de l’urbanisme, lequel en ce qu’il dispose que « le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire » est certes issu de l’article 6 de la loi dite « ENL » du 13 juillet 2006 mais n’est entré en vigueur que le 1er octobre 2007.
Le 28 mai 2007, la légalité et l’effet du « modificatif » en cause en ce qu’il valait retrait du permis précédent avaient donc vocation à être appréciés en considération de la règle dégagée par la jurisprudence « Vicqueneau ».
 Mais sur le fond, force est surtout de souligner que la Cour bordelaise a donc requalifié le « modificatif » attaqué en nouveau permis de construire au regard de l’importance des modifications en cause, lesquelles n’intéressaient que l’aménagement des abords de la construction mais en aucune mesure cette dernière.
Mais sur le fond, force est surtout de souligner que la Cour bordelaise a donc requalifié le « modificatif » attaqué en nouveau permis de construire au regard de l’importance des modifications en cause, lesquelles n’intéressaient que l’aménagement des abords de la construction mais en aucune mesure cette dernière.
Or, aucun de ces aménagements - aires de stationnement et abattage d'arbres - pris isolément, ne relevait du champ d’application du permis de construire.
Il reste qu'aux termes de l'article L. 421-6 du Code de l'urbanisme, lequel reprend l’économie générale de l’ancien article L.421-3 alors applicable, « le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ». Et à ce titre, l'Administration a l'obligation de prendre parti sur l'ensemble des composantes du projet (CE, 7 nov. 1973, n° 85237, Giudicelli. Sur l'aménagement intérieur des « ERP » : CAA Marseille, 22 déc. 2003, n° 99MA00462, SCI Magniola ) ; ce qui implique qu'elle en ait une parfaite et complète connaissance.
Telle est, notamment, la raison pour laquelle les documents que le pétitionnaire doit produire à l'appui de sa demande doivent figurer non seulement les constructions projetées mais également, notamment, la plupart des aménagements extérieurs prévus. Et bien entendu, toute insuffisance du dossier de demande sur l'un de ces aspects du projet peut suffire à emporter l'annulation du permis de construire obtenu (pour l'exemple récent de l'absence de figuration du traitement des espaces extérieurs du terrain d'assiette du projet après abattage des arbres s'y trouvant : CAA Bordeaux, 17 avr. 2008, n° 06BX00558, Cne Biganos. Voir également : CAA. Paris, 3 juillet 2009, Guy X., req. N°07PA00677).
Or, l'Administration est réputée statuer au vu du dossier produit par le pétitionnaire (CE, 18 mars 1970, Rodde : Rec. CE 1970, p. 208) et, par voie de conséquence, autoriser l'ensemble des composantes du projet figuré par celui-ci. C'est ainsi que, par principe, ces travaux et ces aménagements extérieurs aux constructions formeront avec celles-ci un tout indivisible au regard du permis de construire les autorisant. A titre d'exemple, la non conformité aux prescriptions d'urbanisme opposables au projet d'une terrasse et d'un muret pourra ainsi justifier l'annulation de l'ensemble du permis de construire autorisant, au principal, le bâtiment au regard duquel ils constituent des travaux extérieurs (CAA Lyon, 19 avr. 1994, n° 93LY01230, Préfet du Dpt de Haute-Corse) ; bien qu'isolément de tels ouvrages ne relèvent pas nécessairement de la procédure de permis de construire.
À tous les égards, un permis de construire autorise donc l'ensemble du projet figuré par le pétitionnaire dans son dossier de demande et non pas seulement ceux des ouvrages relevant intrinsèquement du champ d'application matériel de cette autorisation. C'est pourquoi, plus spécifiquement, la chambre civile de la Cour de cassation a jugé (Cass. 1re civ., 24 oct. 2006, n° 05-19.708, F-D, SCI Arzac) que l'engagement de n'exercer aucun recours à l'encontre d'un permis de construire valait pour l'ensemble du projet immobilier ainsi autorisé, y compris donc pour ses composantes ne relevant pas isolément du champ d'application de cette autorisation d'urbanisme.
Bien plus, il a pu être notamment jugé que :
- d’une part, l'annulation d'un permis de construire interdisait la poursuite de l'ensemble des travaux se rapportant au projet précédemment autorisé, y compris s'il s'agit de simples travaux d'aménagement intérieur (Voir notre note : « Sur l'objet du permis de construire et les conséquences de son annulation sur la poursuite des travaux », CA Bordeaux, 21 févr. 2008, n° 07/004980, Sté Hatexim, Construction & Urbanisme n° 6/2008) puisque même si par principe le permis de construire ne sanctionne pas en tant que tel l'aménagement intérieur d'une construction – hors du cas des « ERP » pour ce qui concerne les règles de sécurité et d’accessibilité » – il n'est pas non plus totalement étranger à cette question dès lors qu'il la saisit indirectement à travers la destination de l'ouvrage, dont il s'ensuit, d'ailleurs, que si de simples différences entre l'aménagement intérieur autorisé et celui réalisé ne sauraient permettre à l'Administration de contester la conformité des travaux, il en va différemment lorsque les aménagements effectivement exécutés traduisent un changement de destination de l'ouvrage au regard de celle autorisée (CAA Bordeaux, 30 mars 2000, n° 97BX00229, Rassinoux ) ;
- d’autre part, lorsque le projet n'est pas conforme aux prescriptions d'urbanisme lui étant opposables, l'Administration est tenue d'opposer un refus de permis de construire pour l'ensemble du projet, y compris pour ses composantes impliquant des travaux qui, pris isolément, ne relèvent pas du champ d'application du permis de construire ; étant relevé que dans cette affaire, il s'agissait précisément de travaux d'aménagement intérieur destinés pour la plupart à modifier la destination d'une construction existante que, par voie de conséquence, la cour jugea ainsi indivisibles du projet soumis à autorisation (CAA Bordeaux, 30 juill. 2001, n° 98BX01492, Cne Saint-Philippe).
Mais en l’espèce, on pouvait s’interroger sur la nécessité même d’obtenir à tout le moins un « modificatif » puisqu’il s’agissait de créer 207 aires de stationnement en un autre endroit que celles initialement prévues cependant que la Cour administrative d’appel de Bordeaux puis le Conseil d’Etat avaient précédemment jugé que si par principe toute modification d’un projet soumis à permis de construire implique l’obtention d’un modificatif, il en va différemment lorsque les constructions, aménagements et où installations en cause ne sont ni attenants, ni structurellement liés à la construction objet du permis de construire en cours d’exécution (voir nos notes : « La réalisation d’une piscine découverte isolée et dissociable d’une construction objet d’un permis de construire relève de la déclaration préalable et n’impose donc pas l’obtention d’un « modificatif », CAA. Bordeaux, 27 juin 2007, Ville de Toulouse, Construction & Urbanisme, n°9/2007 & « Aménagement accesoire d'une construction illégale: permis de construire, modificatif ou déclaration préalable ? », CE, 9 janvier 2009, Ville de Toulouse, AJDA, n°11/ 2009).
Il reste, et c’est selon le nous le critère déterminant sur ce point, qu’il ne s’agissait pas seulement de créer ces aires mais également de supprimer celles initialement prévues pour satisfaire a priori aux prescriptions applicables en la matière.
Or, quand bien même la création de ces places aurait-elle été, prise isolément, dispensée de toute formalité, ou assujettie alors à autorisation « ITD », puis effectivement réalisées, il n’en aurait pas mois demeuré que la non réalisation des 57 places initialement prévues aurait justifié que l’administration conteste la conformité des travaux réalisés au titre du permis de construire obtenu dès lors que cette conformité doit être exclusivement appréciée au regard des travaux prévus par l’autorisation dont l’exécution et l’achèvement ont déclenché les opérations de récolement.
Patrick E. DURAND
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés


 Dans cette affaire, le pétitionnaire avait obtenu un permis de construire un ensemble immobilier à destination d’habitation sur un terrain bordé par trois voies. Et pour application de l’article R.424-15 du Code de l’urbanisme, celui-ci avait fait procéder à l’affichage de son autorisation sur deux de celles-ci et, immédiatement, l’avait fait constater par plusieurs constats d’huissier. Toutefois, un voisin devait exercer un recours gracieux puis un recours en annulation à l’encontre de ce permis de construire mais ce, après le délai de deux mois prévus par l’article R.600-2 du Code de l’urbanisme, tel qu’il résultait du premier des constats d’huissier qu’avait fait réalisé le pétitionnaire ; ce qu’en défense, ce dernier ne manqua évidemment pas d’opposer au requérant pour conclure à l’irrecevabilité de sa demande.
Dans cette affaire, le pétitionnaire avait obtenu un permis de construire un ensemble immobilier à destination d’habitation sur un terrain bordé par trois voies. Et pour application de l’article R.424-15 du Code de l’urbanisme, celui-ci avait fait procéder à l’affichage de son autorisation sur deux de celles-ci et, immédiatement, l’avait fait constater par plusieurs constats d’huissier. Toutefois, un voisin devait exercer un recours gracieux puis un recours en annulation à l’encontre de ce permis de construire mais ce, après le délai de deux mois prévus par l’article R.600-2 du Code de l’urbanisme, tel qu’il résultait du premier des constats d’huissier qu’avait fait réalisé le pétitionnaire ; ce qu’en défense, ce dernier ne manqua évidemment pas d’opposer au requérant pour conclure à l’irrecevabilité de sa demande.