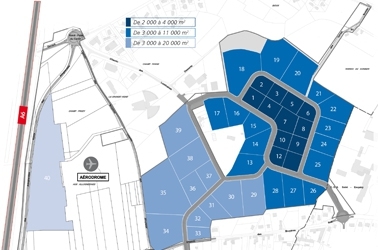Sur les prescriptions des règlements d’urbanisme locaux régissant les droits à construire attachés aux terrains issus d’une division foncière face à l’article 13 de la loi du 13 décembre 2000 et aux articles L.123-1-1 et R.123-10-1 du Code de l’urbanisme

L’abrogation de l’article L.111-5 du Code de l’urbanisme, qui prévoyait que la constructibilité d'un terrain issu d'une division devait être examinée au regard de la constructibilité résiduelle de l'unité foncière initiale, par l’article 13 de la loi du 13 décembre 2000 n’a pas pour effet de rendre illégales les prescriptions des POS antérieures régissant spécifiquement, et par une règle équivalente, les droits à construire attachés aux terrains issus d’une division foncière.
CAA. Versailles, formation plénière, 14 mars 2008, Sté 3A Investissement, req. n°06VE00659
Dans cette affaire, la demande de permis de construire présentée par le requérant avait fait l’objet d’un refus au motif tiré de l’article UG.5 du POS communal, adopté en mai 1992, lequel régissait spécifiquement la constructibilité des terrains issus d’une division foncière.
Mais le requérant devait contester ce refus en soutenant que l’article 13 de la loi du 13 décembre 2000 dite « SRU » ayant abrogé l’ancien article L.111-5 du Code de l’urbanisme – dont on rappellera qu’il disposait que « il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée. Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division » – il s’ensuivait que cette abrogation avait nécessairement eu pour effet d’introduire implicitement une règle selon laquelle les possibilités de construction attachées à un terrain issu d’une division foncière devait être exclusivement appréciées en considération de leur superficie et indépendamment donc de toute considération liée aux droits à construire déjà consommés sur l’unité foncière d’origine ; ce qui avait pour effet de rendre illégales les prescriptions d’un règlement local d’urbanisme maintenant des règles équivalentes au principe posé par l’ancien article L.111-5.
Mais pour être habile, ce moyen devait néanmoins être rejeté par la Cour administrative d’appel de Versailles au motif suivant :
« Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables » ; qu'en vertu de l'article L.123-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000, les règlements des plans d'occupation des sols doivent notamment définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature ; qu'aux termes du 2° de l'article R. 123-21 pris pour l'application de ces dispositions, le règlement peut : « a) Edicter les prescriptions relatives à l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains (…) » ; Considérant qu'aux termes de l'article UG 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bessancourt approuvé par une délibération de son conseil municipal du 22 mai 1992 et sur lequel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire s'est fondé pour prendre l'arrêté litigieux : « Terrains non bâtis (…) : les lots résultant de la division d'une unité foncière doivent, pour être constructibles, avoir une superficie de 600 m² et une largeur de façade de 16 m minimum.(…) Terrains bâtis : (…) La division d'un terrain bâti aboutissant à la création d'un ou plusieurs lots constructibles doit satisfaire aux conditions suivantes : chaque lot, non bâti, doit respecter les règles imposées aux lots résultant de la division des terrains non bâtis. Chaque lot bâti doit être issu d'une division n'aboutissant pas à la création d'au moins un lot bâti de superficie inférieure à la norme de division des terrains non bâtis (…) » ; que la société 3 A INVESTISSEMENT soutient que cet article était illégal du fait de l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi du 13 décembre 2000 ; Considérant, il est vrai, que l'article 13 de la loi du 13 décembre 2000 a abrogé l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 modifiée, laquelle était applicable à la date d'approbation du plan d'occupation des sols de la commune et prévoyait que la constructibilité d'un terrain issu d'une division devait être examinée au regard de la constructibilité résiduelle de l'unité foncière initiale ; qu'il ressort toutefois des termes précités de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, issu de cette même loi du 13 décembre 2000, qu'en abrogeant cette disposition, le législateur n'a pas entendu remettre en cause les dispositions des plans d'occupation des sols déjà approuvés ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 a eu pour effet de rendre illégal l'article UG 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bessancourt ; Considérant que les auteurs du plan d'occupation des sols, en prévoyant qu'en cas de division parcellaire d'un terrain bâti aboutissant à la création d'un lot constructible, le lot bâti également créé ne doit pas être d'une superficie inférieure à la norme de division des terrains non bâtis, n'ont pas excédé les limites de l'habilitation à édicter des prescriptions relatives aux dimensions et à la surface des terrains qu'ils tenaient des dispositions précitées des articles L. 123-1 et R. 123-21 du code de l'urbanisme et n'ont pas porté une atteinte excessive au droit de propriété ; qu'ainsi la société 3 A INVESTISSEMENT n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'article UG 5 précité et à soutenir que le maire de Bessancourt était tenu d'écarter cet article avant de statuer sur sa demande de permis de construire ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article UG 5 que la division d'un terrain bâti en vue de la création d'un lot constructible ne doit pas aboutir à la création d'un lot bâti d'une superficie inférieure à 600 m² ; qu'ainsi en refusant le permis de construire sollicité au motif qu'après la division, le lot bâti présentait une superficie inférieure à 600 m², le maire de Bessancourt n'a pas commis d'erreur de droit, mais a fait au contraire une stricte application de ces dispositions »
En d’autres termes et en se fondant sur les dispositions transitoires de l’article L.123-19 du Code de l’urbanisme, la Cour a donc considéré que la légalité des prescriptions d’urbanisme locales régissant les droits à construire attachés aux terrains issus d’une division foncière n’avaient pas été rendues illégales par l’intervention de l’article 13 de la loi du 13 décembre 2000, puisqu’au regard de l’article R.123-21 alors applicables de telles prescriptions étaient permises.
Mais force est dés lors de s’interroger sur la légalité de prescriptions édictant des règles équivalentes à l’article L.111-5 du Code de l’urbanisme mais adoptés postérieurement à son abrogation puisque la Cour a souligné que ce dernier était en vigueur au moment où avait été adopté l’article 5 du POS en cause.
A priori, la légalité de ces dispositions ne seraient pas contestables dans la mesure où, d’une part, elles n’apparaissent pas excéder l’habilitation conférer aux règlements d’urbanisme locaux par les articles L.123-1 et R.123-9 du Code de l’urbanisme et où, d’autre part, l’abrogation de l’article L.111-5 du Code de l’urbanisme ne s’est pas accompagnée de l’introduction d’un règle expresse et générale selon laquelle les droits à construire attachés aux terrains issus d’une division foncière doivent être établis indépendamment de ceux déjà consommés sur leur unité foncière d’origine.
Il reste que l’article 18 de la loi du 2 juillet 2003 dite « Urbanisme & Habitat » a ultérieurement introduit un nouvel article L.123-1-1au Code de l’urbanisme – et disposant que « dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés » – qu’il est difficile de comprendre autrement que comme signifiant que les PLU ne peuvent régir spécifiquement la constructibilité des terrains issus d’une division foncière que s’agissant du coefficient d’occupation des sols.
Mais comment comprendre alors le nouvel article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme – issu du décret du 5 janvier 2007 – lequel dispose que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose » alors qu’à suivre l’article L.123-1-1 précité, une telle faculté n’est permise que s’agissant du coefficient d’occupation des sols.
Certes dans la mesure où il intervient à la suite de l’article R.123-10 du Code de l’urbanisme relatif à la définition et aux modalités d’application du coefficient d’occupation des sols, il pourrait être compris que l’article R.123-10 ne vise que les règles s’y rapportant.
Il reste que, d’une part, l’article précité vise l’ensemble « (d) es règles édictées par le plan local d'urbanisme » et que, d’autre part et plus spécifiquement, c’est très certainement pour ce qui concerne le coefficient d’occupation des sols que l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme est le moins abouti puisque si les PLU peuvent utilement s’opposer au principe posé par cet article à l’égard des permis de construire valant division dans la mesure où le plan de division dorénavant imposé de façon systématique par l’article R.431-24 n’a plus pour objet de ventiler la SHON constructible, il leur sera plus difficile de le faire à l’égard des lotissements dès lors que l’article R.442-9 du Code de l’urbanisme précise que « lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot ».
Force est donc de considérer que l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme induit que les PLU peuvent édicter des règles spécifiques s’agissant de la constructibilité des terrains issus d’une division foncière. Il reste que l’examen des travaux préparatoires à la réforme des autorisations d’urbanisme révèle que cet article est destinée à résoudre les divergences de la jurisprudence sur cette question mais n’a pas vocation formellement à définir les règles que peuvent édicter les PLU à cet égard alors, rappelons-le, qu’une telle possibilité se limiterait, rappelons-le, au seul coefficient d’occupation des sols aux termes de l’article L.123-1-1 du Code de l’urbanisme, lequel n’a pas été modifié par cette réforme. Et au surplus, force est de préciser que si l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme a pour objectif de trancher définitivement la question de l’application des prescriptions des règlements locaux d’urbanisme aux opérations impliquant une division foncière, il reste que la solution ainsi retenue est quasi-identique à celle mise en œuvre par la jurisprudence récente et selon laquelle, par principe, les prescriptions de ces règlements s’appliquent à l’échelle de l’unité foncière et non pas à l’échelon des terrains à constituer dans le cadre d’une division foncière ; sauf à ce qu’il prévoit expressément le contraire puisqu’à titre d’exemple, il a pu être jugé que :
« Considérant qu'aux termes de l'article I NB 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bonifacio, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « Il est exigé un seul volume de construction par unité foncière » ; qu'en l'absence de toute indication contraire, il résulte de ces dispositions que l'unité foncière doit s'apprécier telle qu'elle est constituée à la date à laquelle l'autorité administrative statue sur la demande de permis de construire » (CAA. Marseille, 2 juin 2005, Préfet de la Corse du Sud, req. n°03MA00163) ;
et, a contrario, que :
« Considérant qu'aux termes de l'article UEa 5 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Sceaux : Pour être constructibles, les terrains doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes :... 5.2 Terrains provenant de divisions parcellaires, volontaires ou non, postérieurement à la date de publication du plan d'occupation des sols : surface : 300 m², de forme régulière et de dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'inscrire un rectangle de 12 mètres x 20 mètres... ;
Considérant que les constructions projetées, présentées dans le dossier de demande du permis de construire litigieux comme deux bâtiments à usage d'habitations totalisant trois logements, ne présentent aucune différence avec celles qui avaient fait l'objet d'une première demande de permis, qui portait sur la construction d'un ensemble de trois maisons ; que le projet ne prévoit pas de parties communes aux bâtiments, à l'exception de la partie du sous-sol destinée au stationnement des véhicules ; qu'ainsi, et bien que les deux constructions jumelées comportent certaines superstructures et une dalle uniques, ce projet doit être regardé, pour l'application des dispositions réglementaires précitées, comme portant en réalité sur la réalisation de trois pavillons, dont deux accolés ; que, nonobstant la circonstance que ces pavillons constituent une copropriété, la réalisation du projet entraînera la division, au moins en jouissance, du terrain d'assiette, laquelle constitue une division parcellaire au sens des dispositions de l'article UEa 5 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le terrain d'assiette du projet n'est pas, compte tenu de ses caractéristiques, de nature à permettre que chacun des trois pavillons soit édifié sur une division de ce terrain respectant les exigences de forme et de dimensions énoncées par les dispositions précitées de l'article UEa 5 ; que, dès lors, le permis litigieux a été délivré en méconnaissance desdites dispositions réglementaires » (CAA. Paris, 31 décembre 2004, Cne de Sceaux, req. n°01PA00560).
Il incombera donc à la jurisprudence à venir de trancher cette délicate question. Il reste qu’à s’en tenir à l’arrêt commenté, il semble falloir considérer qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 13 de la loi du 13 décembre 2000, de article L.123-1-1 et de l’article R.123-10 du Code de l’urbanisme que les prescriptions de règlements locaux d’urbanisme introduisant des règles équivalentes à celles posées par l’article L.111-5 :
- avant l’entrée en vigueur de l’article 13 de la loi du 13 décembre 2000 et, peut être, avant l’entrée en vigueur de l’article L.123-1-1 du Code de l’urbanise sont légales ;
- après l’entrée en vigueur de l’article L.123-1-1 du Code de l’urbanisme ne seraient légales qu’à conditions de considérer que ce dernier n’a pas entendu limiter la possibilité de définir des règles spécifiques aux terrains issus d’une division foncière pour le seul coefficient d’occupation des sols mais vise uniquement à encadrer cette possibilité et à en préciser les modalités d’application…
La question posée par l’arrêté commenté renvoie donc à celle de l’utilité de l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme au regard des dispositions législatives de l’article L.123-10-1 du Code de l’urbanisme puisque si le principe posé par le premier n’est pas sans intérêt s’agissant des règles relatives à l’implantation des constructions, c’est principalement pour résoudre les difficultés liées à la détermination des droits à construire attachés aux terrains issus d’une division foncière et aux contraintes s’en suivant pour les lotisseurs et les constructeurs qu’il a été voulu…
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés