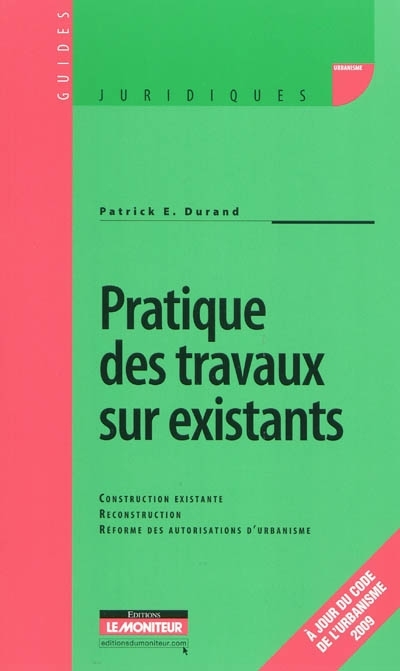INTERPRETATION ET APPLICATION DES PRESCRIPTIONS D’URBANISME :
CAA. Marseille, 29 mai 2008, GFA du Forest, req. n°06MA01537
Pour l’application de l’article 1er d’un règlement de zone naturel disposant « sont admises » (...) « pour l'ensemble de la zone NC » (...) les constructions que nécessite l'exploitation des richesses naturelles de la zone et les habitations qui leurs sont liées », l’administration doit, pour apprécier la légalité de permis de construire un hangar et une maison et même lors que le règlement ne le prévoit pas, s'interroger sur la complémentarité entre les différents types de constructions, laquelle peut se déduire soit de la réalisation d'un bâtiment unique à usage mixte, soit tenir comme en l'espèce à la nature des cultures et activités de l'exploitant.
CAA. Bordeaux, 11 juillet 2008, Mme X, req. n°06BX01786
Les dispositions de l’ancien article R. 111-18 du code de l'urbanisme – « lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques (...) » – ne concernent pas des voies purement internes au projet que celui-ci prévoit ; par suite le moyen tiré de ce que les constructions projetées seraient édifiées, par rapport aux voies de circulation prévues à l'intérieur de l'ensemble immobilier, en méconnaissance de la règle posée par l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme est inopérant.
CE. 27 juin 2008, M. Alain A., req. n°287.645
L'article 8 d’un règlement de POS prescrivant qu'il ne peut y être édifié « plus d'une construction à usage d'habitation sur un même lot constructible qui ne comprendra qu'un seul logement » régit l'implantation des constructions nouvelles les unes par rapport aux autres sur une même propriété, mais non l'aménagement d'une construction existante. Il s’ensuit que cette disposition ne peut légalement justifier un refus de permis de construire lorsque le projet d'aménagement conduit à la création d'un second logement sur une même parcelle alors qu'il est constant que ce projet consiste uniquement à aménager des logements dans un bâtiment existant
CAA. Marseille, 26 juin 2008, Christian X., req. n°05MA02570
Compte tenu du principe d’indépendance des législations, les risques de pollution générés par l’activité développée au sein du bâtiment agricole autorisé ne saurait être utilement invoqués à l’appui d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’ancien article R.111-14-2 du Code de l’urbanisme.
CAA. Bordeaux, 24 juin 2008, M. Jean X., req. n°06BX01902
Pour application de disposition autorisant dans une certaine limite les extensions de construction existante, le respect de cette limite doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des extensions de la construction initiale précédemment réalisées.
CAA. Marseille, 17 juin 2008, Cen d’Hyères-les-Palmiers, req. n°05MA01984
Une construction d’une longueur de 15,80 mètres accolée à une construction voisine sur seulement 8,20 mètres ne saurait être considérée comme jumelée à cette dernière.
CAA. Marseille, 11 juin 2008, SCCV Studium, req. n°06MA01576
Compte tenu de l’objet et de la finalité de l’article 12 d’un règlement local d’urbanisme, à savoir « d'adapter les exigences de création de places de stationnement à la destination effective des constructions et aux conséquences de leur type d'occupation sur l'accroissement prévisible du nombre de véhicules dans le secteur d'implantation » une résidence service pour étudiant doit être considéré comme à destination d’habitation et non à destination d’hôtel dès lors que cette construction est principalement destinée au logement permanent de résidents devant occuper ces logements pendant une durée significative, à l'inverse des clients des hôtels dont les besoins et les pratiques en matière de transport individuel ont une incidence moindre sur la circulation automobile générale et le stationnement, alors même que le projet prévoit certains services communs, d'accueil, de buanderie ou de loisirs destinés aux résidents.
CAA. Lyon, 27 mai 2008, Cne de Val-d’Isère, req. n°05LY00216
En l’absence de PAZ, l’annulation d’une délibération en tant qu’elle avait adopté le programme des équipements publics d’une ZAC s’oppose à ce qu’un permis de construire délivré au sein de celle-ci soit considéré comme une opération d’ensemble comme l’exige l’article 1er du règlement de POS, y compris si l’annulation de cette délibération est postérieure à la date de délivrance dudit permis et ce, quand bien même les équipements publics en cause avaient-ils déjà été réalisés à la date de délivrance de cette autorisation.
TA. PAU, 22 mai 2008, Association défense Saint-Pauloise de l’environnement, req. n°06-00049
Eu égard à la configuration des lieux, et en particulier, à la présence de deux étangs situés à proximité du bâtiment existant à usage professionnel, les bureaux annexes en litige, d’une surface hors œuvre nette de 44 m2, qui ne bénéficient pas d’un accès autonome, et bien que non accolés à la construction initiale, sont reliés à elle par un couloir d’une faible longueur (3,48 mètres) et présentent ainsi le caractère d’une extension d’une construction existante au sens des dispositions de l’article 1er du PLU communal
CE. 21 mai 2008, Cne de Houilles, req. n°296.156
Toute décision de préemption d'un bien apporte une limitation au droit de propriété du vendeur et affecte à ce titre les intérêts de celui-ci qui a, dès lors, intérêt à en demander l'annulation pour excès de pouvoir. Cet intérêt existe aussi bien lorsque le prix fixé par le juge de l'expropriation est inférieur à celui figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner que dans le cas où la préemption s'est faite à ce dernier prix. Ainsi, la circonstance que le transfert de propriété a eu lieu à la date à laquelle le vendeur introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision ne fait pas disparaître l'atteinte portée à ses intérêts et est, dès lors, sans effet sur son intérêt à agir.
CAA . Bordeaux, 13 mai 2008, SCI Des Samedis, req. n°06BX02481
Dès lors qu’une partie du projet de lotissement objet de la demande certificat d’urbanisme est sise dans une zone dont le règlement interdit les lotissements, l’administration est tenue d’opposer un certificat d’urbanisme.
CE. 16 avril 2008, M. Marcel X…, req. n°305.306 :
« Considérant que, par une décision du 30 septembre 2005, le maire de la COMMUNE DE NEUBOIS a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. le 29 juillet 2005 en vue de la construction d'une piscine non couverte ; que, saisi par M. et Mme A, voisins de M. , d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et de celle par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à leur demande par un jugement du 13 mars 2007 contre lequel M. et la COMMUNE DE NEUBOIS se pourvoient en cassation ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes des articles 1 et 2 du chapitre IV relatif aux dispositions applicables à la zone NC du plan d'occupation des sols : « En ce qui concerne les constructions, sont interdits : les bâtiments de toute nature à l'exception : de la reconstruction dans un délai de 2 ans en cas de sinistres, les aménagements, transformations et extensions mesurées des constructions existant à la date de publication du POS, mais non le changement de destination de ceux-ci, des additions mesurées d'annexes aux constructions d'habitation existant dans la zone NC à la date de publication du présent POS, à moins de 20 m de celles-ci, (…) En ce qui concerne les installations et travaux divers : sont interdits : (…) les affouillements et exhaussements du sol portant atteinte à la qualité des paysages » ; Considérant que, pour annuler les décisions litigieuses, le tribunal administratif s'est borné, après avoir cité ces dispositions, à énoncer que l'implantation de la construction projetée se situait principalement dans la zone NCb du plan d'occupation des sols ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une piscine non-couverte ne constitue pas un bâtiment et que, en tout état de cause, la seule implantation en zone NC ne suffisait pas, par elle-même, à caractériser une atteinte au paysage, le tribunal administratif n'a pas légalement justifié sa décision »
CE. 21 mars 2008, Cortes, req. n°296.239
« Considérant, d'autre part, que l'édification d'une piscine non couverte, construction qui n'est pas un bâtiment et qui doit donner lieu, en vertu du k) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, à une déclaration de travaux, est soumise au respect des règles d'urbanisme relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols, notamment à celles qui régissent, de manière générale, l'emprise au sol des constructions, sous réserve des prescriptions propres aux piscines non couvertes que prévoit, le cas échéant, le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme ».
CE. 20 février 2008, Doenni, req. n°298.058
« Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l'article UG 10 du POS : "La hauteur d'une façade est mesurée du sol naturel à l'égout de toiture. La hauteur des constructions est fixée à six mètres maximum soit R+1. Toutefois, la hauteur mesurée entre l'égout de toiture et la ligne de faîtage ne doit pas dépasser six mètres" ; que ces dispositions ne comportent aucune exception ; qu’ainsi, en l'absence de règle particulière applicable au cas d'un bâtiment constitué de plusieurs bungalows accolés, construit sur une parcelle en forte déclivité, la hauteur d'un tel bâtiment doit être appréciée, en tout point, du sol naturel à l'égout de toiture »
CAA. Bordeaux, 5 février 2008, Sté Osmose, req. n°06BX00977
« Considérant qu'aux termes de l'article ZC8 du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Centre bourg de la commune : La distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée à la demi hauteur de la construction la plus haute ; qu'il ressort des pièces du dossier que les bâtiments 3 et 5 du projet en cause sont séparés du bâtiment 4, qui est d'une hauteur de 10 mètres à l'égout du toit, et en sont distants de moins de 2 mètres ; que, s'agissant d'une règle d'hygiène, de salubrité et de sécurité imposée par les dispositions précitées, ces constructions doivent être regardées, nonobstant la présence d'un escalier entre les bâtiments 3 et 4, d'un portique entre les bâtiments 4 et 5 et de leur implantation sur un sous-sol commun à l'ensemble de la construction hôtelière projetée, comme des constructions non contiguës ; que les distances entre ces constructions étant inférieures à leur demi-hauteur, le maire d'Arcangues était tenu de refuser, par la décision du 2 janvier 2004, le permis de construire sollicité par la SOCIETE OSMOSE »
CAA. Paris, 28 janvier 2008, M & Mme Dominique X., req. n°06VE00602
« Considérant qu'aux termes de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry : «7.1. Bâtiments d'habitation : / ces constructions sont autorisées : /7.1.1. -sur les limites séparatives : si la façade sur la limite ne comporte pas de baie autre que des jours de souffrance. / 7.1.2. en retrait des limites séparatives : dans ce cas, elles devront s'écarter des limites d'une distance égale : /. À un minimum de 8 mètres si la façade sur la limite comporte des baies principales, cette distance étant mesurée normalement à la façade, / . À un minimum de 3 mètres en tout point. / (...) Nota : (1) lorsqu'une façade comportant des baies principales n'est pas parallèle à la limite, les deux règles suivantes sont applicables : /. La distance à la limite séparative, mesurée normalement au milieu de la façade, devra être au moins égale à 8 mètres, /. La distance à la limite séparative, mesurée normalement en tout point de la façade devrait être au moins égale à 6 mètres.(...) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et notamment de l'adverbe « normalement » que la distance de 8 mètres mentionnée à l'article précité doit être mesurée, non comme le soutiennent les requérants selon une ligne perpendiculaire à la limite séparative, mais selon une ligne perpendiculaire à la façade qui comporte des baies en partant d'un point situé au milieu de cette façade ; que si ce mode de calcul peut avoir pour conséquence qu'un point d'une façade qui n'est pas parallèle à la limite séparative soit situé à une distance inférieure à la distance minimale de 8 mètres exigée en ce qui concerne les façades parallèles à la limite séparative, cette circonstance n'est pas de nature à révéler une contradiction dans les dispositions du plan d'occupation des sols de Châtenay-Malabry dans la mesure où l'impact d'une baie orientée de manière oblique par rapport aux limites séparatives est différent de celui d'une baie orientée parallèlement à la limite séparative ; qu'ainsi, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry doit être écarté »
CAA. Versailles, 10 janvier 2008, SCI Le Pic, req. n°06VE00353
« Considérant, en second lieu, que l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Médan n'admet dans le secteur ND a, où se trouve le terrain d'assiette du projet litigieux, que « les bâtiments et installations à destination de sports et loisirs et culturels, les hôtels et restaurants, les constructions nécessaires à leur fonctionnement tels que logements de fonction, petits bureaux et petits commerces », ainsi que « les équipements publics à usage scolaire ou communal » ; Considérant qu'il ressort de la demande de permis de construire que la SOCIETE CIVILE LE PIC a sollicité une autorisation pour la construction de deux maisons individuelles à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 234 mètres carrés ; que si la notice descriptive jointe à cette demande fait état de ce qu'un « terrain de tennis sera prévu s'articulant autour de la piscine existante… une aire de jeux sera réalisée », il ressort des pièces du dossier que les installations sportives existantes à la date de la décision attaquée sont limitées à une piscine de 17 mètres sur 7 et que le terrain d'assiette supporte déjà un logement de gardien et un bureau ; que, dans ces conditions, les constructions autorisées par le permis litigieux ne peuvent être regardées comme étant nécessaires au fonctionnement d'une installation sportive ; que, dès lors, l'autorisation a été délivrée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune »
CAA. Versailles, 10 janvier 2008, Cne de Vert le Grand, req. n°06VE01769
« Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UG5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND, pour être constructible, une unité foncière doit être de dimension suffisante pour qu'il soit possible d'y inscrire une construction de 300 m2 de surface hors oeuvre nette, en application du coefficient d'occupation des sols limité à 0,5 ; que l'article UG8 dudit plan autorise l'implantation de plusieurs bâtiments à usage d'habitation sur une même unité foncière à condition que cette dernière soit suffisante pour respecter les conditions fixées à l'article 5 en cas de division ; que, pour rejeter la demande de permis de construire un ensemble immobilier comprenant deux sous-ensembles composés de cinq habitations chacun, le maire de la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND a estimé que chaque habitation devait, en vertu de ces dispositions combinées, s'inscrire dans une parcelle d'une surface minimale de 600 m2, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que la société Promotion et Investissements fait valoir qu'en l'absence de division en propriété ou en jouissance du sol d'assiette de chaque habitation et du jardin attenant, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions à chacune des dix habitations construites sur le terrain, mais à chacun des deux sous-ensembles comprenant cinq habitations chacun ; Considérant que nonobstant la disposition du règlement de division et de propriété relatif à l'ensemble immobilier qui précise à cet égard dans son chapitre III, section II, A que « la totalité du sol bâti et non bâti de l'ensemble immobilier » relève des « parties communes générales à tous les copropriétaires sans exception », il ressort des pièces du dossier que chaque copropriétaire attributaire d'un lot correspondant à la totalité d'une unité d'habitation dispose non seulement d'un droit d'usage exclusif du sol d'assiette de cette unité, dès lors qu'il peut notamment demander une autorisation de construire après avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, mais encore du jardin attenant, qui peut être clôturé avec pose d'un portillon et aménagé à son goût ; que, par suite, le projet litigieux doit être regardé comme emportant division en jouissance de la propriété foncière pour l'application combinée des articles 5 et 8 du règlement de la zone UG du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND ; que la surface du terrain d'assiette de chaque unité d'habitation n'est que de 214,7 m2, inférieure à la surface minimale requise ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet ne méconnaît pas les dispositions combinées des articles UG5 et UG8 du plan d'occupation des sols »
CE. 21 mars 2008, Cortes, req. n°296.239
« Considérant, d'autre part, que l'édification d'une piscine non couverte, construction qui n'est pas un bâtiment et qui doit donner lieu, en vertu du k) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, à une déclaration de travaux, est soumise au respect des règles d'urbanisme relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols, notamment à celles qui régissent, de manière générale, l'emprise au sol des constructions, sous réserve des prescriptions propres aux piscines non couvertes que prévoit, le cas échéant, le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme ».
CE. 20 février 2008, Doenni, req. n°298.058
« Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l'article UG 10 du POS : "La hauteur d'une façade est mesurée du sol naturel à l'égout de toiture. La hauteur des constructions est fixée à six mètres maximum soit R+1. Toutefois, la hauteur mesurée entre l'égout de toiture et la ligne de faîtage ne doit pas dépasser six mètres" ; que ces dispositions ne comportent aucune exception ; qu’ainsi, en l'absence de règle particulière applicable au cas d'un bâtiment constitué de plusieurs bungalows accolés, construit sur une parcelle en forte déclivité, la hauteur d'un tel bâtiment doit être appréciée, en tout point, du sol naturel à l'égout de toiture »
CAA. Bordeaux, 5 février 2008, Sté Osmose, req. n°06BX00977
« Considérant qu'aux termes de l'article ZC8 du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Centre bourg de la commune : La distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée à la demi hauteur de la construction la plus haute ; qu'il ressort des pièces du dossier que les bâtiments 3 et 5 du projet en cause sont séparés du bâtiment 4, qui est d'une hauteur de 10 mètres à l'égout du toit, et en sont distants de moins de 2 mètres ; que, s'agissant d'une règle d'hygiène, de salubrité et de sécurité imposée par les dispositions précitées, ces constructions doivent être regardées, nonobstant la présence d'un escalier entre les bâtiments 3 et 4, d'un portique entre les bâtiments 4 et 5 et de leur implantation sur un sous-sol commun à l'ensemble de la construction hôtelière projetée, comme des constructions non contiguës ; que les distances entre ces constructions étant inférieures à leur demi-hauteur, le maire d'Arcangues était tenu de refuser, par la décision du 2 janvier 2004, le permis de construire sollicité par la SOCIETE OSMOSE »
CAA . Marseille, 5 février 2008, M. Michelle .X., req. n°05MA01209
Pour application de l’article 3 d’un règlement local d’urbanisme disposant que « pour toute voie ou chemin desservant 10 logements ou plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats . En aucun cas la plate forme supportant la voie et le cheminement sera inférieure à 5 mètres », il convient de prendre en compte l’ensemble des logements desservis par la voie en cause, y compris ceux inhabités ou desservis par une autre voie.
CAA. Paris, 28 janvier 2008, M & Mme Dominique X., req. n°06VE00602
« Considérant qu'aux termes de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry : «7.1. Bâtiments d'habitation : / ces constructions sont autorisées : /7.1.1. -sur les limites séparatives : si la façade sur la limite ne comporte pas de baie autre que des jours de souffrance. / 7.1.2. en retrait des limites séparatives : dans ce cas, elles devront s'écarter des limites d'une distance égale : /. À un minimum de 8 mètres si la façade sur la limite comporte des baies principales, cette distance étant mesurée normalement à la façade, / . À un minimum de 3 mètres en tout point. / (...) Nota : (1) lorsqu'une façade comportant des baies principales n'est pas parallèle à la limite, les deux règles suivantes sont applicables : /. La distance à la limite séparative, mesurée normalement au milieu de la façade, devra être au moins égale à 8 mètres, /. La distance à la limite séparative, mesurée normalement en tout point de la façade devrait être au moins égale à 6 mètres.(...) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et notamment de l'adverbe « normalement » que la distance de 8 mètres mentionnée à l'article précité doit être mesurée, non comme le soutiennent les requérants selon une ligne perpendiculaire à la limite séparative, mais selon une ligne perpendiculaire à la façade qui comporte des baies en partant d'un point situé au milieu de cette façade ; que si ce mode de calcul peut avoir pour conséquence qu'un point d'une façade qui n'est pas parallèle à la limite séparative soit situé à une distance inférieure à la distance minimale de 8 mètres exigée en ce qui concerne les façades parallèles à la limite séparative, cette circonstance n'est pas de nature à révéler une contradiction dans les dispositions du plan d'occupation des sols de Châtenay-Malabry dans la mesure où l'impact d'une baie orientée de manière oblique par rapport aux limites séparatives est différent de celui d'une baie orientée parallèlement à la limite séparative ; qu'ainsi, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry doit être écarté »
CAA. Versailles, 10 janvier 2008, SCI Le Pic, req. n°06VE00353
« Considérant, en second lieu, que l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Médan n'admet dans le secteur ND a, où se trouve le terrain d'assiette du projet litigieux, que « les bâtiments et installations à destination de sports et loisirs et culturels, les hôtels et restaurants, les constructions nécessaires à leur fonctionnement tels que logements de fonction, petits bureaux et petits commerces », ainsi que « les équipements publics à usage scolaire ou communal » ; Considérant qu'il ressort de la demande de permis de construire que la SOCIETE CIVILE LE PIC a sollicité une autorisation pour la construction de deux maisons individuelles à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 234 mètres carrés ; que si la notice descriptive jointe à cette demande fait état de ce qu'un « terrain de tennis sera prévu s'articulant autour de la piscine existante… une aire de jeux sera réalisée », il ressort des pièces du dossier que les installations sportives existantes à la date de la décision attaquée sont limitées à une piscine de 17 mètres sur 7 et que le terrain d'assiette supporte déjà un logement de gardien et un bureau ; que, dans ces conditions, les constructions autorisées par le permis litigieux ne peuvent être regardées comme étant nécessaires au fonctionnement d'une installation sportive ; que, dès lors, l'autorisation a été délivrée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune »
CAA. Versailles, 10 janvier 2008, Cne de Vert le Grand, req. n°06VE01769
« Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UG5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND, pour être constructible, une unité foncière doit être de dimension suffisante pour qu'il soit possible d'y inscrire une construction de 300 m2 de surface hors oeuvre nette, en application du coefficient d'occupation des sols limité à 0,5 ; que l'article UG8 dudit plan autorise l'implantation de plusieurs bâtiments à usage d'habitation sur une même unité foncière à condition que cette dernière soit suffisante pour respecter les conditions fixées à l'article 5 en cas de division ; que, pour rejeter la demande de permis de construire un ensemble immobilier comprenant deux sous-ensembles composés de cinq habitations chacun, le maire de la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND a estimé que chaque habitation devait, en vertu de ces dispositions combinées, s'inscrire dans une parcelle d'une surface minimale de 600 m2, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que la société Promotion et Investissements fait valoir qu'en l'absence de division en propriété ou en jouissance du sol d'assiette de chaque habitation et du jardin attenant, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions à chacune des dix habitations construites sur le terrain, mais à chacun des deux sous-ensembles comprenant cinq habitations chacun ; Considérant que nonobstant la disposition du règlement de division et de propriété relatif à l'ensemble immobilier qui précise à cet égard dans son chapitre III, section II, A que « la totalité du sol bâti et non bâti de l'ensemble immobilier » relève des « parties communes générales à tous les copropriétaires sans exception », il ressort des pièces du dossier que chaque copropriétaire attributaire d'un lot correspondant à la totalité d'une unité d'habitation dispose non seulement d'un droit d'usage exclusif du sol d'assiette de cette unité, dès lors qu'il peut notamment demander une autorisation de construire après avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, mais encore du jardin attenant, qui peut être clôturé avec pose d'un portillon et aménagé à son goût ; que, par suite, le projet litigieux doit être regardé comme emportant division en jouissance de la propriété foncière pour l'application combinée des articles 5 et 8 du règlement de la zone UG du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND ; que la surface du terrain d'assiette de chaque unité d'habitation n'est que de 214,7 m2, inférieure à la surface minimale requise ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet ne méconnaît pas les dispositions combinées des articles UG5 et UG8 du plan d'occupation des sols »
POS/PLU & CARTE COMMUNALE :
CAA. Bordeaux, 11 juillet 2008, M. André X., req. n°06BX02600
La circonstance que l’arrêté par lequel le maire a fixé les dates d'ouverture de l'enquête publique ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur est par elle-même, compte tenu de la nature et de l'objet d'un tel acte, sans incidence sur la légalité de la délibération par laquelle le conseil municipal approuve la carte communale et de la décision préfectorale d'approbation de cette carte.
CAA. Marseille, 7 juillet 2008, M. Tigrane X., req. n°05MA01486
Dès lors que seul conseil municipal est compétent pour arrêter le plan soumis à l'enquête publique et l'approuver ensuite après modifications éventuelles, le maire en cette qualité n’est pas compétent pour proposer au cours de l'enquête toute modification du projet soumis, dans l'état adopté par le conseil municipal, à la dite enquête.
CAA . Paris, 5 juin 2008, M. Y.X., req. n°07PA04240
L’abrogation de l’article L.111-5 du Code de l’urbanisme par la loi du 13 décembre 200 dite « SRU » n’a pas pour effet d’affecter d’illégalité les articles 5 des règlements locaux d’urbanisme régissant la surface minimale des terrains à construire.
CAA. Bordeaux, 27 mai 2008, Ministère de l’équipement, req. n°06BX01522
La décision d'instituer une carte communale constitue, eu égard aux effets d'un tel document à l'égard des tiers, une affaire de la commune dont il appartient au conseil municipal de connaître en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, si le maire peut conduire l'élaboration d'une telle carte en vertu de l'article R. 124-4 du code de l'urbanisme, il ne peut décider seul, sans délibération préalable du conseil municipal, d'instituer une telle carte nonobstant l'absence de dispositions spécifiques en décidant ainsi dans le code de l'urbanisme.
CAA. Lyon, 6 mai 2008, M. Daniel X. et M. Olivier X., req. n°07LY00846
« Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 les plans peuvent : « ... 7°/Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, ilôts, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ... » ; Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme ont décidé d'instituer l'obligation d'un permis de démolir sur l'ensemble des zones urbaines qu'ils ont délimitées ; que ces zones urbaines comprennent une zone UA correspondant au bourg où prédomine un habitat ancien, et une zone UB à la périphérie dudit bourg où prédomine un habitat pavillonnaire récent ; que, s'il ressort notamment du rapport de présentation que la zone UA comporte un patrimoine bâti de caractère, dont l'institution du permis de démolir, peut contribuer à assurer la préservation, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que la zone UB comporterait des éléments bâtis appelant une mise en valeur ou une protection particulière ; que le rapport de présentation qui note qu'à l'approche du village on distingue clairement l'habitat le plus récent des constructions anciennes, ne fait d'ailleurs état de l'intérêt de l'institution du permis de démolir pour la conservation d'éléments intéressants du patrimoine bâti que pour la zone UA ; que les requérants sont, par suite fondés, à soutenir que l'institution d'un permis de démolir, qui n'entre pas, pour la zone UB , dans les prévisions des dispositions précitées des articles L. 430-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, est entaché d'illégalité ; qu'ils sont, dans ces conditions, fondés à demander l'annulation de cette disposition divisible des autres dispositions du plan local d'urbanisation ».
CAA . Bordeaux, 4 mars 2008, APA, req. n°06PA00528
L’article d’un règlement de zone permettant l’édification de construction d’une hauteur de 21 mètres sur six niveaux alors que les constructions existantes dans cette zone ont rarement plus de trois niveaux est entaché d’illégalité au regard de l’article L.123-1-II-4° du Code de l’urbanisme.
EMPLACEMENTS RESERVES :
CAA. Marseille, 13 mars 2008, Cne de Beausoleil, req. n°06BX01522
« Considérant que la COMMUNE DE BEAUSOLEIL soutient que la construction de l'ouvrage d'infrastructure en sous-sol de l'emplacement réservé n°3 était nécessaire à la construction de la liaison routière pour laquelle cet emplacement a été prévu par le plan d'occupation des sols de la commune et qu'ainsi, cet ouvrage et, par voie de conséquence, les places de stationnement créées à l'intérieur de son volume doivent être regardés, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, comme étant conformes à la destination dudit emplacement ; que, toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ouvrage d'infrastructure susmentionné, tel qu'il est projeté, dans toutes ses caractéristiques, par la pétitionnaire, soit indispensable à la réalisation de la liaison routière susmentionnée, prévue entre la place de la Source et la rue des martyrs de la Résistance, alors que cela est contesté par le préfet des Alpes-Maritimes ; que, d'autre part, et en tout état de cause, à supposer même que ledit ouvrage puisse être regardé comme étant indispensable à la création de ladite voirie, le parc de stationnement ne saurait, du seul fait de son incorporation dans le volume de cette infrastructure, à la création de laquelle il est constant qu'il n'est pas lui-même nécessaire, être regardé comme étant conforme à la destination de l'emplacement réservé n°3 ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE BEAUSOLEIL était tenu, en application des dispositions précitées, de refuser de délivrer le permis modificatif litigieux à la S.C.I. Monte Cristo »
CE. 7 mars 2008, Boutin, req. n°301.719
« Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, hors le cas des constructions conformes à la destination de l'emplacement réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, seules les constructions présentant un caractère précaire peuvent être légalement autorisées sur un tel emplacement par un permis de construire ou, en vertu des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 4221 et du premier alinéa de l'article L. 4213 du même code dans leur rédaction alors en vigueur, par une autorisation de travaux, avec l'accord de la collectivité intéressée à l'opération, et que les constructions qui ne satisfont pas à ces conditions ne peuvent légalement être édifiées qu'à l'extérieur de l'emprise de l'emplacement réservé ; que, dans ce dernier cas, il appartient à l'autorité compétente qui entend autoriser une telle construction de prescrire son édification à une distance minimale de la limite séparative suffisante pour prévenir un empiètement sur l'emplacement réservé, et, lorsque la construction ne pourrait, du fait d'un tel emplacement réservé, jouxter la limite parcellaire, sans que cette distance puisse être inférieure à la distance minimale prévue à l'article R. 11119 du code de l'urbanisme alors en vigueur ou, le cas échéant, par les dispositions du plan d'occupation des sols ayant le même objet »
CE. 7 mars 2008, Boutin, req. n°301.719
« Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, hors le cas des constructions conformes à la destination de l'emplacement réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, seules les constructions présentant un caractère précaire peuvent être légalement autorisées sur un tel emplacement par un permis de construire ou, en vertu des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 4221 et du premier alinéa de l'article L. 4213 du même code dans leur rédaction alors en vigueur, par une autorisation de travaux, avec l'accord de la collectivité intéressée à l'opération, et que les constructions qui ne satisfont pas à ces conditions ne peuvent légalement être édifiées qu'à l'extérieur de l'emprise de l'emplacement réservé ; que, dans ce dernier cas, il appartient à l'autorité compétente qui entend autoriser une telle construction de prescrire son édification à une distance minimale de la limite séparative suffisante pour prévenir un empiètement sur l'emplacement réservé, et, lorsque la construction ne pourrait, du fait d'un tel emplacement réservé, jouxter la limite parcellaire, sans que cette distance puisse être inférieure à la distance minimale prévue à l'article R. 11119 du code de l'urbanisme alors en vigueur ou, le cas échéant, par les dispositions du plan d'occupation des sols ayant le même objet »
ZAC :
CAA. Paris, 8 juillet 2008, Cne de Boissise-le-Roi, req. n°07PA03281
Il résulte des modifications apportées aux dispositions du code de l'urbanisme applicables aux ZAC par l'article 7 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains que rien n'interdit que la réalisation des équipements prévus dans une telle zone ne soit pas compatible avec le plan d'urbanisme en vigueur lors de la création de cette zone, cette réalisation ne pouvant alors intervenir qu'après la modification de ce plan.
CONCERTATION :
CAA. Marseille, 15 mai 2008, Crts X., req. n°05MA01226
L’article L.300-2 du Code de l’urbanisme n’impose pas que la décision de renouveler l’application anticipée d’un POS soit précédée d’une nouvelle concertation.
DROIT DE PREEMPTION :
CAA. Paris, 8 juillet 2008, Sté Foncière Paris 11, req. n°05PA02723
La circonstance que le projet ne pourrait être réalisé dans les conditions de financement dont faisait mention la décision de préemption est sans conséquence sur la légalité de celle-ci dès lors que cette indication, purement informative, n'est pas relative au motif de la préemption.
CAA. Lyon, 27 mai 2008, Cne de Saint-Etienne, req. n°07LY00493
Il résulte de l’article L. 213-1 du code de l'urbanisme et de l'article R. 213-15 du même code que si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commune ayant exercer son droit de préemption d'informer expressément le Tribunal de Grande Instance de sa renonciation à l'exercice de son droit de préemption ou n'exige des modalités particulières de notification de cette décision ou une transmission au préfet, la commune peut, cependant, de sa propre initiative, à réception de la déclaration préalable de vente, et avant même que cette vente n'ait lieu, faire connaître sa position au Tribunal de Grande Instance. Dès lors, le courrier de la commune par lequel elle indique renoncer à l'exercice de son droit de préemption sur le bien litigieux doit s'analyser comme un acte à portée décisoire qui a créé des droits au profit des acquéreurs éventuels du bien lors de la vente par adjudication. Par suite, cette décision ne pouvait être retirée par la commune, sous réserve de son illégalité, que dans le délai de quatre mois suivant son édiction. Dans ces conditions, la nouvelle décision de la commune d'exercer son droit de préemption sur le bien litigieux constitue le retrait de sa décision de renoncement qui intervenant plus de quatre mois après cette dernière est en cela illégale.
CAA. Bordeaux, 2 juin 2007, Cne de Plaisance du Touch, req. n°06BX02363
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le droit de préemption soit exercé par une commune dans le seul but d'une cession ultérieure à une autre collectivité ou à un établissement public dès lors que l'usage qui est fait de ce droit entre dans les prévisions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme
CE. 7 mars 2008, Cne de Meung-sur-Loire, req. n°288.371
« Considérant que, par un jugement du 27 janvier 2004, le tribunal administratif d'Orléans, saisi par M. A, acquéreur évincé, a annulé la délibération du 26 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MEUNG-SUR-LOIRE a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur une parcelle mise en vente par M. C et Mme B et située dans le centre ville de cette commune ; que la commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption »
CE. 23 janvier 2008, Cne de Romainville, req. n°308.995
« Considérant, en second lieu, que si les dispositions de l'article R. 213-21 exigent que pendant le délai d'un mois, la décision de préemption soit prise au vu de l'avis du service des domaines, la circonstance que cette décision soit prise le jour même de la réception de l'avis des domaines n'est pas à elle seule de nature à l'entacher d'illégalité ; qu'en l'espèce, toutefois, eu égard aux éléments produits devant lui quant à l'heure à laquelle cet avis a été reçu par la commune le 22 juin et quant à l'heure à laquelle la décision de préemption a été prise ce même jour par le maire, le juge des référés n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit en estimant que le maire n'avait pas pu avoir connaissance de cet avis avant de prendre sa décision et en en déduisant que le moyen tiré de l'absence d'avis régulier du service des domaines, préalable à la décision d'exercice du droit de préemption, était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux »
LOTISSEMENTS :
TA. Amiens, 18 mars 2008, Hendriks, req. n°06-01611
Alors même que les règles d'urbanisme contenues dans un cahier des charges approuvé d'un lotissement sont devenues caduques, il n'appartient pas à l'autorité administrative d'abroger ce document dans la mesure où il constitue un acte de droit privé relatif aux droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux
RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE :
CAA . Marseille, 7 février 2008, Mme X., req. n°05MA00811
L’obligation de reconstruire à l’identique résultant de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme implique une reconstruction totale et non pas seulement une reconstruction partielle.
AUTORISATIONS D’URBANISME :
CAA. Paris, 18 septembre 2008, Association universelle du royaume de dieu, req. n° 06PA01300
Il résulte de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme – dont on rappellera qu’il dispose que « lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. » - que c'est uniquement lorsque l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation de construire est devenue définitive que l'autorité compétente, ressaisie de la demande, ne peut se fonder sur des dispositions d'urbanisme postérieures à la décision annulée. IL s’ensuit que dans la mesure où la commune avait fait appel du jugement annulant le refus qu’elle avait opposé à une demande de permis de construire, celle-ci pouvait légalement opposer une décision de sursis cette même demande en considération de la procédure d’élaboration de PLU engagée postérieurement audit jugement.
CE. 7 juillet 2008, Cne de Verdun, req. n°296.438
Il résulte des dispositions combinées des anciens articles L.430-5 et L.430-8 du Code de l’urbanisme que si, lorsqu'un avis négatif a été émis sur une demande de permis de démolir, selon le cas, par le ministre chargé des monuments historiques, le ministre chargé des sites ou leur délégué ou par l'architecte des bâtiments de France, cet avis s'impose en principe au maire, ce dernier conserve, en cas d'avis favorable de ceux-ci délivrés au titre des lois du 31 décembre 1913 et du 2 mai 1930, la possibilité d'apprécier plus généralement si les travaux de démolition envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites et, le cas échéant, de refuser le permis sollicité ou de l'assortir de prescriptions spéciales. Il s’ensuit qu’il ne saurait être utilement soutenu que, l'architecte des bâtiments de France ayant émis un avis favorable à la démolition envisagée, le maire était tenu de délivrer le permis de démolir sollicité.
CE. 9 juillet 2008, Ministère de l’équipement, req. n°284.831
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une disposition d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé, cette circonstance ne s'oppose pas à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues. Et dans l'hypothèse où le permis de construire est relatif à une partie d'un ouvrage indivisible, il y a lieu d'apprécier cette meilleure conformité en tenant compte de l'ensemble de l'ouvrage.
CAA. Bordeaux, 8 juillet 2008, Cne d’Isle, req. n° 07BX00172
Une aire d’accueil pour les gens du voyage ne comportant que 24 emplacements n’est pas un « ERP ». Par suite, la délivrance du permis de construire s’y rapportant n’est pas subordonnée à la consultation préalable de la commission de sécurité.
CAA. Marseille, 26 juin 2008, Christian X., req. n°05MA02570
Dès lors que la qualité du pétitionnaire n’a par principe aucune incidence sur l’appréciation de la destination de la construction, inexactitude éventuelle de la qualité déclarée par celui-ci dans sa demande ne saurait entacher de fraude le permis de construire obtenu.
CAA. Bordeaux, 15 juin 2005, Association Vigilance et Intervention pour l’Environnement, req. n°05BX02044
L’étude d’impact au dossier de demande d’un permis de construire un installation classée pour la protection de l’environnement soumis à autorisation d’exploiter est celle prévue par le décret du 12 octobre 1977. Par suite, la circonstance que cette étude d’impact ne traite pas de la remise en état du site après exploitation est sans incidence sur la légalité du permis de construire obtenu dès lors qu’une étude d’impact n’a à traiter que des conditions de remise en état du site qu’en application de l’article 3 du décret du 21 septembre 1977, lequel n’est opposable qu’aux demandes d’autorisation d’exploiter.
CAA. Lyon, 8 juin 2008, Sté Enselia, req. n°07LY02694
Un recours tendant à faire constater la caducité d’un permis de construire n’emporte pas la suspension du délai de validité de celui-ci.
CAA. Bordeaux, 2 juin 2008, M. et Mme Damien, X. , req. n°06BX02366
Un refus ou un retrait de permis de construire peut être légalement fondé sur la circonstance que le projet de construction, en raison de son implantation, est de nature à faire obstacle au bon fonctionnement, à l'entretien ou à la conservation d'une canalisation protégée par une servitude instituée en application de la législation rurale.
CAA . Nancy, 2 juin 2008, Sté SCCV Pasteur Rousses, req. n°07PA00384
Des places de stationnement difficilement accessible car situées dernière d’autres ne peuvent être prises en compte pour apprécier la conformité du projet aux prescriptions de l’article 12 du règlement local d’urbanisme.
CAA. Paris, 22 mai 2008, SCI DU 14, rue du Parc, req. n°07PA02573
Il résulte de la lettre même de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme (anc.) qu’en dehors du cas où il porte sur une « ERP », le permis de construire ne sanctionne pas les règles d’accessibilité aux personnes handicapées.
CAA. Marseille, 20 mai 2008, Urbat Promotion Logements, req. n°05MA03175
Si les déclarations de la société pétitionnaire dans sa demande de permis de construire peuvent conduire le service instructeur à admettre qu'elle bénéficie des droits et modalités d'accès dont elle se prévaut, il lui appartient toutefois d'établir devant le juge de l'excès de pouvoir en cas de litige qu'elle est effectivement titulaire de la servitude dont elle se prévaut, alors que l'existence même de celle ci est contestée par le requérant réputé la lui avoir accordée. Par suite, dès lors que la société pétitionnaire ne produit aucun acte ou titre lui conférant un droit de passage sur la voie en cause et bien que celle-ci soutienne que les propriétaires du fonds dont elle a acquis une partie pour la réalisation de son projet bénéficient d'une servitude accordée en 1971, le permis de construire en date du 21 juillet 2003 méconnaît l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme dès lors que l'assiette de cette servitude, qui n' a pas été régulièrement modifiée à la date d'examen de son projet, et pour laquelle elle n'apporte par ailleurs aucune précision sur la configuration ou l'aménagement, n'est pas celle dont elle a déclaré bénéficier dans sa demande de permis et qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les anciens propriétaires du terrain d'assiette ont acquis par prescription trentenaire une servitude de passage sur la voie intérieure du lotissement alors qu'en tout état de cause il n'est pas contesté que cette tolérance de passage n'a été effective qu'à compter de l'année 1976.
TA. Amiens, 20 mai 2008, M. Demier, req. n°06-01596
Un permis de régularisation portant sur un centre hippique ne saurait être refusé au motif tiré de la surdensité du bâtiment d’habitation dès lors que pour être présents sur le même terrain, ces deux bâtiments n’en sont pas moins distincts.
CAA. Bordeaux, 19 mai 2008, SCI Parc de Fondargent, req. n°06BX01188
Lorsque la permission de voirie requise a été obtenu avant la délivrance du permis de construire mais n’a pas été jointe au dossier produit par le pétitionnaire, le permis de construire est illégal au regard de l’article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme, y compris si cette permission a été accordée par le maire ayant également délivré le permis de construire en cause.
CAA. Lyon, 6 mai 2008, Association pour la défense du Mezenc, req. n°07LY00474
L’article 2 du décret n°2006-958 du 31 juillet 2008 modifiant l’ancien article R.421-32 du Code de l’urbanisme n’a pas pour effet de faire revivre les permis de construire déjà frappés de caducité à la date de son entrée en vigueur.
CAA. Marseille, 30 avril 2008, Ministre de l’équipement, req. n° 05MA00656
Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, en l'absence de toute contestation, avait connaissance, avant de délivrer le permis de construire en litige, que M.X. qui avait signé la demande de permis de construire modificatif pour l'indivision « les gîtes de l'Adrech » n'avait pas un mandat l'autorisant, au nom desdites personnes, à régulariser les bâtiments en cause, il n’appartenait pas au maire de solliciter l'accord des indivisaires pour le projet litigieux ou, en admettant le statut de la copropriété applicable, l'accord des autres copropriétaires dudit terrain.
CAA. Bordeaux, 6 mars 2008, SCI Bonaparte, req. n°05BX01586 :
« Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 3ème alinéa du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date des permis attaqués : «Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.» et qu'aux termes de l'article L. 421-1 in fine du même code : «Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation» ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un permis de construire un établissement recevant du public doit être précédée de la consultation de la commission consultative de l'accessibilité ; que si la société requérante fait valoir que le pavillon réalisé sur le lot N° 23, objet du permis attaqué, ne constituerait qu'une annexe de l'ensemble hôtelier créé principalement sur les lots N°s 2, 3 et 4 et que cette commission a été consultée dans le cadre de l'instruction du permis de construire relatif aux bâtiments réalisés sur ces lots N°s 2, 3 et 4, le 9 juillet 2004, la consultation dont s'agit s'impose dans le cadre de l'instruction de chaque permis ; que par suite la consultation invoquée, au demeurant postérieure à la délivrance de l'autorisation litigieuse ne peut être regardée comme ayant été effectuée dans le cadre de l'instruction du permis relatif au pavillon réalisé sur le lot N° 23 ; qu'en l'absence de cette consultation, ledit permis est illégal ; Considérant que le permis de construire attaqué a été délivré pour la réalisation d'un pavillon d'un ensemble hôtelier sur le lot N° 23 du lotissement «Les Hauts de Beaufils» ; qu'aux termes de la notice explicative du projet de ce lotissement, il est constitué de «49 terrains à bâtir destinés à recevoir des habitations individuelles à usage d'habitation principale ou secondaire avec possibilité de location en meublé» ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement de ce lotissement «sur chacun des lots pourront être construits des bâtiments à usage d'habitation individuelle» ; qu'ainsi seuls des bâtiments à usage d'habitation individuelle peuvent être construits au sein du lotissement «Les Hauts de Beaufils» ; que dès lors le permis attaqué relatif à un projet hôtelier ne répondait pas à cette destination »
CAA. Bordeaux, 6 mars 2008, SCI Bonaparte, req. n°05BX01586 :
« Considérant que le permis de construire attaqué a été délivré pour la réalisation de pavillons, du hall d'accueil, du bar restaurant, de la cuisine et de la piscine d'un ensemble hôtelier sur les lots n°s 2, 3 et 4 du lotissement «Les Hauts de Beaufils» ; qu'aux termes de la notice explicative du projet de ce lotissement, il est constitué de «49 terrains à bâtir destinés à recevoir des habitations individuelles à usage d'habitation principale ou secondaire avec possibilité de location en meublé» ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement de ce lotissement «sur chacun des lots pourront être construits des bâtiments à usage d'habitation individuelle» ; qu'ainsi seuls des bâtiments à usage d'habitation individuelle peuvent être construits dans le lotissement «Les Hauts de Beaufils» ; que dès lors le permis attaqué relatif à un projet hôtelier ne répondait pas à cette destination ; qu'il était par suite illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI BONAPARTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé le permis de construire litigieux »
CAA. Bordeaux, 6 mars 2008, Sté ADJOUMA, req. n°05BX01609 :
« Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par la requérante elle-même, que depuis le 20 novembre 1994, date à laquelle elle a cédé à la SOCIETE ADJOUMA le droit réel immobilier qu'elle détenait sur le terrain en cause en vertu du bail emphytéotique passé avec l'Etat, Mme X n'était plus titulaire d'aucun droit réel immobilier qui lui aurait donné qualité pour solliciter un permis de construire sur ce terrain ; qu'elle n'a par ailleurs produit au soutien de sa demande de permis aucune autorisation de la SOCIETE ADJOUMA l'habilitant à solliciter un permis de construire sur ce terrain ; que dès lors, le maire de la commune de Matoury était tenu, par application du troisième alinéa de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme précité, de lui refuser la délivrance du permis qu'elle demandait en son nom propre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la SOCIETE ADJOUMA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est daté et signé, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2000 par laquelle le maire de la commune de Matoury a refusé de lui délivrer un permis de construire ».
CAA. Bordeaux, 11 février 2008, Cne de Blanquefort, req. n°05BX00419 :
« Considérant que la société PH Promotion Transaction a déposé une demande d'autorisation de lotir le 8 février 2001, complétée le 6 juin suivant, pour un projet de lotissement comprenant 17 lots, situé sur la COMMUNE DE BLANQUEFORT ; que, le 22 juin 2001, le maire de cette commune a accusé réception de la demande et a informé la société qu'une décision expresse devrait lui être notifiée au plus tard le 6 septembre 2001, faute de quoi il pourrait être fait usage de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 315-21 du code de l'urbanisme ; qu'à défaut de décision expresse prise dans le délai ainsi indiqué, la société PH Promotion Transaction a, par une lettre recommandée du 26 octobre 2001 avec demande d'avis de réception, qui a été reçue le 30 octobre suivant, saisi le maire d'une demande tendant à ce que fût prise, dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 315-21 précité, une décision expresse ; que, le 15 mars 2002, le maire a pris un arrêté refusant à la société PH Promotion Transaction la délivrance de l'autorisation de lotir sollicitée ; que la COMMUNE DE BLANQUEFORT fait appel du jugement du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par ladite société d'un recours en annulation de cet arrêté, a annulé ce dernier au motif qu'il n'avait pu légalement retirer l'autorisation tacite de lotir dont était titulaire la société depuis le 30 novembre 2001 ; Considérant que si la société PH Promotion Transaction n'a pas adressé copie au préfet de la lettre recommandée qu'elle a adressée au maire de Blanquefort le 26 octobre 2001, le défaut de respect de cette formalité, s'il avait une incidence sur le caractère exécutoire d'une éventuelle autorisation tacite de lotir, n'a pas fait obstacle, dès lors que le maire avait été valablement saisi d'une demande présentée en application de l'article R. 315-21, au déclenchement du délai d'un mois à l'expiration duquel, à défaut de notification d'une décision expresse, la société se trouvait titulaire d'une autorisation tacite de lotir ; que, par suite, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, une autorisation tacite de lotir est née le 30 novembre 2001 au profit de la société PH Promotion Transaction ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 23 de la loi n° 3000-321 du 12 avril 2000, cette autorisation ne pouvait être retirée par la commune que dans le délai de deux mois ; que, dès lors, l'arrêté du maire de Blanquefort du 15 mars 2002 n'a pu légalement procéder au retrait de cette autorisation et refuser l'autorisation sollicitée ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, constaté que la société PH Promotion Transaction était titulaire d'une autorisation tacite de lotir et a annulé l'arrêté du 15 mars 2002 opposant un refus à la demande d'autorisation de lotir présentée par cette société ; qu'il en résulte qu'en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la COMMUNE DE BLANQUEFORT était tenue, à peine d'irrecevabilité de sa requête dirigée contre ce jugement, de notifier celle-ci à la société PH Promotion Transaction ; qu'il est constant qu'elle n'a pas procédé à une telle notification ; que, n'ayant même pas procédé à une tentative de notification, elle ne saurait utilement faire valoir, pour s'exonérer de son obligation, que l'adresse de la société mentionnée dans le jugement rendu par le tribunal administratif ne correspond pas à celle mentionnée au registre du commerce et des sociétés »
CAA. Nancy, 28 janvier 2008, Cne de Beuvilliers, req. n°06NC01550 :
« Considérant que si le terrain d'assiette du projet, situé en zone UB du plan d'occupation des sols, se trouve à proximité de la route départementale 906, classée à grande circulation, sa desserte s'effectue par le chemin du Chartron dont l'élargissement à huit mètres est prévu au plan d'occupation des sols et se trouve matérialisé dans le plan de masse joint à la demande de permis de construire, permettant ainsi, contrairement aux motifs de la décision du 24 mai 2004, le croisement des véhicules ; qu'il ressort, au surplus, des pièces du dossier que la circulation induite par la fréquentation de la salle de culte présentera un caractère limité, les fidèles se réunissant deux fois par semaine sur une durée n'excédant pas deux heures ; qu'ainsi, en refusant le permis de construire demandé, le maire de la COMMUNE DE BEUVILLERS s'est livré en tout état de cause à une appréciation erronée des règles prescrites par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme relatives aux conditions de desserte des immeubles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEUVILLERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision susmentionnée du 24 mai 2004 »
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF :
CE. 7 août 2008, Cne de Libourne, req. n°288.966
Lorsque le recours a été notifié à l’époux de la bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme contestée, celui-ci est recevable au regard de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme dès lorsque les époux ne sont pas séparés de corps.
CAA. Lyon, 7 août 2008, Association urbanisme et environnement de la confluence Drome-Rhone, req. n°06LY01602
Une association ayant pour objet statutaire la « la défense et la protection de l'urbanisme, de l'environnement (...) de l'écologie, du paysage, de la qualité de la vie » ainsi que « la défense des contribuables et des consommateurs (...) » sur le territoire de cinq communes n’a pas eu égard, à la généralité de cet objet, intérêt à agir à l’encontre d’une délibération approuvant la modification du POS communal.
CAA. Marseille, 7 juillet 2008, Association de défense du Quartier de Redon, req. n°07MA01809
Suivant le principe selon lequel celui qui est intervenu devant le tribunal administratif en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention qu'à la condition qu'il aurait eu qualité, s'il était resté étranger à l'instance, pour faire tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours, d’une part, et bien que l'association requérante s'est donné pour objet social de s'opposer au projet objet du refus de permis de construire annulé en première instance, l’association appelante n'aurait pas eu intérêt à faire tierce opposition à ce jugement dès lors que ce refus a été requalifié en retrait : elle n’est donc pas recevable à faire appel du jugement ayant annulé cette décision.
CE. 11 juillet 2008, Association des Amis des Paysages Bourganiauds, req. n°313.386
L'article L. 600-1-1 introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 14 de la loi du 13 juillet 2006 – lequel dispose que « une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » – est applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, alors même que ces dernières statuent sur des demandes présentées antérieurement à cette entrée en vigueur. Par suite, une association n’ayant pas déposé ses statuts à la date de la demande de permis de construire est irrecevable à attaquer l’autorisation délivrée dès lors que cette dernière est postérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article et ce, quand bien même la demande est antérieure à cette date.
CAA. Marseille, 7 juillet 2008, M. Eddie X., req. n°08MA01037
Dès lors qu’un arrêt du Conseil d’Etat a enjoint au préfet de prescrire la modification du plan de prévention des risques d'inondation en tant qu'il classe en «zone rouge» une parcelle déterminée dans un délai de six mois à compter de sa notification, le préfet ne saurait se prévaloir de ce qu’il a prescrit la révision du plan de prévention des risques d'inondation pour l'ensemble de la commune en cause alors qu’il n’établit pas qu'il était impossible d'effectuer dans le délai de six mois prescrit par l'arrêt cité ci-dessus, la modification du plan de prévention pour la seule parcelle objet de la mesure d'injonction.
CAA. Marseille, 26 juin 2008, M. et Mme X., req. n°08MA00031
Dès lors que les requérants n’ont pas justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite par l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire par le Tribunal, la production de cette justification en appel est inopérante.
CE. 16 mai 2008, Mme A, req. n°305.717
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 1er février 2007, le préfet de la Corse-du-Sud a délivré à M. A un permis de construire une villa sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari ; qu'à la demande de l'association groupe d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement (GARDE), le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, par une ordonnance du 2 mai 2007, suspendu l'exécution de cet arrêté en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ; Sur le pourvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme issu de la loi du 13 juillet 2006, applicable au présent litige : Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; Considérant qu'en relevant, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée devant lui, que l'association requérante justifiait, eu égard à son objet de défense de l'environnement et du cadre de vie et de sauvegarde de la nature dans la région de Corse, d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour contester l'autorisation de construire accordée à M. A, alors même qu'elle n'aurait pas été agréée et que ses statuts n'auraient pas été déposés en préfecture, le juge des référés a méconnu l'exigence énoncée par l'article L. 600-1-1 précité et par suite commis une erreur de droit ; que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; Sur la demande de référé : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de permis de construire présentée par M. A a été affichée en mairie le 31 octobre 2006 ; que, pour justifier la recevabilité de sa demande, l'association requérante a adressé au premier juge copie de ses statuts datés du 27 février 2006, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils ont été déposés en préfecture avant la date d'affichage de la demande de permis susmentionnée ; que si l'association a fourni divers documents qui tendent à démontrer qu'elle existait avant cette date sous un nom similaire, qu'elle disposait de statuts qui auraient été déposés en préfecture le 13 mai 1973 et qu'elle a été en outre agréée par l'administration par décision du 12 février 1980, elle ne fournit ni ces précédents statuts ni aucun autre élément de nature à établir qu'il s'agit bien de la même personne morale ; que les statuts du 27 février 2006 ne font au demeurant aucune mention de la modification ou de l'abrogation de précédents statuts ; que, par suite, l'association requérante, qui n'a pas produit devant le Conseil d'Etat bien que la requête de M. A lui ait été communiquée, ne peut être regardée comme justifiant de l'accomplissement de la formalité exigée par l'article L. 60011 ; qu'il suit de là que le recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté contre le permis de construire apparaît entaché d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance »
CE. 14 mai 2008, M. et Mme B., req. n° 289.745
La circonstance qu’une décision expresse de non-opposition à une déclaration préalable ne comporte ni le nom, ni le prénom de son auteur ne constitue pas une irrégularité substantielle au regard de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 lorsque cette décision n’est assortie d’aucune prescription puisque rien n’imposait à son auteur de l’édicter au regard du caractère déclaratif de la procédure d’autorisation en cause.
CAA. Nancy, 30 avril 2008, Cne de Rodemack, req. n°07NC00412
Un permis de construire ne comportant ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son signataire – en l’occurrence, le délégué à l’urbanisme – ne saurait être régularisé par un modificatif précisant simplement avoir été signé par « le maire ».
CE. 18 avril 2008, SARL Kaibacker, req n°304.957 :
« Considérant que la SARL KAIBACKER s'est vue accorder un permis de construire une porcherie et deux silos sur le territoire de la commune de Munchhouse, par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 juin 2001; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé, par une décision du 17 mai 2002, l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg avait, à la demande du maire de Munchhouse, prononcé la suspension de cet arrêté ; que la légalité au fond de ce permis de construire a été reconnue par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 23 mars 2006, devenu définitif ; que, postérieurement à l'engagement des travaux entrepris par la société requérante, le maire de Munchhouse et le directeur départemental de l'équipement, par deux décisions respectivement en date du 30 novembre et du 4 décembre 2006, lui ont opposé la caducité du permis de construire délivré le 13 juin 2001 ; que, par ordonnance du 9 janvier 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de suspension formulée par la SARL KAIBACKER à l'encontre de ces décisions ; que, par arrêté du 15 mars 2007, le maire de Munchhouse a ordonné l'interruption des travaux engagés ; que par une ordonnance du 30 mars 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a également rejeté la demande de la société requérante tendant à la suspension de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative au motif du défaut d'urgence ; que cette ordonnance, attaquée sous le n° 304957, a fait l'objet d'une erreur matérielle corrigée par l'ordonnance rectificative du 28 avril 2007, attaquée sous le n° 305421 ; Considérant que ces deux pourvois sont relatifs à la demande de suspension d'une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois : Considérant que la circonstance que le juge des référés ait, par une précédente ordonnance du 9 janvier 2007, dénié l'urgence qu'il y avait à suspendre le constat de caducité du permis, ne le dispensait pas, à l'occasion de la demande de suspension de l'arrêt interruptif de travaux, de rechercher si cette interruption portait à la société requérante un préjudice grave et immédiat, alors que d'une part, la légalité du constat de caducité, contestée par la SARL KAIBACKER, n'avait pas été jugée au fond, et que d'autre part, cette société devait effectuer les travaux en cause dans le délai fixé par l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ; que dès lors, la SARL KAIBACKER est fondée à soutenir que le juge des référés a entaché les ordonnances attaquées d'une erreur de droit, et à en demander pour ce motif l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé en application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, que la SARL KAIBACKER a engagé les travaux correspondant au permis de construire qui lui a été délivré le 13 juin 2001, dès après que sa légalité a été définitivement jugée par un arrêt du 23 mars 2006 de la cour administrative d'appel de Nancy, devenu définitif, et à une période où cette autorisation était encore valide ; que, dans les circonstances de l'espèce, en faisant valoir que l'arrêté litigieux, qui lui-même faisait suite à plusieurs manoeuvres d'obstruction de la part de la commune, lui occasionnait un préjudice économique résultant du nouveau retard pris par le chantier, la société requérante justifie de l'urgence à obtenir la suspension de l'arrêté attaqué ; Considérant en second lieu, d'une part, qu'en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il appartient au maire, avant d'ordonner une interruption de travaux sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, de mettre les intéressés à même de présenter préalablement leurs observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire a adressé le 14 mars 2007 un courrier invitant le représentant de la SARL KAIBACKER à présenter ses observations, soit la veille de la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'adoption de cet arrêté a méconnu le principe du contradictoire est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ».
CAA. Marseille, 27 mars 2008, M. Christian X., req. n°06MA00130
La décision par laquelle un maire modifie la surface et les limites des lots d’un lotissement constitue une décision relative à l’utilisation des sols au sens de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme.
CAA. Marseille, 27 mars 2008, Sté Camping de Loye, req. n°06MA00727
La méconnaissance de l’article R.332-25 du Code de l’urbanisme relatif à la publicité des délibérations instituant un PAE entache celles-ci d’une illégalité externe dont il peut être excipée dans le cadre d’un recours en annulation dirigé à l’encontre de la disposition du permis de construire assujettissant son titulaire à la participation prévue par ledit PAE.
CAA. Lyon, 25 mars 2008, M et Mme X., req. n°07LY02820
La circonstance que le panneau d’affichage de l’autorisation contestée n’ait pas fait état de la procédure de notification prévue par l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme n’a pas d’incidence sur l’irrecevabilité du recours dès lors que l’obligation de faire état de cette procédure sur le panneau procède de l’article R.424-15 du Code de l’urbanisme, lequel n’était pas entrée en vigueur à la date d’introduction du recours. A contrario, la méconnaissance de ces dispositions de cet article s'oposerait à considérer la requête irrecevable au titre de l'article R.600-1. (à voir)
CAA. Marseille, 7 mars 2008, Préfet de Corse du Sud, req. n°07MA05060
Un recours dirigé contre un certificat de permis tacite est recevable en ce qu’il doit être réputé dirigé contre le permis tacite lui-même.
CE. 3 mars 2008, Mme Sylvia, req. n°278.118
La notification d'un recours par voie électronique ne satisfait pas à la condition posée par l'article R.600-1 du Code de l'urbanisme.
CE. 29 janvier 2008, EDF, req. n°307.870
« Considérant, en deuxième lieu, que saisie d'une demande de suspension de l'acte accordant un permis de construire, le juge des référés doit, eu égard au caractère difficilement réversible des travaux ainsi autorisés, regarder la condition d'urgence comme étant, en principe, remplie lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières ; que le moyen tiré de ce qu'une obligation légale de remise en état des lieux, au terme de l'exploitation des installations en cause, induirait nécessairement la réversibilité des travaux à cette échéance est sans incidence sur l'appréciation du caractère difficilement réversible de ces derniers à laquelle doit procéder le juge des référés pour regarder la condition d'urgence comme étant remplie ; que pour justifier, en l'espèce, l'urgence de la suspension sollicitée, après avoir relevé que la construction de sept aérogénérateurs était de nature à créer, du fait de leur caractère difficilement réversible, s'agissant notamment des massifs de fondation qui en constituent le socle, et alors même que ces installations sont en principe démontables et soumises à l'obligation de démantèlement en fin d'exploitation prévue par l'article L. 553-3 du code de l'environnement, le juge des référés s'est, sans commettre d'erreur de droit, livré à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas entachée de dénaturation ; qu'il n'a pas davantage dénaturé les faits, dans l'appréciation de cette condition, en jugeant que ces installations étaient de nature à porter une atteinte grave à la situation de l'association requérante au regard de l'objet social qu'elle défend, nonobstant les circonstances qu'elles présentaient à la fois un intérêt public national et un intérêt public local pour la commune de Joncels et qu'un effort particulier d'insertion des aérogénérateurs dans le site avait été effectué »
CONFORMITE DES TRAVAUX :
CAA. Lyon, 17 janvier 2008, Monsieur Georges X., 06LY01804
« Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme : “ A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat ” ; qu'aux termes de l'article R. 460-3 dudit code : “ Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire (…) ” et qu'aux termes de l'article R. 460-4 du même code : “ si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré (…) ” ; Considérant que par un arrêté du 22 septembre 2000, le maire de la commune de Talant a délivré à la SA Ghitti un permis de construire une maison individuelle ; que les travaux ont été déclarés achevés le 17 décembre 2002 ; que par une décision en date du 24 janvier 2003, le maire a refusé de délivrer un certificat de conformité, estimant que la SA Ghitti devait régulariser la situation en déposant un permis de construire modificatif qui limiterait à 0,80 mètre la hauteur des exhaussements de sols ; qu'un permis modificatif a été accordé à la SA Ghitti le 30 mars 2004 et que le 8 avril 2004, le certificat de conformité a été délivré ; que le bâtiment a été vendu le 23 mai 2003 à M. et Mme Y qui l'ont revendu le 14 mai 2004 à M. X ; Considérant que la circonstance que la SA Ghitti n'était plus propriétaire du terrain d'assiette de la construction depuis le 23 mai 2003 lors du dépôt du permis modificatif est sans incidence sur la régularité du certificat de conformité délivré pour la construction litigieuse »
CE. 11 janvier 2008, Giorgi, req. n°301.373
« Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A aient, postérieurement à l'achèvement de la construction autorisée par le permis de construire délivré le 12 octobre 1996 par le maire de la commune de Serra di Ferro, et devenu définitif, exécuté des travaux ayant eu pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ou de créer des niveaux supplémentaires ; qu'à supposer que les intéressés aient modifié la destination de la construction autorisée par le permis de construire, sans y exécuter de travaux, ce changement n'était pas soumis à obligation de permis de construire, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 4211 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en se fondant, pour juger que le Syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 1116 du code de l'urbanisme, d'opposer un refus à la demande de raccordement au réseau électrique formée par les époux A sur la circonstance que ceux-ci devaient être regardés comme ayant modifié sans autorisation la destination de la construction dont le raccordement était demandé, et que la maison d'habitation n'aurait pas été autorisée par ce permis de construire, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 7 décembre 2006 »
DIVERS :
Cass. civ., 10 septembre 2008, Cne de Marseille, pourvoi n°07-17086
Une commune ayant préempté un terrain dont il était de notorité publique qu'il était polué ne peut ensuite utilement se retourner contre le vendeur dans le cadre d'une action en restitution d'une partie du prix fondée sur la garantie des vices cachés et le dol.
CE. 21 mai 2008, Sté du Domaine de Saint-Marcelle, req. n°290.241
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, selon lesquelles « lorsqu'un plan a été rendu public avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément », ont eu pour objet d'éviter que ce classement ne rende applicable de plein droit aux carrières l'ensemble des prescriptions du plan d'occupation des sols relatives aux installations classées, sans que l'autorité compétente ait été en mesure de se prononcer sur une telle extension. En revanche, dans l'hypothèse où le plan interdit dans une zone toute occupation ou utilisation des sols, à l'exception de celles qu'il prévoit expressément et dans le champ desquelles ne rentrent pas les carrières, les dispositions en cause de l'article L. 123-5 ne sauraient être interprétées comme permettant l'ouverture de carrières dans cette zone du seul fait que le plan ne s'y oppose pas expressément. Par suite, un règlement de zone ND qui définit cette zone comme « une zone naturelle à vocation agricole, forestière ou touristique » où, pour des raisons de protection des sites et des paysages, « sont interdits toute construction nouvelle et tout aménagement à quelque usage que ce soit », à l'exception des « travaux destinés à faciliter la mise en valeur foncière, agricole, forestière ou touristique », est opposable à une demande d'autorisation d'exploiter une carrière.
CAA. Marseille, 21 février 2008, SARL Union Piscines France, req. n°06MA01530
Une coque de piscine, produite et exposée par la société requérante, placée en position verticale et scellée au sol, afin d'attirer l'attention du public qui circule sur la route présente une forme constitutive d'une publicité au sens des dispositions de l'article L.581-3 du code de l'environnement dont la surface unitaire maximale doit respecter les dispositions de l'article 6 du décret du 24 février 1982 et à laquelle les dispositions de l’article R.422-1 du Code de l’urbanisme sont inopposables.
Cass. civ., 13 février 2008 pourvoi n°07-11.462
« Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient réservé au chapitre "recours des tiers" l'éventualité d'un contrôle de légalité et que la lettre du délégué à l'urbanisme et à l'aménagement de la commune d'Issy-les-Moulineaux mentionnait que le sous-préfet était intervenu "dans le cadre du contrôle de la légalité" et retenu que l'obligation pour la société Priène Investissement de déposer une demande de permis modificatif avait pour effet de priver le permis qui lui avait été accordé le 18 septembre 2002 de tout caractère définitif, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire définitif à la date de réalisation de la vente n'était pas satisfaite ».
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au Barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés