Bien qu’à aménager dans un même immeuble existant, deux logements séparés qui n'ont pas fait l'objet d'une conception d'ensemble, qui ont une vocation fonctionnelle autonome et qui appartiennent à des propriétaires différents ne forment pas un ensemble immobilier unique. Par suite, les travaux s’y rapportant n’ont pas à relever d’un seul et même permis de construire.
CAA. Bordeaux, 1er avril 2010, Nadia X., req. n°09BX00275
Dans cette affaire, deux époux avaient conjointement obtenu, le 12 mai 2005, un permis de construire en vue de la création d’un logement au sein d’un lot d’un bâtiment existant soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Et quelques semaines plus tard, le 1er juillet 2005, ce même immeuble devait faire l’objet d’un second permis de construire délivré à une autre personne en vue de l’extension de l’habitation correspondant à un autre lot de cette copropriété.
Le permis de construire délivré le 12 mai 2005 devait toutefois faire l’objet d’un recours en annulation. Et à son appui, les requérants devaient ainsi soutenir que les travaux objets de cette autorisation et ceux autorisés par celle délivrée le 1er juillet 2005 auraient, compte tenu de leur indivisibilité prétendue, faire l’objet d’un seul et même permis de construire.
Comme on le sait, en effet, le Conseil d’Etat a dans son arrêt « Ville de Grenoble » (CE. 17 juillet 2009, Ville de Grenoble & Communauté d’Agglomération Grenoble Alpes Métropole, req. n°301.615) confirmé la règle de principe selon laquelle « une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire » ; le principal apport de cet arrêt, dès lors que cette règle n’était pas totalement nouvelle (P.E. DURAND, « Ensemble immobilier unique & pluralité de permis de construire », RDI, n°11/2009), tenant à la définition ainsi posée de la notion d’ensemble immobilier unique et, surtout, à l’exception que cet arrêt a introduit à cette règle.
Mais ce moyen devait donc être rejeté par la Cour administrative d’appel de Bordeaux au motif « que les deux projets concernent deux logements séparés qui n'ont pas fait l'objet d'une conception d'ensemble, qui ont une vocation fonctionnelle autonome et qui appartiennent à des propriétaires différents ».
Certes la Cour n’a donc pas suivi l’analyse des requérants mais il n’en demeure pas moins qu’il nous semble reconnaître sans grande difficulté dans le « considérant » précité les critères dégagés par l’arrêt « Ville de Grenoble » : c’est donc bien que la règle de principe précisé par ce dernier peut trouver à s’appliquer aux autorisations se rapportant à des travaux projetés sur une construction existante. D’ailleurs, compte tenu de la finalité et des considérations dont procède l’arrêt « Ville de Grenoble », on voit mal pourquoi il en aurait été différemment pour les travaux sur existants.
Il reste que l’on aurait pu penser qu’à partir du moment où de nouveaux locaux étaient projetés au sein d’un même immeuble, ce dernier créait nécessairement entre eux un lien physique, voire même un lien fonctionnel. Tel n’est donc pas le cas.
Concernant le « lien fonctionnel », la Cour a donc considéré que les deux logements en cause avaient « une vocation fonctionnelle autonome » ; ce qui en soi n’est guère surprenant dès lors que chacun des locaux objets des permis de construire s’y rapportant constituait en lui-même et à lui seul un logement. Ce n’était donc pas la réunion de ces locaux qui formait un seul logement. En ce sens, on sait d’ailleurs qu’il a pu être jugé que des maisons de ville bien qu’accolées et sises sur un même terrain autours d’une cour commune constituent néanmoins des bâtiments distincts dès lors qu’elles « sont destinées à être occupées séparément » (CE. 7 mai 2003, Boisdeffre, req. n°251.596).
Mais s’agissant du lien fonctionnel, il n’est pas inutile de rappeler que dans l’arrêt « Ville de Grenoble » le Conseil d’Etat a jugé que le parc de stationnement n’avait pas nécessairement à relever du même permis de construire que le Stade dès lors que l’un et l’autre avait « une vocation fonctionnelle autonome ». Or, en l’espèce, chacun des deux permis de construire en cause avait le même objet : l’aménagement d’un logement. Il s’ensuit donc que le seul fait que les locaux ou ouvrages considérés présentent la même destination ne s’oppose pas à ce qu’on leur reconnaisse une fonction propre : la fonction est donc sans rapport avec la destination de l’ouvrage considéré.
Mais surtout, le fait qu’ils se rattachent à un même immeuble et a priori disposent donc d’aménagements communs nécessaires à leur utilisation – telle une entrée – n’apparait pas constitutif d’un lien fonctionnel au sens de l’arrêt « Ville de Grenoble ». Il semble donc que le lien fonctionnel au sens de cet arrêt doive s’entendre d’un lien unissant directement les composantes du projet et dont il résulte que l’une ne peut fonctionner sans l’autre (en ce sens : CE. 26 mars 1997, ADLA, req. n° 172.183). Et a contrario, dès lors que l’une n’est pas en elle-même nécessaire au fonctionnent de l’autre, chacune dispose alors d’une autonomie fonctionnelle.
Quant à la circonstance que la Cour administrative d’appel de Bordeaux ait précisé que les logements « appartiennent à des propriétaires différents », celle-ci ne nous semble pas déterminante ; cette précision ne nous semblant avoir été apportée que pour appuyer l’analyse selon laquelle les deux « locaux » considérés, avaient chacun une fonction propre dès lors qu’ils n’étaient pas destinés au logement de mêmes personnes. En effet, compte tenu du caractère réel et non pas personnel de la législation sur le permis de construire, le critère du nombre de maitres d’ouvrage ne saurait a priori suffire. Force est en effet d’admettre que le seul fait que les locaux ou des bâtiments soient réalisés par plusieurs maîtres d’ouvrage ne signifie pas nécessairement que ces locaux disposent d’une autonomie fonctionnelle et, a contrario, que le seul fait qu’ils soient réalisés par un seul et même maître d’ouvrage n’implique pas en soi qu’ils n’aient pas une fonction propre. D’ailleurs, il a d’ores et déjà été jugé que deux bâtiments à destination d’habitation autorisés par deux permis de construire délivrés à quelques jours d’écart, sur un même terrain et au bénéfice d’une même personne ne constituaient pas un « ensemble immobilier unique » au sens de l’arrêt « Ville de Grenoble » (CAA. Nantes, 16 février 2010, Pascal X., req. n°09NT00832).
Mais s’agissant d’autorisations de travaux délivrées concomitamment sur un immeuble existant, c’est bien entendu la mise en œuvre du critère du « lien physique » qui s’avère la plus intéressante puisque toute la question est de s’avoir si le seul fait que les locaux à aménager soient projetés au sein d’un même immeuble suffit à considérer qu’ils sont unis par un « lien physique » au sens de l’arrêt « Ville de Grenoble ».
En première analyse, la solution était moins évidente que celle concernant le « lien fonctionnel ». Pour application de la jurisprudence « Thalamy », il a en effet pu être jugé qu’un permis de construire autorisant une nouvelle extension d’une maison d’habitation légalement édifiée mais ayant irrégulièrement fait l’objet d’une première extension devait nécessairement régulariser cette dernière, alors même que la seconde ne prenait pas appui sur la première et n’étaient donc pas directement liée physiquement à celle-ci, dès lors que l’une et l’autre formaient un « tout indissociable de la maison d'habitation » (CAA. Nantes, 28 décembre 2006, M. & Mme X., req. n°06NT00016).
Or, s’il est vrai que les deux extensions avaient une même fonction puisque se rapportant à la même habitation, il reste que la jurisprudence « Thalamy » – dont la mise en œuvre avait d’ailleurs déjà abouti à considérer que les composantes d’un même projet devaient relever d’une autorisation unique (CE. 17 décembre 2003, Bontemps, req. n°242.282) – concerne uniquement les travaux prenant appui sur une construction dépourvue d’existence légale. A contrario, elle ne trouve donc pas à s’appliquer dès lors que l’ouvrage à construire est dissocié de cette construction (CE. 25 avril 2001, Ahlborn, req. n° 207.095), c’est-à-dire lorsqu’ils sont « séparés physiquement » (CAA. Marseille, 15 mai 2008, Cne de Fuveau, req. n°06MA00807) : c’est donc bien que dès lors qu’elles se rapportent à la même construction deux « extensions » sont liées physiquement même si elles ne prennent pas appui l’une sur l’autre.
En outre, la règle dégagée par l’arrêt « Ville de Grenoble » procède selon nous de considérations qui ne sont pas si éloignées de celles selon laquelle, en principe, toute modification d’un projet relevant d’un permis de construire en cours d’exécution implique, à tout le moins, l’obtention d’un « modificatif », y compris si prises isolément ces modifications relèvent du champ d’application de la déclaration préalable (CAA. Paris, 13 décembre 1994, Ville de Paris, req. n°92PA01420; voir ici). En effet, dès lors qu’un « modificatif » s’intègre au « primitif » pour former avec lui une autorisation unique (CAA. Paris, 30 octobre 2008, M. Gilbert Y., req. n°05PA04511 ; TA. Versailles, 22 février 1994, SCI Les Ormes, req. n°93-05140), cette règle implique donc de faire relever le projet d’une seule et même autorisation. Or, il en va ainsi dès lors que le nouvel ouvrage envisagé est structurellement lié ou attenant à celui objet du permis initial (CE. 9 janvier 2009, Ville de Toulouse, req. n°307.265).
Aussi, dès lors qu’en l’espèce, ils étaient projetés concomitamment au sein d’un même immeuble – et, donc, d’une même structure – on pouvait donc penser que ces deux logements devaient être regardés comme liés physiquement.
Mais telle n’a donc pas été l’analyse de la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans la mesure où « les deux projets concernent deux logements séparés qui n'ont pas fait l'objet d'une conception d’ensemble ».
Rappelons-le, en effet, la règle de principe dégagée par l’arrêt « Ville de Grenoble » s’applique dans le cas d’une « construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique ». Or, précisément, dans cette affaire, le Conseil d’Etat a confirmé l’analyse de la Cour administrative d’appel de Lyon, en ce qu’elle avait estimé au regard de considérations d’ordre physique qu’il s’agissait d’un ensemble immobilier unique, mais ce en relevant que le stade et le parc de stationnement sous-jacent avaient « fait l'objet d'une conception architecturale globale ».
De ce fait, il nous semble donc qu’un lien physique au sens de l’arrêt « Ville de Grenoble » s’entende d’un lien unissant directement deux éléments de construction, impliquant que l’un ne puisse avoir été conçu indépendamment de l’autre et, donc, qu’ils ont fait l’objet d’une conception d’ensemble.
Quoi qu’il en soit, il en résulte donc que le seul fait que des travaux soient projetés concomitamment sur un même immeuble existant n’induit pas qu’ils aient un lien physique et n’impliquent donc pas nécessairement qu’ils relèvent d’une même autorisation d’urbanisme. Et c’est heureux puisqu’au regard des considérations dont procède l’arrêt « Ville de Grenoble », on voit mal l’intérêt dont la préservation exigerait qu’il en soit systématiquement ainsi.
Mais pour conclure, on précisera que la solution retenue en l’espèce ne nous parait cependant pas directement résulter de l’apport de cet arrêt. On relèvera, en effet, qu’il a pu être jugé que deux auvents projetés concomitamment par une même personne sur un même bâtiment existant mais destinés à couvrir des parties différentes de ce dernier étaient, compte tenu de leur indépendance tant physique que fonctionnelle, dissociables. Partant, chacun pouvait faire l’objet de deux déclarations préalables distinctes dès lors que leur surface respective était inférieure à 20 mètres carrés et, en d‘autres termes, n’avaient donc pas, pour application de l’ancien article R.422-2 m) du Code de l’urbanisme, a relevé d’un permis de construire unique alors même que leur surface cumulée excédait le seuil de 20 mètres carrés fixé par cet article (TA. Nice, 24 mai 2006, Mme Baracco, req. n°02-05432).
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés



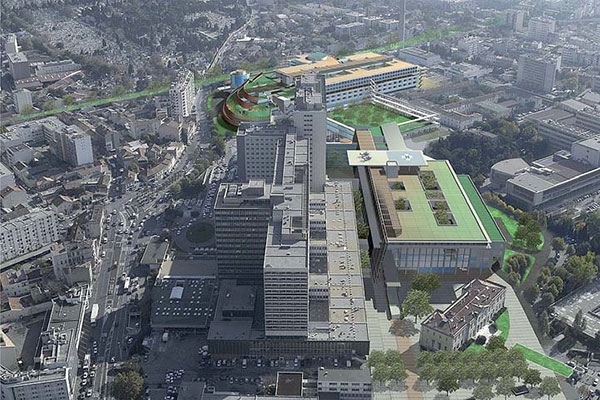

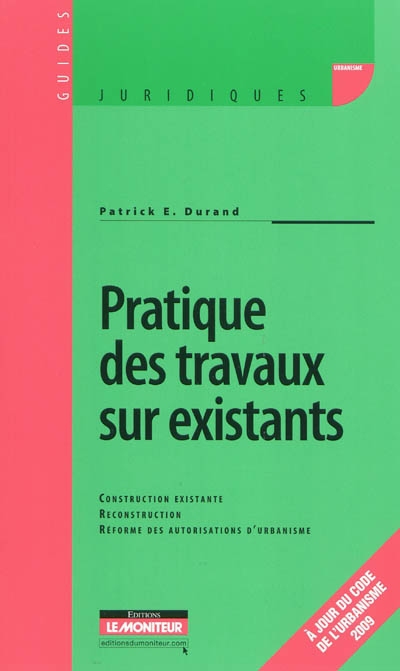 Mais comme le sait, il résulte de la jurisprudence « Sekler » la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
Mais comme le sait, il résulte de la jurisprudence « Sekler » la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.