Veille administrative : 3 réponses ministérielles
TEXTE DE LA QUESTION (Question publiée au JO le : 11/08/2009 page : 7760) : "M. Michel Issindou attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les conséquences du projet de suppression de l'avis conforme des architectes des bâtiments de France. En effet, actuellement, le code du patrimoine prévoit que, dans les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP), les permis de construire et de démolir ne peuvent être délivrés qu'après l'avis conforme d'un architecte des bâtiments de France. Cette obligation d'avis conforme avait conduit le législateur à supprimer le périmètre de protection des monuments historiques dans les ZPPAUP puisque l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France était impératif avant la délivrance du permis de construire ou de démolir. Le projet de suppression de l'avis des architectes des bâtiments de France aurait pour conséquence, selon de nombreuses associations, de mettre en péril des éléments essentiels de notre patrimoine en raison de l'abaissement du niveau de protection. Il lui demande donc de bien vouloir préciser le contenu de ce projet ainsi que les pistes envisagées pour garantir le niveau de protection de l'ensemble des sites concernés par ces dispositions"
TEXTE DE LA REPONSE (Réponse publiée au JO le : 27/10/2009 page : 10186) : "L'article 9 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement - dite « Grenelle 1 » - prévoit désormais que l'avis des architectes des Bâtiments de France (ABF), préalable à la délivrance de l'autorisation pour exécuter des travaux dans le périmètre des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), est un avis simple. Par voie de conséquence, la procédure de recours administratif contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France auprès du préfet de région a été supprimée. Ces nouvelles dispositions ne mettent en cause ni l'économie générale du dispositif des ZPPAUP ni sa pérennité. D'abord, l'autorité compétente pour la délivrance des autorisations d'urbanisme demeure bien entendu liée par les dispositions réglementaires de la ZPPAUP, sauf à prendre le risque d'une annulation de sa décision par le juge administratif, saisi par le représentant de l'État ou par des tiers. Ensuite, le nombre infime de recours enregistrés chaque année, jusqu'à ce jour, contre les avis des architectes des Bâtiments de France en ZPPAUP, permet de penser que l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme continuera, dans l'immense majorité des cas, de suivre ces avis. Les collectivités territoriales qui ont choisi la ZPPAUP comme instrument pour leur politique de protection et de mise en valeur patrimoniale, dans le cadre d'un partenariat étroit avec l'État, comptent en effet, plus que jamais, sur l'expertise et l'appui des architectes des Bâtiments de France, avec lesquels elles ont tissé des relations de confiance. Enfin, le ministre chargé de la culture conserve la faculté d'évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France est saisi. Le législateur a donc estimé que l'État devait conserver, sous cette forme, une procédure rapide et efficace pour garantir l'intérêt général de la protection et de la mise en valeur du patrimoine. Cette décision manifeste clairement, s'il en était besoin, l'intérêt accordé par le Parlement et le Gouvernement aux ZPPAUP, dispositif éprouvé qui concerne aujourd'hui plus de 600 communes. C'est la raison pour laquelle, au-delà de la question de la forme de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, la modernisation de la conception et de la gestion des ZPPAUP constitue un chantier capital. D'ores et déjà, la définition progressive d'une approche régionale de la politique des ZPPAUP, favorisée par la fusion des directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et des services départementaux de l'architecture et du patrimoine (SDAP), permettra de conforter la lisibilité et, partant, la légitimité de l'action des architectes des Bâtiments de France dans ces zones de protection. En outre, il est nécessaire d'examiner tous les moyens d'améliorer le régime de la ZPPAUP, tant du point de vue de son contenu que de ses procédures d'instruction et de ses modalités de gestion, et de s'interroger, à cette occasion, sur la répartition des rôles entre l'État et les collectivités territoriales dans sa mise en oeuvre. C'est pourquoi vient d'être confié à M. Thierry Tuot, conseiller d'État, le soin d'être rapporteur d'une mission de concertation et de propositions, présidée par le ministre de la culture et de la communication, associant des élus nationaux et territoriaux aux professionnels de l'architecture et de la protection du patrimoine. Les conclusions de cette mission seront présentées dans des délais compatibles avec le calendrier des travaux parlementaires, l'objectif étant d'intégrer les pistes de travail retenues dans la loi dite « Grenelle II », dont le projet sera examiné par le Parlement à partir du mois de septembre 2009. "
***
TEXTE DE LA QUESTION (Question publiée au JO le : 14/07/2009 page : 6985) : "M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la prise en compte des capteurs solaires dans les dispositions du règlement national d'urbanisme (RNU). Pour les communes qui ne disposent pas de plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un même document en tenant lieu, les dispositions sont fixées par les règles nationales de l'urbanisme. Ces dispositions prennent en compte l'intérêt public d'urbanisme, d'hygiène ou encore de sécurité et salubrité, mais aucunement des considérations environnementales. Cette absence de mention risque de poser de sérieux problèmes de voisinage, notamment lors de la présence de capteurs solaires et des servitudes techniques en découlant sur une construction existante. Un nouveau bâtiment, qui ne prendrait pas en compte l'emplacement et la hauteur affectés pour l'ensoleillement du bâtiment voisin dont des capteurs solaires sont déjà installés, risque de mettre à néant les efforts environnementaux et financiers du voisin. C'est pourquoi il souhaite savoir si le Gouvernement compte prendre en compte les capteurs solaires dans les dispositions du RNU".
TEXTE DE LA REPONSE (Réponse publiée au JO le : 27/10/2009 page : 10209) : "Les projets de construction, tant dans le cas de l'installation de capteurs solaires sur un bâtiment existant que dans celui de la construction d'un bâtiment à proximité d'un bâtiment existant comportant des capteurs solaires, doivent respecter les préoccupations environnementales et paysagères. Sur les territoires non couverts par un document d'urbanisme, les autorisations d'occupation du sol sont délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme et des autres dispositions réglementaires, applicables au projet, telles que celles relatives à la protection des sites et paysages ou des monuments historiques. Sur ces territoires, l'État a toujours la possibilité, en application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, de refuser un projet ou de ne l'accepter que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les articles R. 111-16 à R. 111-19 du code de l'urbanisme y réglementent les distances minimales à respecter entre les constructions ; l'article R. 111-22 de ce code prévoit aussi que dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée par des prescriptions particulières. Par ailleurs, une autorisation de construire est toujours délivrée sous réserve des droits des tiers, ce qui signifie que même si l'autorisation de construire est légale au regard des règles précitées, un voisin peut faire valoir les préjudices, par exemple liés à la perte d'ensoleillement, qu'il subit du fait de la construction. Il peut en effet, se prévaloir de l'article 544 du code civil qui protège le droit d'utiliser sa propriété, par exemple en construisant mais que la jurisprudence interprète comme interdisant de causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Cour de cassation, Civ. 3e, 4 février 1971, Bull. Civ. III, n° 78). Ce trouble peut être la réalisation d'une construction causant au voisin un préjudice important, par exemple, une perte d'ensoleillement"
***
TEXTE DE LA QUESTION (Question publiée au JO le : 12/05/2009 page : 4441) : "M. Olivier Dussopt attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur l'application des dispositions de l'article L. 752-18 du code de commerce, modifié par l'article 102 de la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008 (LME) : « Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement commercial ». Il y a lieu de s'interroger sur la manière de concilier ces dispositions du code de commerce avec celles de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme qui prévoient, dans leur nouvelle formulation issue de l'article 105 de la LME, que « lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. » Antérieurement à l'adoption de la LME, il résultait de l'interprétation combinée des articles L. 752-18 du code de commerce et R. 423-36 du code de l'urbanisme que la réalisation du projet d'équipement commercial ne pouvait être entreprise et le permis de construire, dont le délai d'instruction était prolongé de quatre mois, ne pouvait être délivré, tant qu'une autorisation de la CNEC, expresse ou tacite, n'était pas intervenue. Depuis l'entrée en vigueur de la LME, l'article R. 423-36 du code de l'urbanisme, issu du décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008, envisage désormais la seule hypothèse d'un refus d'autorisation par la CDAC, en prolongeant de cinq mois le délai d'instruction de la demande de permis de construire. Dans ce contexte, la question posée est celle de savoir si un effet suspensif est toujours attaché au recours engagé devant la CNAC contre une décision de la CDAC, y compris lorsque cette décision est favorable à un projet de création ou d'extension d'un ensemble commercial, ou si, eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme actuellement en vigueur, il convient d'appliquer des règles juridiques différentes selon que la CDAC a refusé ou autorisé le projet ? Autrement dit, faut-il attendre l'expiration du délai de recours et, le cas échéant, la décision définitive de la CNAC ou peut-on procéder à la délivrance d'un permis de construire lorsque le projet a obtenu l'autorisation de la commission départementale ? À première lecture, il existe une contradiction entre les dispositions de l'article L. 752-18 du code de commerce et celles de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme. En effet, selon l'article L. 752-18 du code de commerce, l'introduction d'un recours devant la CNAC contre la décision d'une CDAC suspend les effets de cette décision dans l'attente de celle de la commission nationale qui se substitue à elle. Cette règle s'applique d'ailleurs que le projet soit soumis à permis de construire ou non. Il attire son attention sur le fait qu'une telle lecture impliquerait que soient méconnues les dispositions du code de l'urbanisme qui distinguent entre « délivrance » et « mise en oeuvre » du permis. De plus, dans le cadre de cette interprétation, le recours pour excès de pouvoir engagé devant le Conseil d'État contre la décision de la CNAC serait suspensif, contrairement à tous les autres recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative. En effet, comment alors interpréter les dispositions de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme qui édicte que « la mise en oeuvre du permis de construire ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle » ? Cette interprétation contreviendrait en outre au principe d'indépendance des législations selon lequel les autorisations d'urbanisme n'ont pas à assurer le respect de législations extérieures. Surtout, une telle solution irait à l'encontre de l'objectif de simplification et de rapidité dans les procédures d'aménagement commercial, fixé par la LME"
TEXTE DE LA REPONSE (Réponse publiée au JO le : 27/10/2009 page : 10179) : " L'articulation entre la délivrance du permis de construire et l'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) est prévue par les articles L. 425-7 du code de l'urbanisme et L. 752-18 du code de commerce. L'article L. 425-7 du code de l'urbanisme dispose que le permis de construire ne peut être accordé avant la délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale et que sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours exercés contre cette décision. Il résulte de ces dispositions que, dès qu'une AEC est accordée par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), le permis de construire peut être délivré par l'autorité administrative compétente. L'arrêté pris par celle-ci doit alors préciser au demandeur qu'en cas de recours formé devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), la mise en oeuvre du projet ne pourra intervenir avant que la CNAC ne se soit prononcée et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 752-18 du code de commerce. S'agissant des recours visés à l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme, le terme « recours » s'applique, bien entendu, aux seuls recours administratifs préalables obligatoires exercés devant la CNAC. Celle-ci doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce. En revanche, comme tous les recours contentieux pour excès de pouvoir, les recours formés devant la juridiction administrative contre une décision de la CNAC ne sont pas suspensifs. Le porteur de projet pourra donc procéder, sans délai, à l'exécution des travaux, dès que la décision de la Commission nationale accordant le projet lui aura été notifiée. Ainsi, l'ensemble des dispositions précitées répondent aux objectifs de simplification et de rapidité des procédures voulus par le législateur. À cet égard, il est rappelé que le délai imparti à la CDAC pour l'examen d'un projet est désormais de deux mois (art. L. 752-14 du code de commerce), au lieu de quatre mois sous l'ancienne législation. De même, le délai d'instruction du permis de construire a été ramené de sept à six mois (art. R. 423-28 c du code de l'urbanisme). Enfin, l'obligation du recours administratif préalable devant la CNAC doit permettre de réduire de manière significative les délais de la procédure contentieuse dans la mesure où les décisions de la Commission nationale ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'État qui statue en premier et dernier ressort. "
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés

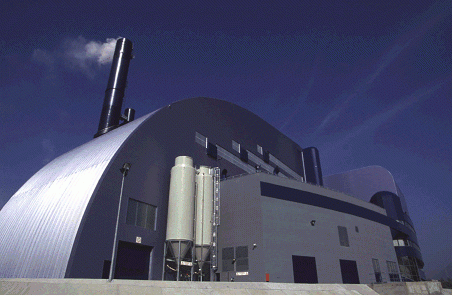
 Voici une décision d’importance en ce qu’elle constitue la première par laquelle le Conseil d’Etat a été amené à juger qu’un projet d’installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation d’exploiter peut donner lieu à un permis de construire tacite. La réponse n’était pas évidente. En effet, l’article R.421-19 (g) du Code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date des faits disposait que « le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite (…) lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application des articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement ».
Voici une décision d’importance en ce qu’elle constitue la première par laquelle le Conseil d’Etat a été amené à juger qu’un projet d’installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation d’exploiter peut donner lieu à un permis de construire tacite. La réponse n’était pas évidente. En effet, l’article R.421-19 (g) du Code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date des faits disposait que « le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite (…) lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application des articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement ». Dans cette affaire, la société pétitionnaire avait présenté une demande de permis de construire, portant sur une installation classée soumise à autorisation, relevant alors de la compétence du représentant de l’Etat dans le département, compte tenu de l’importance de ce projet envisagé sur le territoire d’une commune n’étant alors dotée d’autant document d’urbanisme local. Mais au terme de l’enquête publique se rapportant à la demande d’autorisation d’exploiter, le Préfet devait s’abstenir de statuer expressément sur la demande de permis de construire. Il reste qu’ultérieurement, la commune devait se doter d’un PLU puis opposer un refus de permis de construire à la société pétitionnaire. Toutefois, le Conseil d’Etat devait donc considérer que, d’une part, la demande avait précédemment donné lieu à un permis de construire tacite à l’expiration d’un délai d’un mois après la clôture de l’enquête publique sur la demande d’autorisation d’exploiter et, d’autre part et par voie de conséquence, que la décision de refus de la commune devait être requalifiée en décision de retrait d’un permis de construire tacite (pour exemple : CE. 19 février 2007, Sté d’Avignon Construction Immobilier, req. n°296.283) ; décision illégale compte tenu, notamment, de l’absence de mise en œuvre préalable de la procédure administrative contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 mais aussi de la tardivité de cette décision de retrait au regard de la date de formation du permis du construire tacite (on regrettera toutefois que le Conseil d’Etat ne se soit pas prononcé sur le délai applicable au sujet d’un permis acquis avant le 1er octobre 2007 mais après l’entrée en vigueur de l’article L.424-5 limitant à trois mois le délai de retrait d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir).
Dans cette affaire, la société pétitionnaire avait présenté une demande de permis de construire, portant sur une installation classée soumise à autorisation, relevant alors de la compétence du représentant de l’Etat dans le département, compte tenu de l’importance de ce projet envisagé sur le territoire d’une commune n’étant alors dotée d’autant document d’urbanisme local. Mais au terme de l’enquête publique se rapportant à la demande d’autorisation d’exploiter, le Préfet devait s’abstenir de statuer expressément sur la demande de permis de construire. Il reste qu’ultérieurement, la commune devait se doter d’un PLU puis opposer un refus de permis de construire à la société pétitionnaire. Toutefois, le Conseil d’Etat devait donc considérer que, d’une part, la demande avait précédemment donné lieu à un permis de construire tacite à l’expiration d’un délai d’un mois après la clôture de l’enquête publique sur la demande d’autorisation d’exploiter et, d’autre part et par voie de conséquence, que la décision de refus de la commune devait être requalifiée en décision de retrait d’un permis de construire tacite (pour exemple : CE. 19 février 2007, Sté d’Avignon Construction Immobilier, req. n°296.283) ; décision illégale compte tenu, notamment, de l’absence de mise en œuvre préalable de la procédure administrative contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 mais aussi de la tardivité de cette décision de retrait au regard de la date de formation du permis du construire tacite (on regrettera toutefois que le Conseil d’Etat ne se soit pas prononcé sur le délai applicable au sujet d’un permis acquis avant le 1er octobre 2007 mais après l’entrée en vigueur de l’article L.424-5 limitant à trois mois le délai de retrait d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir). D’ailleurs, si la soumission de l’autorisation d’exploiter à enquête publique devait amener à considérer que la demande de permis de construire devrait être traitée comme portant sur un « projet soumis à enquête publique » au sens du Code de l’urbanisme, il s’ensuivrait que l’instruction de cette demande serait régie par les articles R.423-20 et R.423-32 dudit code, lesquels disposent respectivement que, d’une part, « par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, le délai d'instruction d'un dossier complet part de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête » et que, d’autre part, « dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique (…) le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ». Il reste que si tel était le cas, on comprendrait mal l’utilité de l’article L.425-10 du Code de l’urbanisme en ce qu’il dispose que « lorsque le projet porte sur une installation soumise à autorisation en vertu de l'article L. 512-2 du code de l'environnement (…) les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique ». En effet, admettre que la délivrance d’un permis de construire une installation classée soumise à autorisation d’exploiter serait nécessairement subordonnée à enquête publique préalable et, par voie de conséquence, que le délai d’instruction de la demande court à compter de la remise du rapport d’enquête rendrait sans objet l’article L.425-10 puisqu’en toute hypothèse, un permis de construire portant sur une telle installation classée ne saurait intervenir avant la remise dudit rapport, laquelle est nécessairement postérieure à la clôture de l’enquête publique : il n’y aurait donc aucune utilité à préciser que les travaux ne peuvent être entrepris avant cette clôture… Et force est donc de considérer qu’une demande de permis de construire se rapportant à une installation classée soumise à autorisation d’exploiter ne constitue pas un « projet soumis à enquête publique » au sens des dispositions du Code de l’urbanisme applicables depuis le 1er octobre 2007.
D’ailleurs, si la soumission de l’autorisation d’exploiter à enquête publique devait amener à considérer que la demande de permis de construire devrait être traitée comme portant sur un « projet soumis à enquête publique » au sens du Code de l’urbanisme, il s’ensuivrait que l’instruction de cette demande serait régie par les articles R.423-20 et R.423-32 dudit code, lesquels disposent respectivement que, d’une part, « par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, le délai d'instruction d'un dossier complet part de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête » et que, d’autre part, « dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique (…) le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ». Il reste que si tel était le cas, on comprendrait mal l’utilité de l’article L.425-10 du Code de l’urbanisme en ce qu’il dispose que « lorsque le projet porte sur une installation soumise à autorisation en vertu de l'article L. 512-2 du code de l'environnement (…) les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique ». En effet, admettre que la délivrance d’un permis de construire une installation classée soumise à autorisation d’exploiter serait nécessairement subordonnée à enquête publique préalable et, par voie de conséquence, que le délai d’instruction de la demande court à compter de la remise du rapport d’enquête rendrait sans objet l’article L.425-10 puisqu’en toute hypothèse, un permis de construire portant sur une telle installation classée ne saurait intervenir avant la remise dudit rapport, laquelle est nécessairement postérieure à la clôture de l’enquête publique : il n’y aurait donc aucune utilité à préciser que les travaux ne peuvent être entrepris avant cette clôture… Et force est donc de considérer qu’une demande de permis de construire se rapportant à une installation classée soumise à autorisation d’exploiter ne constitue pas un « projet soumis à enquête publique » au sens des dispositions du Code de l’urbanisme applicables depuis le 1er octobre 2007.
 Or, un permis de construire obtenu conjointement par deux maîtres d’ouvrage ne constitue pas deux autorisations distinctes délivrées sous la forme d’un seul arrêté mais une seule et même autorisation ayant deux co-titulaires. ll s’ensuit que chacun des titulaires d’un permis de construire conjoint est au regard du droit de l’urbanisme autorisé à en exécuter l’intégralité, y compris lorsqu’il porte sur plusieurs unités foncières. De ce fait, force est donc de considérer que chacun d’entre eux doit disposer d’une qualité et/ou d’un titre l’habilitant à construire sur l’ensemble du terrain d’assiette de l’autorisation.
Or, un permis de construire obtenu conjointement par deux maîtres d’ouvrage ne constitue pas deux autorisations distinctes délivrées sous la forme d’un seul arrêté mais une seule et même autorisation ayant deux co-titulaires. ll s’ensuit que chacun des titulaires d’un permis de construire conjoint est au regard du droit de l’urbanisme autorisé à en exécuter l’intégralité, y compris lorsqu’il porte sur plusieurs unités foncières. De ce fait, force est donc de considérer que chacun d’entre eux doit disposer d’une qualité et/ou d’un titre l’habilitant à construire sur l’ensemble du terrain d’assiette de l’autorisation.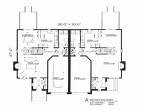 Mais il est vrai que là où l’ancien article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme prescrivait un titre habilitant à construire, l’article R.423-1 du Code de l’urbanisme n’impose plus au pétitionnaire, lorsqu’il n’est pas le propriétaire du terrain à construire, que d’attester être autorisé par celui-ci à exécuter les travaux ; cette attestation s’opérant en fait par la simple signature du formulaire « CERFA » de demande, lequel intègre une formule type à cet effet. On peut donc penser que dès lors que le propriétaire du terrain signera avec un autre pétitionnaire ce formulaire, cette signature vaudra autorisation donnée à l’autre d’exécuter les travaux sur son terrain.
Mais il est vrai que là où l’ancien article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme prescrivait un titre habilitant à construire, l’article R.423-1 du Code de l’urbanisme n’impose plus au pétitionnaire, lorsqu’il n’est pas le propriétaire du terrain à construire, que d’attester être autorisé par celui-ci à exécuter les travaux ; cette attestation s’opérant en fait par la simple signature du formulaire « CERFA » de demande, lequel intègre une formule type à cet effet. On peut donc penser que dès lors que le propriétaire du terrain signera avec un autre pétitionnaire ce formulaire, cette signature vaudra autorisation donnée à l’autre d’exécuter les travaux sur son terrain.