Sur l’assiette de la demande de permis de construire & l’échelle foncière à retenir pour l’application des règles d’urbanisme opposables au projet
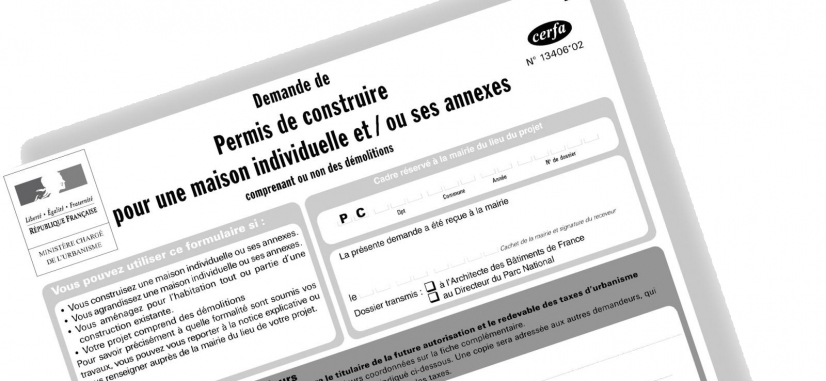
L’adjonction artificielle à l’assiette de la demande de parcelles n'ayant pas vocation à rester intégrées au terrain d'assiette du projet objet de celle-ci est inopérante, voire frauduleuse, et ne saurait donc être prise en compte pour apprécier la conformité de ce projet aux normes d’urbanisme lui étant opposables.
CAA. Nantes, 10 mai 2013, M. & Mme A…, req. n°12NT00134/CAA. Lyon, 6 mai 2013, Mme F… & autres, req. n°12LY02084.
La quasi-disparition du contrôle de la qualité habilitant à construire du pétitionnaire, et la généralisation subséquente de la théorie du propriétaire apparent ou du moins de ses effets, ont conduit au développement d’une doctrine selon laquelle, en substance, dès lors que le pétitionnaire y est autorisé par le propriétaire des parcelles voisines concernées, le cas échéant par une simple autorisation ad hoc, celui-ci peut librement aménager l’assiette de sa demande de permis de construire, laquelle constituerait alors l’unité foncière (apparente) à prendre en compte pour application des règles d’urbanisme opposables à son projet ; certains allant même jusqu’à considérer qu’une fois l’autorisation obtenue, les parcelles voisines ainsi incluses dans la demande pourraient en outre être ultérieurement réutlisées aux mêmes fins et de la même matière par d’autres demandes de permis de construire.
Aussi peu contraignante que séduisante à l’ère de la surdensification, les fondements de cette analyse posent toutefois une difficulté puisque si le contrôle de ce qu’il est encore convenu d’appeler le titre habilitant à construire est effectivement réduit à une peau de chagrin du fait des dispositions combinées des articles R.423-1 et R.431-5 du Code de l’urbanisme, il n’en demeure pas moins que ces derniers n’ont en eux-mêmes strictement aucune incidence sur la notion d’unité foncière et la règle selon laquelle celle-ci constitue en principe l’échelle d’application des règles d’urbanisme.
Et précisément, voici deux arrêts qui bien que rendus dans des affaires au contexte particulier tendent à établir que la légalité du procédé susdécrit n’est à tout le moins pas si évidente.
Dans la première affaire, le pétitionnaire avait obtenu un permis de construire portant sur les deux parcelles qu’il avait indiquées et inclut dans sa demande de permis de construire. Toutefois, il devait ultérieurement apparaitre que l’une de ces deux parcelles ne lui appartenait pas, ce qui devrait ainsi conduire le Maire à retirer cette autorisation, en l’occurrence pour fraude ; motif de retrait que devait confirmer la Cour administrative d’appel de Nantes en jugeant que :
« considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Label Immo, marchand de biens, alors représentée par M. A..., a acquis en février 2005 à Indre une parcelle enclavée de 50 m², cadastrée AD 576 ; que M. B..., cadre commercial de cette société, a sollicité le 5 septembre 2005 un permis de construire sur cette parcelle qui lui a été accordé le 15 septembre 2005 ; qu'il a indiqué dans la demande de permis que la superficie du terrain était de 71 m² et, sur le plan de masse joint à la demande, a incorporé dans le terrain d'assiette du projet la partie de la parcelle voisine, cadastrée AD 559, séparant la parcelle AD 576 de la rue des Civelles ; qu'il est constant que lors d'une réunion tenue le 30 avril 2009 en mairie préalablement au retrait dudit permis, M. B... a reconnu avoir sciemment donné dans sa demande des indications erronées sur la consistance exacte de la parcelle d'assiette du projet, lesquelles ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la conformité de la construction projetée aux articles UA 3 et UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme exigeant que pour être constructible un terrain doit être desservi par une voie publique et raccordé aux réseaux d'eau potable et d'eaux usées ; que l'état d'enclavement de la parcelle AD 576 était par ailleurs rappelé dans l'acte de vente du 23 juin 2008 au profit de M. et Mme A..., auquel le permis avait été transféré le 5 mars 2009 ; qu'ainsi ce permis, obtenu par fraude, n'a pu créer de droits au profit de ses bénéficiaires successifs ; que, dans ces conditions, le maire a pu légalement le retirer par l'arrêté contesté du 26 mai 2009 ; que les appelants ne sauraient se prévaloir pour établir l'absence de fraude, ni d'une prétendue prescription acquisitive trentenaire au profit des propriétaires successifs de la parcelle litigieuse portant sur la fraction de la parcelle voisine AD 559 séparant leur terrain de la rue des Civelles, ni de la circonstance que cette fraction de parcelle est isolée par un mur de sa partie principale, ni d'une offre de vente très rapidement retirée de cette fraction de parcelle ; qu'ils ne sauraient enfin utilement soutenir, dès lors qu'eux-mêmes ne peuvent être regardés comme de bonne foi, que le retrait du permis de construire aurait dû intervenir par sécurité juridique dans le délai prévu par l'article 424-5 précité du code de l'urbanisme alors même que ce permis serait frauduleux ».
D’une façon générale, il faut ainsi rappeler que la fraude implique non seulement une démarche du pétitionnaire tendant à masquer la réalité de son projet aux services instructeurs mais que cette démarche soit entreprise dans le but de contourner une règle d’urbanisme qui se serait opposée à la délivrance du permis de construire sollicité. Pour qu’il y ait fraude, il faut donc nécessairement que le « projet réel » du pétitionnaire soit illégal.
Plus spécifiquement, force est de relever que la Cour n’a aucunement recherché si le pétitionnaire avait ou non sollicité et obtenu l’autorisation du propriétaire de la parcelle qu’il avait intégrée à sa demande de permis de construire. Et pour cause puisque la fraude ainsi caractérisée par la Cour n’est pas une fraude à l’article R.423-1 du Code de l’urbanisme mais aux articles 3 et 4 du règlement local d’urbanisme applicable.
On peut donc penser que quand bien même le pétitionnaire aurait-il disposé de l’autorisation du propriétaire de cette parcelle, voire aurait clairement indiqué qu’il ne disposait que de l’autorisation ad hoc de celui-ci, le permis de construire contesté aurait néanmoins été jugé illégal au regard des articles 3 et 4 en cause.
C’est ce que tend à confirmer le second arrêt objet de la note de ce jour, lequel a pour sa part été précisément rendu au sujet d’une règle relative aux droits à construire, le COS…
Dans cette affaire, le pétitionnaire avait obtenu un permis de construire portant sur trois parcelles contiguës dont deux avaient fait l’objet d’une délibération du Conseil municipal en permettant la vente au pétitionnaire tout en l’autorisant, par anticipation, à présenter sa demande de permis de construire sur celle-ci.
Il reste que le permis de construire obtenu dans ces conditions devait donc être annulé par la Cour administrative d’appel de Lyon au motif suivant :
« considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire que le terrain d'assiette du projet qui a été autorisé par l'arrêté litigieux est constitué des parcelles cadastrées AR 291 et AR 163 et d'une partie de la parcelle cadastrée AR 232, correspondant à la nouvelle parcelle cadastrée AR 294 ; que, par une délibération du 24 septembre 2007, le conseil municipal de la commune de Gières a autorisé la cession des parcelles cadastrées AR 163 et AR 294 à la société ECAF et, dans l'attente, a autorisé cette société ou la société Yves Coppa immobilier à déposer une demande de permis de construire sur ces parcelles ; que cette même délibération prévoit que, sur ces dernières, la société ECAF réalisera un chemin réservé aux piétons et cyclistes et que, le coût de ces travaux d'aménagement étant égal à la valeur du terrain, la cession sera réalisée gratuitement, les espaces ainsi aménagés, destinés à l'usage du public, étant ensuite rétrocédés à la commune ; que, conformément à ces dispositions, le projet litigieux de la société Yves Coppa immobilier prévoit la réalisation d'une voie réservée aux piétons et cyclistes sur lesdites parcelles ; que, dans ces conditions, dès lors que ces dernières n'avaient aucunement vocation à rester intégrées au terrain d'assiette du projet de la société Yves Coppa immobilier, seule la parcelle cadastrée AR 291 doit être prise en compte pour la détermination des droits à construire résultant des dispositions précitées de l'article Uc 14 du règlement du plan local d'urbanisme, dont la finalité est de limiter la densité des constructions en zone Uc, qui constitue une zone d'habitat de moyenne densité ; que la superficie de cette parcelle étant de 3 250 m², la surface hors oeuvre nette du projet ne pouvait excéder 1 625 m² ; que l'arrêté contesté autorise une surface hors oeuvre nette de 2 026,23 m² ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l'article Uc 14 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ».
A titre liminaire, et dans le prolongement de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes, il faut relever que la Cour administrative d’appel de Lyon a donc jugé que le permis de construire contesté était certes illégal mais ce, sans préciser qu’il était à cet égard entaché de fraude alors qu’à s’en tenir aux visas de cet arrêt il semble que l’existence d’une fraude ait été invoquée par les requérants.
Mais outre que la caractérisation d’une fraude n’est réellement utile que dans le cadre du contentieux des retraits d’autorisation intervenant après l’expiration du délai prévu par l’article L.424-5 du Code de l’urbanisme, ou dans le cadre du contentieux pénal se rapportant à la conformité des travaux exécutés, il faut cette fois-ci rappeler que la fraude implique une démarche tendant à tromper l’autorité compétente sur la réalité du projet objet de la demande ; ce dont il résulte qu’en principe, la fraude est exclue lorsqu’il est établi que l’administration avait nécessairement connaissance de la réalité du projet (pour un exemple en matière de divisions : CE. 21 mars 2007, Cne de Saint-Laurent du Var, req. n°278.559. Et en matière d’adjonction de parcelles : CAA. Paris, 10 novembre 2010, Max A…, req. n°09PA03116).
Or, en l’espèce, les parcelles en cause avait fait l’objet d’une délibération du Conseil municipal de l’autorité compétente qui, malgré le principe d’indépendance des procédures et des législations, n’était pas réputée l’ignorer (CE. 23 décembre 2011, Association pour la défense et la protection de la commune de Varaville, req. n°322.912).
En outre, si certains arrêts induisent que la fraude peut résulter d’une collusion entre le pétitionnaire et l’autorité compétente (CE. 21 mars 2007, Cne de Saint-Laurent du Var, req. n°278.559), la fraude implique également la caractérisation d’une démarche dolosive par définition volontaire et, concrètement, qu’il puisse être établi (par preuve ou présomption) que le pétitionnaire (et le cas échéant son complice) avait parfaitement connaissance de l’illégalité du projet objet de la demande (sur la complicité du Maire : Cass. crim. 14 juin 2005, pourvoi n° 05-80916, Bull. crim. n° 179) ; ce qui était ici nettement évident que dans l’affaire objet de l’arrêt de la Cour administrative de Nantes.
Pour le reste, et en tout état de cause, deux observations doivent être formulées au sujet des données particulières de cette affaire et ce, pour préciser que celle-ci n’ont a priori eu aucune incidence en l’espèce.
En premier lieu, il est vrai que permis de construire contesté intégrait la réalisation de travaux portant sur les parcelles à céder, ainsi incluse dans la même demande d’autorisation, alors qu’il y avait manifestement aucun lien entre ces travaux et ceux constituant le projet propre du pétitionnaire.
Il reste, comme on le sait, que rien ne s‘oppose à ce qu’un pétitionnaire acquiert une parcelle voisine dans le but d’augmenter la constructibilité de sa propriété d’origine et ce, y compris s’il ne projette aucun travaux sur celle-ci (CE. 30 décembre 2002, SCI d’HLM de Lille, req. n°232.584).
Dans cette affaire, ce n’est donc pas la seule adjonction des deux parcelles communales à l’assiette de la demande qui explique en elle-même l’illégalité du permis de construire contesté.
En second lieu, si les requérants semblaient soutenir que les deux parcelles communales et les droits à construire y étant attachés relevaient du domaine public et étaient ainsi inaliénables par la commune et « inexploitables » par le pétitionnaire, cette circonstance n’avait en toute hypothèse aucune incidence selon nous.
En effet, ce principe d’inaliénabilité aujourd’hui codifié à l’article L.3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques est une règle propre à la législation sur le domaine public alors que la notion de « droits à construire» et/ou de « surface constructible » attachés à une unité foncière est propre au droit de l’urbanisme et découle exclusivement de l’application d’une règle du POS/PLU communal, en l’occurrence le COS.
Or, dans la mesure où la législation d’urbanisme est indépendante de la règlementation relative à la protection du domaine public, cette dernière règlementation ne saurait avoir aucune incidence sur les modalités d’application de la règle d’urbanisme et, par voie de conséquence, la méconnaissance de la règlementation sur le domaine public n’a en principe (et sous réserve de rares exceptions) aucune incidence sur la légalité d’une autorisation d’urbanisme.
A l’examen de la jurisprudence rendue en la matière, force est d’ailleurs de constater qu’aucun permis de construire obtenu par un pétitionnaire, public comme privé, n’apparait avoir été annulé au motif qu’il consommait des « droits à construire » attachés à une unité foncière relevant pour tout ou partie du domaine public. Au regard de cette jurisprudence, le statut de l’unité foncière et son éventuelle appartenance au domaine public apparait d’ailleurs n’avoir aucune forme d’incidence. Et pour cause dans la mesure où le COS a vocation à être appréciée au regard de l’ensemble de l’unité foncière (CE. 4 janvier 1997, Thierry A., req. n°129.494) alors que :
• la règlementation sur le domaine public n’a aucune incidence particulière sur la notion d’unité foncière puisqu’elle est strictement identique à celle employée par le droit de l’urbanisme (CE. 19 juillet 2010, André A…, req. n°329.199) ;
• la superficie des parcelles relevant du domaine public ne comptent pas en tant que telles parmi celles à déduire au titre de l’article R.123-10 précité, lequel est d’application stricte.
A titre d’exemple, et au sujet d’un permis de construire une construction à destination d’habitation obtenu par un pétitionnaire privé sur un terrain communal accueillant un lycée, il a été que le COS dont pouvait bénéficier la construction en litige devait être appliqué au regard de la superficie de l’ensemble de l’unité foncière sur lequel portait le permis de construire contesté, indépendamment donc de toute considération liée au fait que l’une des parcelle de ce tènement appartenant à la commune accueillait un lycée et relevait ainsi du domaine public (CAA. Marseille, 30 août 2001, M. X… & autres, req. n°99MA02325). Surtout, la Cour administrative d’appel de Versailles a comme on le sait eu l’occasion de juger le COS devait être apprécié au regard de l’ensemble de l’unité foncière telle qu’elle était encore constituée à la date de délivrance du permis de construire contesté (CAA. Versailles, 29 mars 2007, ADEJJ, req. n°06VE01147) et ce, alors même que l’une des deux parcelles composant cette unité foncière relevait du domaine public et devait y rester intégrée puisqu’à travers sa promesse de vente, le pétitionnaire avait également acquis une partie des « droits à construire » attachés à cette parcelle du domaine public pour les consommer sur la parcelle d’assiette du projet.
Au demeurant, force est d’ailleurs de constater que la Cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée sans attacher ni au statut des parcelles en cause au regard de la domanialité publique, ni plus généralement à la légalité de l’a délibération prévoyant leur vente au pétitionnaire.
Il est vrai toutefois que, dans l’affaire ici en cause, la Cour administrative d’appel de Lyon a souligné que « cette même délibération prévoit que, sur ces dernières, la société ECAF réalisera un chemin réservé aux piétons et cyclistes et que, le coût de ces travaux d'aménagement étant égal à la valeur du terrain, la cession sera réalisée gratuitement, les espaces ainsi aménagés, destinés à l'usage du public, étant ensuite rétrocédés à la commune ; que, conformément à ces dispositions, le projet litigieux de la société Yves Coppa immobilier prévoit la réalisation d'une voie réservée aux piétons et cyclistes sur lesdites parcelles ».
Il reste que ce faisant, celle-ci n’a fait que constater que le projet objet du permis de construire contesté correspondait exactement pour les parcelles en cause à ce que prévoyait la délibération adoptée et ce, pour en déduire que l’obtention et la mise en œuvre de ce permis de construire appelaient donc également la réalisation des autres dispositions de cette délibération, à savoir la rétrocession des deux parcelles à la Ville, à savoir leur propriétaire d’origine (voir également : CAA. Nancy, 16 mai 2002, SCI Helios, req. n°97NC02596 ; CAA. Lyon, 10 mars 1998, Ville de Nice, req. n°94LY01151).
Ainsi, le seul motif pour lequel la superficie de ces parcelles a été déduite de l’assiette de la demande tient uniquement au fait qu’il était établi que dès l’origine « ces dernières n'avaient aucunement vocation à rester intégrées au terrain d'assiette du projet de la société Yves Coppa immobilier ». C'est d'ailleurs ce que tendent à confirmer les conclusions du Rapport publique, lesquelles ont d'ailleurs pour principal intérêt d'établir que la réponse à la question posée relevait quasiment de l'évidence :
« Le débat conduit par les Consorts Brunet-Jailly devant votre Cour a pour point central l’application des dispositions de l’article UC 14 du Règlement du PLU de la Commune de Gières qui fixe à 0,5 le COS en zone UC. Les requérants estiment en effet que ces dispositions ont été méconnues par les auteurs du projet et que la cession gratuite et temporaire consentie par la Commune n’aurait eu pour seul objet que de permettre de transgresser cette règle de COS. Le raisonnement des requérants quant au calcul de la SHON autorisée par le COS semble bien devoir être retenu. La parcelle de 3250 m² vendue par les Consorts Brunet-Jailly ne permet à elle seule, par application du COS de 0,5 autorisé par le Règlement du PLU, qu’une SHON de 1625 m², alors que, comme nous l’avons dit, le permis de construire a autorisé une SHON de 2026,23 m². Les requérants estiment même que cette SHON serait en réalité de 2171,23 m² car la déduction de la surface forfaitaire par logement accessible aux personnes handicapées permise par l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme ne pourrait être appliquée, alors que l’architecte du projet et le bénéficiaire du permis de construire ont attesté de cette pris en compte. Il faut donc en rester à la SHON de 2026,23 m² et finalement convenir que ce n’est que par l’ajout, temporaire, des parcelles communales AR 163 en totalité et 3 AR 232 en partie – d’une surface globale de 994 m² - que le COS attribué à la zone UC pourrait être respecté. Or, ces parcelles ne vont entrer, comme nous l’avons dit, que temporairement dans le patrimoine du bénéficiaire du permis de construire – le temps de la réalisation des travaux – puisque la délibération du 24 septembre 2007, sur laquelle est aussi fondé le permis de construire, en prévoit expressément la rétrocession à la Commune. Ainsi, les deux parcelles communales en cause paraissent devoir être exclues du calcul du COS Voyez pour une hypothèse assez similaire l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy n° 97 NC 2596 du 16 mai 2002 SCI Helios ».
A ce stade, force serait donc d’en déduire que les règles d’urbanisme, y compris le COS, devraient donc être appliquées à la seule échelle des parcelles devant constituées et restées « durablement » le terrain d’assiette effectif du projet objet de la demande ; ce qui serait donc également transposable et opposable à un permis de construire appelant une division primaire au sens de l’article R.442-1 a) du Code de l’urbanisme.
Il reste que, comme nous l’avons déjà abordé, l’analyse selon laquelle, en cas de divisions primaires, les règles d’urbanisme, et en tous cas le COS, doivent être appliquées à l’échelle de la totalité de l’unité foncière d’origine procède en substance de la circonstance que (CE. 18 octobre 1995, SCI Vaugirard, Rec. p.1080) :
• d’une façon générale, l’unité foncière qui constitue l’échelle d’application des règles d’urbanisme doit s’appréciée telle qu’elle est constituée à la date à laquelle l’autorité compétente statue sur la demande ;
• plus spécifiquement, une division primaire s’opère par définition après l’obtention du permis de construire, lequel porte donc à sa date de délivrance sur une unité foncière n’ayant pas été encore divisée.
Or, en l’espèce, il n’était nullement question de la division primaire d’une unité foncière d’origine. La demande portait en effet sur trois parcelles cadastrales mais dont seulement deux appartenaient à la Ville. A l’origine, il y avait donc deux unités foncières distinctes.
Et c’est toute la différence puisque le montage litigieux en l’espèce consistait ainsi à adjoindre les deux parcelles communales à la troisième avant, et comme prévu dès l’origine, de les rétrocéder à leur propriétaire initial. En substance, ce montage consistait ainsi à créer provisoirement et donc artificiellement une unité foncière d’apparence unique et ce, pour les seuls besoins d’un projet de construction ne portant que sur l’une des deux unités d’origine.
C’est donc bien l’artificialité découlant du caractère dès l’origine provisoire de cette adjonction de parcelles à l’assiette de la demande qui nous semble avoir été ici sanctionnée ; ce qui est a fortiori transposable au cas où le pétitionnaire n’a qu’une autorisation ad hoc du propriétaire voisin.
Et pour cause puisque mise en œuvre aux seules fins d’accroitre les possibilités de construction attachées à une unité foncière en utilisant celles d’une ou plusieurs unités voisines, une telle démarche, à l’instar de l’objectif poursuivi par la doctrine évoquée en introduction de la présente note, aboutit ni plus ni moins à un transfert de COS pourtant strictement encadré et limité par l’article L.123-4 du Code de l’urbanisme, lequel compte tenu de sa valeur législative prime ou plutôt gouverne l’interprétation à retenir de l’article R.123-10 en ce qu’il dispose que « pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend (…) » ; ce sur quoi on voit mal comment les dispositions combinées des articles R.423-1 et R.431-5 du Code de l’urbanisme et/ou la suppression de l’ancien article L.111-5-2 pourraient avoir une quelconque incidence…
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés

