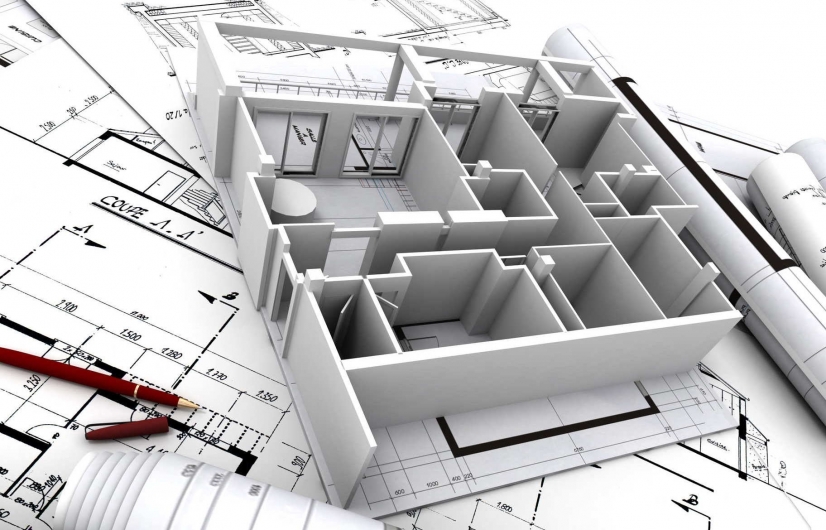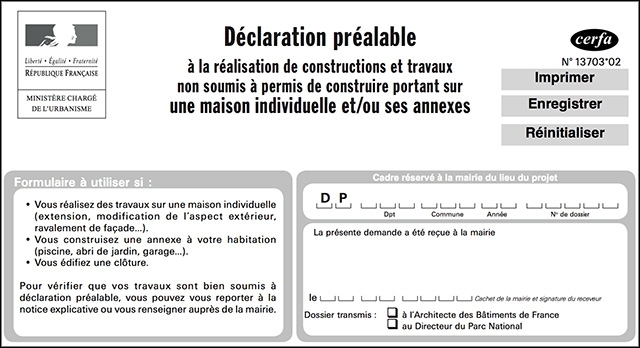INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES
CAA. Lyon, 26 avril 2011, Cne de Roche-la-Molière, req. n°09LY01506
« Considérant qu'aux termes de l'article UCb7 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE ROCHE-LA-MOLIERE relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions peuvent s'implanter: / - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment et jamais inférieur à 4 mètres. / - soit le long des limites séparatives : / *si leur hauteur n'excède pas 3,50 m sur la limite séparative. / *s'il existe déjà un bâtiment édifié en limite séparative sur la parcelle voisine à condition de ne pas dépasser la hauteur existante. / *à l'intérieur d'un lotissement ou groupe de maisons individuelles comportant des maisons en bande ou jumelées. / Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 7 peuvent être autorisées lorsqu'il s'agit :(...) / - de la construction d'une piscine (à un mètre minimum de la limite séparative) ; que, pour l'application d'une telle règle, la hauteur s'apprécie, sauf dispositions contraires du document d'urbanisme, à partir du terrain naturel et jusqu'au niveau de l'égout du toit pour l'ensemble des façades et au niveau du point le plus élevé du toit pour les murs-pignons ; qu'il ressort des plans produits que la hauteur en limite séparative du mur pignon excède les 3m50 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction litigieuse puisse être regardée comme une maison en bande ou jumelée ; qu'ainsi l'arrêté contesté méconnaît l'article UCb7 du règlement du plan local d'urbanisme ».
CAA. Lyon, 12 avril 2011, Mireille C., req. n°09LY01252
« Considérant qu'il est constant que le permis de construire, délivré le 20 mars 2008 à la société civile immobilière Les Lilas-M. D comportait une clause de cession gratuite du terrain nécessaire à l'élargissement de la voie, au profit de la commune de Crolles, d'un tènement d'une superficie de 108 m2 en application du 2ème alinéa de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ; que le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2010 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du dispositif de cessions gratuites de terrains prévu à l'article L. 332-6-1 e) précité ; que le Conseil constitutionnel, par une décision en date du 22 septembre 2010 a déclaré contraire à la constitution l'article L. 332-6-1 2°) e du code de l'urbanisme et a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision et qu'elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ; que la cession précitée étant dépourvue de base légale, la commune ne peut s'en prévaloir ; qu'ainsi, le respect des dispositions de l'article UC 6 du règlement du POS ne peut être assuré par la cession gratuite de terrain à la commune ; que la seule délimitation d'un emplacement réservé par le plan d'occupation des sols ne saurait être regardé comme un alignement nouveau ; que, dès lors, seul l'alignement délimité par le POS, sans prise en compte de l'emplacement réservé devait permettre d'apprécier l'implantation de la construction sur le fondement des dispositions de l'article UC6 du règlement du POS ; que si la commune fait valoir que compte tenu de la configuration de la parcelle en triangle, une autre implantation pouvait être acceptée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette implantation dérogatoire soit justifiée pour des raisons d'architecture, de salubrité ou de sécurité ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu l'article UC6 précité »
CAA. Lyon 12 avril 2011, Cne de Viviers, req. n°09LY01635
« Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols : Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : (...) L'aménagement sans extension, la restauration sans extension, ou l'extension mesurée ( 30% de la SHON ) des bâtiments existants ayant une surface hors oeuvre nette d'au moins 60 m², sans changement de destination (...) ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé en zone ND1 du POS approuvé en 1993 ; que, s'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment existant, une lapinière, n'est plus exploitée depuis environ 15 ans, il n'était pas à la date de la décision attaquée utilisé pour une autre destination que son affectation initiale et n'avait pas perdu sa destination agricole d'origine ; que, d'ailleurs, le demandeur de l'autorisation sollicitée a, dans son dossier de demande de permis de construire, présenté explicitement son projet comme tendant au changement de destination d'un bâtiment existant ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE VIVIERS était fondé à opposer à la demande présentée par M. A un refus au motif de ce que le projet entraînerait un changement de destination de la construction existante ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE VIVIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande d'annulation présentée par M. A »
CE. 14 mars 2011, Cne d’Ajaccio, req n°308.987
« Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement du lotissement de La Colline du Scudo, dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet litigieux : (...) la hauteur des constructions mesurée de l'égout du toit au point le plus bas de ladite construction, ne pourra dépasser une hauteur maximale de 8 mètres ; qu'eu égard à l'objet de la règle ainsi édictée, la hauteur de la construction doit être mesurée à partir du niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible ; qu'en tenant compte de l'épaisseur de la dalle sur hérisson sur laquelle a été élevée la construction litigieuse pour apprécier la hauteur maximale prévue par l'article 7 du règlement du lotissement, au lieu de rechercher à quel niveau se situe le sol, la cour a commis une erreur de droit »
CAA. Paris, 3 mars 2011, SCI CNC, req .n°09PA01454
« Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le projet litigieux porte sur une construction unique comportant deux logements dont les accès privatifs se font par l'extérieur ; qu'en effet, le premier logement, qui bénéficie, à l'extérieur de la construction, de deux places de stationnement accessibles par deux portails, dispose d'un accès par le premier étage depuis un escalier externe ; que le second logement est accessible depuis l'extérieur par une porte située au rez-de-chaussée et donnant sur l'aire de stationnement affectée au premier logement ; que, par ailleurs, les deux logements sont desservis depuis la rue par un portillon comm un ; que, par suite, cette aire de stationnement doit être regardée comme une partie commune ; que, dans ces conditions, le permis de construire critiqué porte sur l'édification d'un habitat collectif au sens des dispositions de l'article UB 14 du POS de la commune de Nanteuil-lès-Meaux telles qu'elles sont éclairées par le lexique qui y est annexé ; que, dès lors, le COS applicable ne pouvait être de 0,50 mais seulement de 0,20 ; que, par suite, la SHON autorisée ne pouvait excéder une SHON de 123,20 m² ; que le permis de construire litigieux autorisant une SHON de 306,76 m² a été délivré en méconnaissance des dispositions sus rappelées de l'article UB 14 du POS »
PLU/POS
CAA. Marseille, 31 mars 2011, X…, req. n°09MA01536
« Considérant en deuxième lieu que la société appelante invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'article II NB2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, contrairement à ce qui est soutenu, un lotissement constitue un type d'occupation et d'utilisation des sols ; que l'interdiction de ce type d'occupation des sols fait partie des choix dont disposent les auteurs d'un plan d'occupation des sols en application de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme, même dans une zone suffisamment équipée ; que les requérants ne démontrent pas que ce choix reposerait en l'espèce sur une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du règlement doit par suite être écarté »
CA. Nîmes, 22 février 2011, Cne de Pujaut, arrêt n°150, R. G : 10/ 04869
« La Cour observe en premier lieu que si les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour préciser le sens des actes administratifs réglementaires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative d'en contrôler la légalité et en second lieu qu'il n'est tiré aucune conséquence de cette exception sur le plan procédural puisque les intimés concluent au débouté alors que la juridiction de l'ordre judiciaire à laquelle est opposée l'exception d'illégalité est seulement tenue de surseoir à statuer si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige. En l'occurrence il est argué de la non-conformité des règles du plan d'occupation des sols et du permis de construire aux dispositions de l'article R. 123 – 9 du code de l'urbanisme en ce que ce dernier ne prévoit pas de règles relatives au nombre de logements par terrain. Cette exception est dépourvue de caractère sérieux alors que l'arrêté de permis de construire a toutes les apparences de la légalité et que l'article précité n'est pas limitatif »
EMPLACEMENTS RESERVES
CAA. Nantes, 18 février 2011, Jean-Martial X…, req. n°09NT02804
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'opération projetée par M. X est constitué par les parcelles cadastrées AN 511 et AN 513, grevées par le futur plan local d'urbanisme de la servitude précitée ; que l'instauration de cette servitude répond aux objectifs du plan local d'urbanisme à venir, tendant notamment à densifier le centre-ville de La Chapelle-sur-Erdre, dont les équipements publics, et plus particulièrement les écoles, sont insuffisamment utilisés, et les commerces trop peu fréquentés et à résorber le déficit communal en matière de logements sociaux ; que l'édification sur cet emplacement réservé d'un ensemble immobilier comportant la réalisation de cinq logements, dont aucun logement social, et de 197 m² de commerces, pour une surface hors oeuvre nette totale de 760,40 m², aurait, en raison de son incompatibilité avec la densité et le type de logements imposés pour lesdites parcelles par la servitude précitée, compromis et rendue plus onéreuse l'exécution du plan en cours d'élaboration, alors même que la réalisation dans la commune de plusieurs programmes de logements locatifs sociaux est programmée à terme et que l'opération projetée est compatible avec les prescriptions du plan arrêté applicables à la zone UA du centre-ville et avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable ; qu'ainsi, le maire de La Chapelle-sur-Erdre a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire de l'intéressé »
DROIT DE PREEMPTION
CE. 2 mars 2011, Cne de Bretignolles-sur-Mer, req. n°315.880
« Considérant, en premier lieu, que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la définition par le conseil municipal des conditions d'exercice de la délégation ne concerne, en tout état de cause, pas la délégation au maire lui-même de l'exercice du droit de préemption urbain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conseil municipal de la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER, qui avait, par une délibération du 13 novembre 2002 prise sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégué au maire le pouvoir d'exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain, n'était pas tenu de fixer des conditions particulières à cette délégation ; que cette délibération était dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, suffisamment précise et ne nécessitait pas de nouvelle délibération du conseil municipal pour permettre à son maire d'exercer le droit de préemption au nom de la commune ; qu'en l'absence de toute délibération ultérieure rapportant cette délégation, le conseil municipal devait être regardé comme s'étant dessaisi de sa compétence ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a jugé que la délibération litigieuse du 25 mars 2004 était entachée d'incompétence »
TRAVAUX SUR EXISTANT
CAA. Nantes, 25 mars 2011, M. X…, req. n°10NT00079
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'extension envisagée est classé en zone A par le plan local d'urbanisme communal ; qu'il n'est pas contesté que la maison d'habitation des requérants, dont la surface hors oeuvre nette était alors de 118 m², a bénéficié le 15 janvier 2002 d'un permis de construire autorisant une première extension de 46 m² ; que cet agrandissement étant supérieur à celui autorisé par les dispositions précitées de l'article 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme, le maire de Sainte-Anne d'Auray a fait une exacte application de cet article en refusant le permis de construire sollicité pour une seconde extension de 30 m² ; que si les articles 9 et 14 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme disposent, respectivement, que l'emprise au sol des constructions n'est pas limitée et que le coefficient d'occupation des sols ne l'est pas davantage, lesdits articles ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de la demande d'extension litigieuse »
AUTORISATIONS D’URBANISME
CE. 27 avril 2011, Association La Demeure Historique, req. n°309.709
« Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-27 du code du patrimoine : L'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser. / Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. / Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa. L'autorité administrative ne peut s'opposer à ces travaux qu'en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue par le présent titre. (...) ; que l'article 41 du décret attaqué dispose que : Lorsqu'il est envisagé de réaliser sur un immeuble inscrit des constructions ou travaux autres que, d'une part, des travaux d'entretien ou de réparation ordinaires qui sont dispensés de toute formalité et, d'autre part, des constructions ou travaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, la déclaration prévue au premier alinéa du même article est souscrite quatre mois au moins avant la date de leur réalisation. (...) ; qu'en soumettant à déclaration préalable les travaux de modification des immeubles inscrits, le législateur a entendu viser les travaux qui sont de nature soit à affecter la consistance ou l'aspect de la partie inscrite de l'immeuble, soit à compromettre la conservation de celle-ci ; qu'en excluant de la déclaration préalable les travaux d'entretien ou de réparation ordinaires , les auteurs du décret attaqué ont entendu viser les seuls travaux qui ne sont pas de nature à avoir un tel effet et n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 621-27 du code du patrimoine »
CAA. Marseille, 14 avril 2011, Laurence A., req. n°09MA02044
« Considérant que la notification du délai d'instruction adressée le 18 décembre 2007 par le maire de la commune de Lucciana à Mme Laurence A ne pouvait être fondée sur l'article R.421-19 du code de l'urbanisme dont les dispositions avaient été abrogées à compter du 1er octobre 2007 ; que la mention erronée de ce délai n'a pu avoir aucune incidence sur le délai d'instruction commun fixé pour les maisons individuelles à deux mois par l'article R.423-23 du code de l'urbanisme ;
Considérant que le maire aurait pu justifier la prolongation à trois mois de ce délai par la consultation de services que les particularités de l'instruction du dossier aurait rendu nécessaire ; que, toutefois, la seule mention de cette nécessité, sans citer les consultations estimées nécessaires et sans en produire de justificatifs, alors que le refus de permis de construire ne vise aucune consultation, ne permettait pas au maire de prolonger discrétionnairement ce délai à trois mois »
CAA. Marseille, 14 avril 2011, Association Sauvons le Business Club, req. n°09MA03433
« Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un permis de construire est demandé pour l'édification d'un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d'un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'ouvrage qu'il se propose d'édifier ; que les requérants soutiennent que la société ne pouvait pas présenter la demande d'autorisation attaquée dès lors que diverses parties du bâtiment sont en saillie sur la voie publique et qu'aucune autorisation d'occupation du domaine public ne lui a été délivrée »
CAA. Nancy, 12 avril 2011, Association Vivre à Chanaz, req. n°09LY00480
« Considérant, en deuxième lieu, que l'ASSOCIATION VIVRE à CHANAZ et Mme A, qui invoquent un détournement de procédure, soutiennent que l'administration aurait dû porter une appréciation globale sur le projet d'aménagement du plan d'eau et de son port et de construction des huit chalets lacustres ; que, toutefois, la création du plan d'eau est soumise à une législation particulière, au titre de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, désormais codifiée aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'en application de cette loi, la commune de Chanaz a déposé une déclaration, qui a donné lieu, le 14 mars 2006, à un récépissé du préfet de la Savoie ; que la construction des chalets lacustres est soumise à la législation distincte de l'urbanisme ; qu'ainsi, en l'absence de toute scission artificielle d'un projet qui serait en réalité indivisible, le moyen doit être écarté »
CAA. Nancy, 14 mars 2011, Sté ACACIO Promotions, req. n°09NC01584
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE ACACIO PROMOTIONS a obtenu, le 2 mars 2006, un permis de construire un ensemble pavillonnaire de 19 maisons individuelles, qui a été modifié le 19 avril 2006 compte tenu de la réduction du projet initial à 17 maisons individuelles ; que le respect des prescriptions de l'article I NA 12 du règlement du plan d'occupation des sols précitées nécessitait que le projet modifié comprenne 47 places ; qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire produit par la commune dans le cadre du supplément d'instruction ordonné le 9 décembre 2010, et plus particulièrement des plans de ce dossier, que chaque lot comprend un garage et une place de stationnement extérieur, soit 34 emplacements, auxquels il faut ajouter 4 emplacements supplémentaires, soit 38 places au total ; que ces plans ne permettent pas de tenir pour établie l'allégation du pétitionnaire selon laquelle chaque lot comprendrait deux emplacements extérieurs alors même que le formulaire CERFA établi à l'occasion de la demande initiale de permis de construire indiquait 19 garages et 43 emplacements extérieurs ; que, par suite, le dossier de la demande de permis de construire soumis au service instructeur ne permettant pas d'identifier les 47 emplacements nécessaires, la SOCIETE ACACIO PROMOTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés en date du 2 mars et 19 avril 2006 par lesquels le maire d'Hettange-Grande lui a délivré un permis de construire en vue d'édifier un ensemble de 17 maisons individuelles à raison de la méconnaissance de l'article I NA 12 du règlement du plan d'occupation des sols »
CONTRIBUTIONS, PARTICIPATIONS & FISCALITE DE L’URBANISME
CE. 27 avril 2011, SCI Archanciel, req. n°320.207
« Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : / 1°) De plein droit : / a) Dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; / b) Dans les communes de la région de l'Ile-de-France (...) / 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes (...) ; qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. / Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles (...) ; qu'en vertu de l'article 1599 B du même code, dans sa rédaction applicable, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement ; qu'aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme relatif à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, dans sa rédaction applicable : (...) La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement (...) ; qu'aux termes de l'article 317 septies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable : Est prise en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement la surface hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction (...) ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe locale d'équipement et les autres taxes locales ou nationales d'urbanisme dont l'assiette est identique sont dues à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doit être regardée comme un agrandissement une opération conduisant à une augmentation de la surface hors oeuvre nette ; qu'ainsi l'aménagement de locaux existants, autorisé au titre d'un changement de destination, ne constitue pas, par lui-même, un agrandissement dès lors qu'il n'emporte aucune augmentation de la surface hors oeuvre nette »
CONTENTIEUX DES AUTORISATIONS
CE. 5 mai 2011, Ministre de l’écologie, req. n°336.893
« Considérant que sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ; que les dispositions précitées du code de l'urbanisme, qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d'un tiers, par l'autorité qui l'a délivrée, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, d'une part, à ce que le représentant de l'Etat puisse former un recours gracieux, jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, et d'autre part à ce que le cours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux ; que d'ailleurs, alors même que le délai de trois mois fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme serait arrivé à son terme, un tel recours n'est pas dépourvu d'utilité, soit que l'auteur de l'acte litigieux justifie de la légalité de celui-ci, soit que son bénéficiaire sollicite son retrait au profit d'une nouvelle décision légalement prise »
CE. 27 avril 2011, SARL FLASH BACK, req. n°342.329
« Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. / (...) Chaque cession est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession. / (...) Le silence de la commune pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que la SARL FLASH BACK, qui avait informé la commune de Gennevilliers de son intention de céder à la SARL LB PRESTATIONS DE SERVICES le droit au bail commercial dont elle était titulaire, et qui s'était vu notifier le 1er juin 2010 une décision par laquelle la commune renonçait à exercer le droit de préemption qu'elle détenait sur ce bail commercial en vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, a alors cédé ce bail à la SARL LB PRESTATIONS DE SERVICES avant que, par une seconde décision du 2 juillet 2010 prise dans ce même délai de deux mois, la commune de Gennevilliers ne décide d'exercer son droit de préemption sur le bail commercial en cause ; qu'en estimant que la SARL LB PRESTATIONS DE SERVICES et la SARL FLASH BACK ne pouvaient utilement se prévaloir de la passation de l'acte de cession pour justifier l'urgence de leur demande de suspension de la seconde décision du 2 juillet 2010, au motif que cet acte de cession était intervenu de leur seul fait avant l'expiration du délai de préemption de deux mois, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée »
CAA. Marseille, 14 avril 2011, Cne de Cogolin, req. n°09MA01964
« Considérant, en revanche, que le règlement du plan d'occupation des sols autorise la construction des bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole ; que, par un arrêté du 23 janvier 2002, un permis de construire a été délivré à M. Roque A pour la construction d'un hangar agricole développant une surface hors oeuvre brute de 360 m² sur les parcelles AY 55,56,58 et 65 ; que les travaux exécutés n'étant pas conformes aux plans annexés à la demande de permis de construire, M. Roque A a été invité par les services de la COMMUNE DE COGOLIN à déposer une nouvelle demande ; que, le maire de la COMMUNE DE COGOLIN ne démontre pas que le logement des récoltes et du matériel agricole de M. Roque A ne nécessiterait pas la construction, sur les mêmes parcelles, d'un hangar développant une surface hors oeuvre brute de 680 m² ;
Considérant que les dispositions du permis de construire en cause, qui refuse à la fois, les constructions séparées d'un hangar et d'une maison d'habitation, présentent un caractère divisible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, eu égard au caractère divisible de ses dispositions, que la COMMUNE DE COGOLIN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 22 novembre 2004 en tant qu'elle refuse la construction d'un hangar agricole »
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés