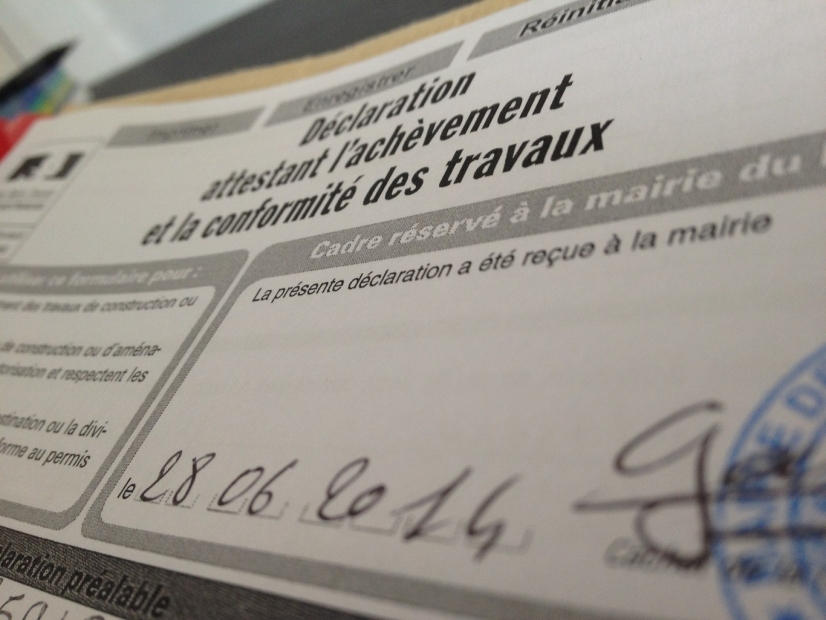Veille jurisprudentielle n°38 : quatorze décisions signalées

INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :
CAA. Bordeaux, 30 juin 2011, Préfet de la Réunion, req. n°10BX02243« Considérant qu'aux termes de l'article NC 1.2 du règlement dudit plan d'occupation des sols : Sont admis : 1. Les installations classées et ouvrages techniques liés à l'activité agricole de la zone (...) ; que l'article NC 1.3 dispose que Sont admis sous condition : (...) 3. Les annexes agricoles liées aux besoins d'une exploitation agricole : hangars, bâtiments d'élevage, séchoirs, serres, réservoirs d'eau, ateliers de réparation de matériel agricole (...) En secteur NCpf, l'implantation ou l'extension des installations techniques liées et nécessaires à l'exercice de l'activité agricole est permise sous réserve que la localisation et l'aspect de ces installations ne dénaturent pas le caractère des sites et des paysages et que la localisation dans ces espaces soit rendue indispensable par des nécessités techniques impératives ; que l'article L. 311-1 du code rural alors en vigueur précise que : sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de la SARL DES-A-MO-RA, qui consiste à acheter de la paille de canne à sucre auprès d'exploitants agricoles pour la revendre auprès d'éleveurs après séchage, est une activité commerciale ; que le hangar dont la construction a été autorisée par le permis litigieux est destiné à permettre le séchage de la paille ; qu'une telle activité ne s'inscrit pas dans un cycle biologique végétal, la paille ne constituant pas un organisme vivant ; que le processus de séchage n'est pas mis en oeuvre par un exploitant agricole ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le hangar autorisé par le permis litigieux ne saurait être regardé comme une annexe agricole liée aux besoins d'une activité agricole au sens des dispositions précitées de l'article NC 1.3 du règlement du plan d'occupation des sols »
CAA. Lyon, 28 juin 2011, Sté ABAOS, req. n°09LY02619
« Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB5 du règlement du plan d'occupation des sols : Caractéristiques des terrains : / le minimum de surface est fixé à 1800 m² (dans le cas de lotissement, ce minimum s'applique à la surface privative de chaque lot). / Dispositions générales : / Ces minima peuvent ne pas être exigés : /- pour les constructions à usage d'annexes dont la limite d'emprise au sol est inférieure à 40m². / - pour les constructions à usage d'équipement collectif et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics. / - pour les aménagements, extensions et reconstructions de bâtiments existants. / Toute partie détachée d'un terrain qui a déjà été pris en compte pour la détermination des surfaces minimales définies ci-dessus ou qui constitue autour d'une construction existante une surface au moins égale à la surface minimale définie ci-dessus, deviendra inconstructible et ne pourra constituer en tout ou partie une nouvelle surface minimale constructible. ;
Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette de la construction projetée a une superficie de 2500 m² et qu'une habitation est déjà édifiée sur le terrain ; qu'il résulte des termes de l'article Ub5 précité, que cette construction existante sur le terrain d'assiette du projet doit être réputée comme ayant déjà été prise en compte pour la détermination de la surface minimale requise, nonobstant la circonstance que cette partie de terrain n'a pas fait l'objet d'une division foncière formellement constatée ; qu'après déduction, de la surface de 1800 m2 déjà prise en compte pour la construction existante, le minimum de surface requis n'est plus atteint pour le projet de M. et Mme A d'édification d'une maison individuelle ; qu'ainsi, le permis de construire délivré méconnaît les dispositions susmentionnées de l'article Ub5 du règlement du POS »
CAA. Versailles, 23 juin 2011, Jean A…, req. n°10VE01466
« Considérant, d'autre part, que l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit le remplacement des arbres abattus en vue de la réalisation des projets de construction ; que le terrain dont s'agit comporte une partie classée en zone UG et une autre partie classée en zone ND ; que M. A fait valoir qu'ayant dû abattre deux arbres situés en zone UG, il aurait satisfait à la condition fixée par l'article précité en plantant plusieurs arbres de haute tige dans la partie de sa parcelle située en zone ND ; que, cependant, les dispositions précitées de l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols ne prévoyant pas la possibilité de compenser, sur une même unité foncière, les abattages réalisés dans cette zone par des plantations réalisées dans une autre, les premiers juges étaient fondés à estimer qu'à défaut de plantation de deux arbres de haute tige dans la partie du terrain classée en zone UG, les dispositions de cet article ont été méconnues »
PLU/POS :
CAA. Nantes, 29 avril 2011, CU Nantes Métropole, req. n°10NT02555
« Considérant que pour prononcer, à la demande de M. X, l'annulation de la délibération du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de La Chapelle-sur-Erdre, en tant qu'elle fixe, pour les parcelles cadastrées section AN n°s 511 et 513, l'obligation de construire un minimum de 3 200 m² de surface hors oeuvre nette et de quarante-trois logements, dont 800 m² de surface hors oeuvre nette consacrés à la réalisation de onze logements sociaux, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que, s'il appartenait aux auteurs du PLU, en vertu des dispositions de l'article L. 123-2 b) du code de l'urbanisme, de réserver des emplacements destinés à la réalisation de programmes de logements permettant de développer l'offre locative sociale dans les quartiers déficitaires, et de fixer, pour ces programmes de logements, la part de la surface hors oeuvre nette devant être affectée à la réalisation de logements à caractère social, cette habilitation législative, nécessaire dès lors que l'institution d'emplacements réservés est de nature à porter atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit de construire, ne permettait toutefois pas aux auteurs du PLU d'édicter, en outre, des prescriptions ayant pour objet ou pour effet d'imposer aux propriétaires, en cas de réalisation d'une construction, une surface hors oeuvre nette minimale à construire, ainsi qu'un nombre minimum de logements à réaliser ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de sursis à exécution, la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE fait valoir que les dispositions du b) de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme ne prévoient nullement que les auteurs du PLU ne pourraient fixer qu'un pourcentage de surface hors oeuvre nette affecté au logement social ; que ces dispositions permettent de définir les programmes en nombre, taille et typologie de logements au regard d'une surface hors oeuvre nette déterminée, dès lors que les emplacements réservés en cause ouvrent aux propriétaires un droit de délaissement, conformément aux dispositions de l'article L. 230-1 du code de l'urbanisme, qui constitue une garantie du respect du droit de propriété ; que la définition de la nature des programmes, prévue par l'article R. 123-12 du code précité, et l'obligation faite aux auteurs du PLU de respecter, en application des articles L. 123-17 et L. 230-1 dudit code, les objectifs, quantifiés par commune, tels que définis dans le programme local de l'habitat (PLH) impliquent nécessairement qu'un nombre de logements soit déterminé à l'avance, sauf à faire obstacle à la mise en oeuvre des objectifs de mixité sociale ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué du 12 octobre 2010, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement ; qu'il suit de là que les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement du 12 octobre 2010 doivent être rejetées »
ESPACES BOISES CLASSES :
CAA. Bordeaux, 30 juin 2011, Cne de Merignac, req. n°10BX03047
« Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du litige : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ; que pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur la base de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; que, par suite, le maire de Mérignac, n'était pas tenu de rejeter la demande de permis de construire de Mme A du seul fait que les travaux étaient situés dans un espace boisé classé par le plan local d'urbanisme de la commune de Mérignac, sans rechercher si la construction ou les travaux projetés pour sa réalisation compromettaient la conservation ou la protection de cet espace boisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse de la demande de permis de construire que les constructions projetées par Mme A se trouvent dans la partie non boisée de sa parcelle classée en espace boisé classé, alors qu'il n'est établi ni que les travaux de construction entraîneraient l'abattage d'arbres ni que l'enfouissement des canalisations nécessité par la réalisation des réseaux porterait atteinte à l'espace boisé classé ; que les chemins piétonniers n'empiètent que de façon limitée sur la partie boisée et ne sont pas de nature à compromettre la conservation ou la protection d'un boisement au sens de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, compte tenu des constructions déjà réalisées dans les zones de la commune classées en espace boisé classé ; que, par suite, le maire de Mérignac, ne pouvait pas pour ce motif refuser légalement de délivrer le permis de construire sollicité »
DROIT DE PREEMPTION :
CAA. Bordeaux, 13 juillet 2011, Pascal A…, req. n°11BX00271
« Considérant que l'arrêté du 18 février 2008 par lequel le maire de Saint-Agnant a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée section AA n°244 d'une superficie de 4 445 mètres carrés indique notamment que la préemption est exercée en vue de l'aménagement d'un parc de stationnement devant desservir le cimetière et une place communale et ajoute qu'un chemin piétonnier doit joindre cette parcelle au lotissement privé Les Cigognes afin de favoriser l'accès de ses habitants aux commerces et services publics du centre du bourg ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces aménagements s'inscrivent dans une politique locale ou auraient pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain déjà défini, alors même que lesdits projets sont mentionnés dans une délibération du conseil municipal, également dépourvue de précisions, prise six jours avant l'arrêté litigieux ; que l'arrêté n'indique pas davantage en quoi les besoins, particulièrement en matière de stationnement, ne pouvaient être satisfaits par les moyens dont disposait déjà la commune, alors que de plus le conseil municipal de Saint-Agnant avait décidé de renoncer, par une délibération du 4 mars 2004, à exercer son droit de préemption sur trois parcelles voisines de celle faisant l'objet de la préemption contestée, cadastrées section AA n°214, 41 et 42 représentant une surface totale de 2 249 mètres carrés en vue de permettre la création d'équipements publics collectifs et l'installation des services techniques municipaux ainsi que de développer les activités commerciales en face du cimetière municipal et à proximité immédiate d'un lotissement de neuf logements ; que par suite, l'arrêté du 18 février 2008 méconnaît l'exigence posée par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, relative à la justification, à la date d'exercice du droit de préemption, de l'existence d'un projet suffisamment précis et certain et est, pour ce motif, illégal »
LOTISSEMENT & DIVISIONS FONCIERES :
CAA. Marseille, 27 juin 2011, Cne de Roquebrune, req. n°11MA01272
« Considérant qu'en l'état de l'instruction, l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2010 par lequel le maire de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS a autorisé la division préalable du terrain d'assiette en cinq lots est toujours suspendue, le juge des référés du Conseil d'Etat n'ayant pas statué sur le pourvoi de la commune et le tribunal administratif de Toulon n'ayant pas statué sur la demande d'annulation présentée par le préfet du Var ;
Considérant en l'espèce que le permis de construire a été délivré dans le cadre d'une opération de lotissement ; que la division préalable, nécessaire à la délivrance du permis de construire, étant toujours suspendue, elle ne peut servir de fondement légal à des autorisations de construire qui seraient délivrées sur les lots, objets de la division »
CAA. Marseille, 16 juin 2011, Raymond A…, req. n°09MA00152
« Considérant, d'une part, que la demande de permis présentée par M. D, qui contrairement à ce qu'il est soutenu mentionnait que le terrain d'assiette provenait de la division d'une propriété bâtie, doit entrainer à l'issue de la construction la division du terrain d'assiette du projet en deux lots, soit un lot n° 1 de 2922 m2 destiné à l'implantation de l'immeuble A et un lot n° 2 de 4688 m2 destiné à accueillir les immeubles B et C ; que si ce terrain d'assiette doit être lui-même détaché d'une parcelle plus grande, cette opération n'est toutefois pas constitutive d'un lotissement, dont l'autorisation aurait dû être jointe à la demande de permis, dès lors, que d'une part, il est constant que les bâtiments de l'école de la Croix Rouge sont achevés depuis plus de dix ans et que l'ampleur des travaux d'extension de cette école, autorisés par un permis de construire délivré le 28 avril 2006 et qui portent, selon les indications données au dossier, sur la création d'une bibliothèque, d'une salle informatique et l'extension du réfectoire ne permet pas de les assimiler à une opération d'implantation d'un bâtiment au sens du code de l'urbanisme pour l'application de la réglementation des lotissements ; que d'autre part, et en tout état de cause, la division en deux lots de la parcelle d'assiette autorisée par le permis en litige ne doit, conformément à la lettre même de l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme alors applicable, n'intervenir qu'à l'issue de l'opération de construction ; que l'opération objet du permis de construire ne devait donc pas être précédée d'une autorisation de lotir »
AUTORISATIONS D’URBANISME :
CE. 13 juillet 2011, SARL Lobe Beach, req. n°320.448
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 11 mars 2003 à la SARL LOVE BEACH en vue de l'installation d'un restaurant de plage prévoit que l'autorisation a été accordée à titre saisonnier pour une période allant du 1er juin au 30 septembre 2003 ; que l'article 3 de ce permis précise qu'après cette période, la construction devra être démontée, qu'un nouveau permis ne sera pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction mais que, en revanche, le permis de construire deviendra caduc si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation ; qu'il ressort des mêmes pièces que le permis litigieux portait sur l'ensemble des différents éléments constitutifs de la structure abritant le restaurant, notamment les murs et la toiture ; qu'ainsi, certains éléments du restaurant dépassaient le seuil de 0,60 mètre fixé par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance, à la supposer établie, que le support de la construction, qui est qualifié de terrasse démontable par le projet déposé par la société dans le cadre de sa demande de permis de construire, ne comportait pas, une fois démonté le reste de la structure, d'éléments dépassant le seuil de 0,60 mètre ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas contesté que la société titulaire du permis n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite de démonter la terrasse à l'issue des périodes de validité de l'autorisation accordée, les appelants sont fondés à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit en refusant de constater que le permis de construire dont se prévalait la SARL LOVE BEACH était devenu caduc »
CE. 13 juillet 2011, Cne de Beuvillers, req. n°325.263
« Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, sur le fondement de l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme cité ci-dessus, la direction départementale de l'équipement de Meurthe-et-Moselle s'est vu confier l'instruction de la demande de permis de construire présentée au maire de Beuvillers par Mme A le 22 mars 2005 ; qu'après avoir relevé que, par lettre parvenue le 8 avril dans ce service, la pétitionnaire l'avait requis de procéder à l'instruction de sa demande, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'envoi adressé au service instructeur agissant au nom de la commune devait être regardé comme ayant été adressé à l'autorité compétente, au sens des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; qu'elle en a légalement déduit que Mme A s'était trouvée détentrice d'un permis de construire tacite à compter du 9 juin 2005 et que, dès lors, le maire de Beuvillers n'avait pu légalement procéder, le 25 juin suivant, à un classement sans suite de sa demande de permis de construire »
CAA. Marseille, 30 juin 2011, Cne d’Ales, req. n°09MA01080
« Considérant que le projet, qui prévoit 62 places de stationnement, doit prévoir, eu égard à la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule, une superficie totale de 1550 m² réservée au stationnement ; que, si le service instructeur a pris en compte l'imprimé CERFA joint à la demande et mentionnant par erreur une surface totale de 1484 m² induisant une superficie de chaque place de stationnement inférieure à celle de 25 m² exigée par l'article UB 12 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une superficie de 23 m² supplémentaires correspondant à l' entrée voiture sur le plan de masse et une autre de 70 m² en rez de chaussée correspondant au passage voiture depuis la rue vers le parking, soit au total 93 m², doivent être ajoutées aux 1484 m² déclarés dans l'imprimé CERFA ; que la COMMUNE d'ALES produit en appel un document explicatif établi par la société Tagerim, daté du 13 février 2009, qui détaille de manière très précise le calcul des aires de stationnement spécifiques à l'opération, avec la prise en compte des surfaces des aires de stationnement et des accès avec les plans de rez de chaussée et du sous sol modifiés et le tableau des surfaces ; que ce nouveau document, qui regroupe des informations figurant dans la demande de permis de construire, établit que la surface totale consacrée au stationnement, dans la demande de permis, s'élevait à 1552,06 m², dans le respect de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler le permis délivré le 6 mars 2006 à la société Tagerim, sur la méconnaissance par le projet de cet article »
CONTENTIEUX DE LA LEGALITE :
CE. 13 juillet 2011, Mme B…, req. n°314.093
« Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'introduction de la requête de Mme B le 23 mars 2007, le greffe de la cour administrative d'appel de Marseille a invité, par un courrier en date du 30 novembre 2007, le conseil de l'intéressée à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de 20 jours suivant réception de cette lettre ; que le président de la 3ème chambre de la cour a pu juger, sans dénaturation des pièces du dossier ni erreur de droit, que la fiche de suivi informatique émanant de la poste, faisant apparaître la date de distribution et comportant la mention remis contre signature du destinataire, établissait que cette lettre avait été notifiée le 3 décembre 2007 ;
Considérant, en second lieu, qu'à la date de l'ordonnance attaquée, soit le 7 janvier 2008, qui est postérieure à l'expiration du délai fixé par cette invitation à régulariser, le conseil de Mme B n'avait pas produit les copies de deux lettres de notification de son recours datées du 29 mars 2007, reçues le 2 avril 2007 par le maire de la commune des Arcs-sur-Argens et le 4 avril 2007 par M. A, titulaire du permis de construire litigieux ; que, par suite, le président de la 3ème chambre de la cour était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter comme manifestement irrecevable la requête formée par Mme B »
CE. 8 juillet 2011, Erci A…, req. n°342.113
« Considérant que la suspension d'un acte sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, comme d'ailleurs sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a pour effet d'en suspendre l'exécution à compter du jour où la partie qui doit s'y conformer reçoit notification de l'ordonnance du juge des référés ou, si le juge des référés en a décidé ainsi, dès que cette ordonnance a été rendue ; qu'en outre, si les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sont remplies, l'exécution de l'acte est suspendue dès l'enregistrement de la demande de suspension au greffe du tribunal administratif ; qu'en revanche, la décision par laquelle est ordonnée la suspension d'un acte n'a pas pour effet de retirer celui-ci ou de le priver rétroactivement de ses effets, fût-ce dans l'attente du jugement au fond ; que, par suite, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en estimant que, du fait de la suspension, prononcée sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de la décision du maire de Ceyreste du 9 février 2010 faisant droit au recours gracieux du préfet des Bouches-du-Rhône, ce recours devait être regardé comme n'ayant pas fait l'objet d'une décision expresse mais seulement d'une décision implicite de rejet acquise au bout de deux mois, à compter de laquelle devait être décompté le délai de déféré ;
Considérant toutefois que lorsqu'une décision administrative fait l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux sur lequel il est statué par une décision notifiée avant l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle une décision implicite de rejet est réputée intervenir, le délai de recours contentieux court de nouveau, pour sa totalité, à compter de la notification de la décision statuant sur le recours ; qu'il en est ainsi, quel que soit le sens de cette dernière décision ; qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 9 avril 2010 au greffe du tribunal administratif de Marseille, soit avant l'expiration du délai de deux mois qui courait à compter de la décision du 9 février 2010 ; que, par suite, ce déféré n'était pas tardif, alors même que le maire de Ceyreste avait retiré l'acte litigieux à la demande du préfet ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges des référés et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'ordonnance attaquée, dont il justifie le dispositif ».
TA. Clermont-Ferrand, 22 février 2011, req. n° 1001336
Les requérants ne peuvent se prévaloir de l’absence d’ouverture au public de la voie depuis laquelle le panneau d’affichage du permis de construire contesté était visible dès lors que cette interdiction ne les concerne pas en leur qualité de propriétaires indivis de la voie.
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés