Sur la modification du cahier des charges des lotissements frappés par la caducité décennale prévue par l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme

Dès lors que cet article ne comporte aucune exception sur ce point, la procédure de modification prévue par l’article L.442-11 du Code de l’urbanisme peut être légalement mise en œuvre pour modifier le cahier des charges d’un lotissement, y compris si ce dernier est frappé de caducité sur le plan réglementaire.
CE. 7 octobre 2013, Cne de Saint-Jean de Monts, req. n°361.934
A la suite des dispositions de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme organisant la caducité des documents du lotissement sur le plan réglementaire, c’est-à-dire en substance en ce qu’ils sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme, les articles L.442-10 et L.442-11 disposent respectivement que :
- « lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable » ;
- « lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ».
Il reste que pour cesser d’être opposables sur le plan règlementaire, notamment aux autorisations d’urbanisme délivrés au sein du lotissement, certains de ces documents et des règles qu’ils fixent peuvent subsister sur le plan civil et contractuel pour ainsi demeurer opposables aux constructions devant le juge judiciaire, et au premier chef dans le cadre d’une action en démolition engagée par les colotis à l’encontre de ces dernières.
Toute la question était ainsi de savoir si alors même que ces documents ne subsistaient qu’en tant que documents contractuels opposables dans les rapports de droit privé des colotis, les procédures de droit public prévues par les articles précités restaient néanmoins applicables.
Si le Conseil d’Etat ne s’était jamais clairement prononcé sur la question – bien qu’ayant toutefois récemment jugé que :
« Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 315-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : Lorsque l'approbation d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols aura été prononcée postérieurement à une autorisation de lotissement, l'autorité compétente peut modifier tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges du lotissement, pour les mettre en concordance avec le plan d'urbanisme ou d'occupation des sols. ; que ces dispositions étaient applicables à la mise en concordance de tout document du lotissement avec le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols approuvé postérieurement ; que, toutefois, la cour administrative d'appel de Nantes ayant relevé, d'une part, ainsi qu'il a été dit, la caducité du règlement du lotissementet, d'autre part, la circonstance qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les autorités compétentes auraient décidé de faire application des dispositions de l'article L. 315-4 du code de l'urbanisme au cahier des charges du lotissement, le moyen tiré de ce que la révision du plan d'occupation des sols aurait dû suivre la procédure prévue à l'article L. 315-4 du code de l'urbanisme était inopérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la cour administrative d'appel en écartant ce moyen est lui-même inopérant » (CE. 28 octobre 2011, req. n°326.834).
et donc que le moyen en cause était inopérant (et non pas uniquement infondé en droit) non seulement parce qu’il n’apparaissait pas que la révision du POS contesté ait été entreprise sur le plan procédural au titre de l’article L.315-4 mais également en raison de la caducité du lotissement – la jurisprudence des Cours d’appel et la doctrine administrative tendaient néanmoins à répondre plus clairement par la négative ; position expliquant d’ailleurs les modifications que le projet de loi ALUR envisage d’apporter à ces deux articles.
Ainsi, et pour l’application des anciens articles L.315-3 et L.315-4 en vigueur avant le 1er octobre 2007, et dont l’économie générale et la portée sont équivalentes à celles des actuels articles L.442-10 et L.442-11 (en ce sens CE. 28 octobre 2011, req. n°326.834) il avait été jugé que les anciens articles L.315-3 et L.315-4 du Code de l’urbanisme n’étaient plus applicables « à partir du jour où les règles particulières du lotissement sont devenues caduques du fait même des dispositions précitées de l’article L.315-2-1 du même code » (CAA Nancy, 23 décembre 1993, Cne de Breves, req. n°93NC00276) ; l’Administration Centrale ayant pour sa part précisé au sujet des dispositions en vigueur depuis le 1er octobre 2007 que : « dès lors que les règles d'urbanisme contenues dans ces documents sont devenues caduques en application de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme, il n’y a plus lieu de les modifier et de faire application de l’article L.442-10 » (Rép. Min. n°41206 du 13 avril 2010, JOAN p.4245. Voir également : Rép. Min. du 17 novembre 1988, JO Sénat Q, p.1290 ; Rép. Min. n°43643 du 20 avril 2010, JOAN p.4489).
C’est donc véritable surprise que la Cour administrative d’appel de Nantes devait confirmer cette analyse au sujet de l’article L.442-11 en jugeant que :
« Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées, qu'à défaut d'une demande d'une majorité des colotis calculée selon les règles fixées par l'article L. 442-10 précité, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ; que ces règles d'urbanisme, dans cette hypothèse, ne peuvent plus être prises en compte par l'administration pour statuer sur les demandes d'autorisation d'occupation du sol mais continuent à régir les rapports des colotis entre eux ; que le maire ne peut par suite user de la faculté prévue par les dispositions de l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme pour procéder à leur modification » (CAA. 15 juin 2012, Serge X…, req. n°10NT01321).
Il reste que le Conseil d’Etat vient donc de censurer cette analyse au motif suivant :
« 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu " ; que ces dispositions ne prévoient aucune exception au pouvoir qu'elles confèrent au maire de modifier tous les documents d'un lotissement, y compris le cahier des charges, dès lors que la modification a pour objet de mettre ces documents en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 442-9 du même code que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques, en l'absence d'opposition d'une majorité qualifiée de colotis, au terme de dix années à compter de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu, mais que les stipulations du cahier des charges du lotissement continuent néanmoins à régir les rapports entre colotis ; qu'en cas de discordance entre, d'une part, le cahier des charges qui continue à régir les rapports entre colotis et, d'autre part, le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, le maire peut faire usage du pouvoir qu'il tient des dispositions de l'article L. 442-11 de modifier le cahier des charges pour le mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 novembre 2007 pris en application de l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts a modifié les cahiers des charges du lotissement de la Plage pour les mettre en concordance avec le plan d'occupation des sols ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en annulant cet arrêté, par l'arrêt attaqué du 15 juin 2012, au motif que la caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement aurait eu pour effet de priver le maire de son pouvoir de modifier les stipulations contractuelles des cahiers des charges de ce lotissement, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ».
La caducité réglementaire des documents du lotissement au regard de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme ne s’oppose donc pas en elle-même à ce que le Maire modifie ces documents, y compris pour le cahier des charges, par la procédure prévue à l’article L.442-11.
Cela étant, cet arrêté génère plusieurs interrogations.
Tout d’abord, la solution ainsi dégagée n’est pas spécifiquement motivée par la particularité de l’article L.442-11 du Code de l’urbanisme mais par le simple fait que « les dispositions de ce dernier ne prévoient aucune exception au pouvoir qu'elles confèrent au maire de modifier tous les documents d'un lotissement, y compris le cahier des charges, dès lors que la modification a pour objet de mettre ces documents en concordance ».
Dans cette mesure, cette solution apparait à cet égard transposable à la procédure prévue par l’actuel article L.442-10 qui lui-même vise « tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement » et ne comporte également aucune exception à la compétence qu’il confère au Maire dès lors que « cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable ».
D’ailleurs, dès lors que l’arrêt commenté ce jour n’est pas spécifiquement et expressément motivé par le particularisme de la procédure prévue par l’article L.442-11 mais par le simple fait que ce dernier ne comporte aucune exception, force est d’admettre à ce stade qu’il serait à cet égard quelque peu « incohérent » que :
- de ce simple fait le Maire puisse spontanément et unilatéralement mettre en œuvre cette procédure n’impliquant aucune demande, ni aucune acceptation des colotis, pour modifier les documents d’un lotissement ne subsistant plus que sur le plan contractuel ;
- mais en revanche, et alors même que l’article L.442-10 ne comporte pas plus d’exception, le Maire ne puisse pas procéder à cette modification aux mêmes fins alors qu’elle serait demandée par la « majorité qualifiée » des colotis.
dès lors qu’en toute hypothèse, l’une comme l’autre ne doivent pas poursuivre un but contraire à l’intérêt général.
Ensuite, comme le précise le Conseil d’Etat, si la procédure prévue par l’article L.442-11 peut être mise en œuvre à l’égard notamment du cahier des charges c’est « dès lors que modification a pour objet de mettre ces documents en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ».
Il est donc nécessaire que les prescriptions du PLU et les stipulations du cahier des charges soient donc « discordantes », ce qui impliquent donc en substance qu’elles aient le même objet.
A priori, si cette procédure peut donc bien viser le cahier des charges, elle n’en semble pas pourtant applicable aux stipulations de pur droit privé, étrangères aux préoccupations d’urbanisme et aux prescriptions règlementaires d’un PLU.
Mais enfin, c’est bien évidemment la portée de cet arrêt sur le contentieux civil ne relevant pas du Conseil d’Etat mais de la Cour de cassation qui génère les principales interrogations puisque selon cette dernière, ou du moins sa troisième chambre, la modification d’un cahier des charges comme d’un règlement d’ailleurs ne subsistant plus qu’en tant que document à caractère contractuel requiert (sauf stipulation contraire du document en cause) l’unanimité des colotis :
« Attendu que recherchant la commune intention des parties au vu de l'acte de partage du 12 avril 1983, de l'acte du 21 juin 2001 par lequel les attributaires avaient cédé gratuitement à l'association syndicale libre (ASL) leurs parts indivises sur les parties communes dont faisait partie la parcelle A 420 dite zone de verdure et du fait qu'il avait été estimé nécessaire de demander à l'ensemble des colotis l'autorisation de changer l'affectation des terrains à usage d'espace vert en terrain à bâtir, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu, sans se contredire et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la modification des bases statutaires de la répartition des dépenses de l'ASL, qu'il résultait du cahier des charges que celui-ci avait conféré un caractère contractuel aux dispositions du règlement relatives à l'affectation des parcelles à l'usage d'espace vert auxquelles il se référait et en a exactement déduit, sans violer l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme [actuel L.442-10] que ce cahier des charges ne pouvait être modifié par la seule décision de l'assemblée générale des colotis qu'à l'unanimité » (Civ. 3ème, 16 décembre 2008, Mme Barla, req. n°07-14.307).
Cela étant, la question n’est pas de déterminer la majorité contractuelle requise en l’absence de toute autre procédure mise en œuvre par l’autorité administrative compétente mais d’apprécier la portée sur ce contrat de l’arrêté effectivement et légalement adopté au titre de l’article L.442-11 (ou selon nous L.442-10) du Code de l’urbanisme. Or, sur ce point, la Cour de cassation ou plus précisément sa première chambre a récemment jugé que :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le cahier des charges du lotissement sis sur la parcelle cadastrée section C n° 847 à Montpellier, approuvé par arrêté préfectoral du 26 juillet 1955, prévoyait en son article 8, alinéa 3, qu'il ne pourrait être procédé à la division de l'un des lots, que ces dispositions ont été supprimées par arrêté municipal du 22 avril 2005 et que les époux X... ont, suivant acte de donation-partage du 14 décembre 2005, subdivisé en deux lots le lot n° 4 dont ils sont propriétaires ; que M. Y..., coloti, a agi en nullité de l'acte authentique du 9 décembre 2005 constatant la modification du cahier des charges, ainsi que de l'acte de donation-partage en ses dispositions relatives à la subdivision ;
Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt, après avoir énoncé que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité du contrat modificatif du 9 décembre 2005 et la question de savoir si les dispositions du cahier des charges initial ont été violées, retient que la nature contractuelle de la clause litigieuse imposait que sa modification, qui ne relevait pas de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme, procédât de la décision unanime des lotis ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'arrêté municipal du 22 avril 2005, qui, sous réserve d'une difficulté sérieuse justifiant une question préjudicielle relative à sa légalité, s'imposait à elle quant à son objet, avait accordé cette modification en application de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass. civ., 19 février 2013, req. n°12-10.277).
Ainsi, dès lors que le Conseil d’Etat a validé la légalité de principe des arrêtés pris sur le fondement de l’article L.442-11 (et à notre sens de l’article L.442-10) du Code de l’urbanisme, la modification effective du cahier des charges résultant d’un tel arrêt lorsqu’il est effectivement adopté semble devoir s’imposer aux colotis comme au juge judiciaire.
En résumé sur ce point, ce n’est donc qu’à défaut de mise en œuvre de ces procédures de droit public que la modification des stipulations du cahier des charges d’un lotissement pourtant frappé de caducité réglementaire requiert l’accord de tous les cocontractants et, plus précisément, l’unanimité des colotis, laquelle s’en trouve finalement subsidiaire ; ce qui à cet égard est en fait plus problématique dans le cas de la procédure prévue par l’article L.442-10 du Code de l’urbanisme dans la mesure où c’est seulement la modification en résultant qui doit elle-même être compatible avec le PLU, ce qui n’impose pas en soi qu’en amont, les stipulations à modifier soient incompatibles avec ce PLU, ni par voie de conséquence que leur modification résulte d’une pure préoccupation d’urbanisme.
Mais puisque l’article L.442-10 ne comporte pas plus d’exception que l’article L.422-11 sur ce point...
Pour conclure, reste bien entendu à mettre cet arrêt en perspective avec les modifications que le projet de loi « ALUR » tend à apporter aux articles L.442-9 (al.1), L.442-10 et L.442-11 qui, à s’en tenir au projet adopté en première lecture à l’Assemblée, devraient disposer :
- « les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu »;
- « lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable » ;
- « lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges qu’il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles du document d’urbanisme ».
Il s’ensuivrait donc que l’article L.422-10 pourrait être mis en œuvre à l’égard du cahier des charges dès lors qu’il aura été approuvé et que, si tel n’est pas le cas, cette procédure sera restreinte à ses seules clauses de nature règlementaire ; précision que n’apporte donc pas cet article lorsque ce document a été approuvé.
En revanche, l’article L.442-11 pourrait pour sa part être mis en œuvre sans distinction à l’égard du cahier des charges, qu’il ait été approuvé ou non, et quel que soit la nature des clauses en cause, si ce n’est que cette procédure devra encore tendre à la mise en concordance de ce document avec le PLU ; ce qui évidemment posera la question de l’applicabilité de cette procédure à l’égard des stipulations de nature purement contractuelle dont on voit mal comment elle pourrait être discordante avec le PLU compte tenu de l’objet des prescriptions de ce document d’urbanisme.
Pas si sûr que l’on y voit plus clair…
Reste un point plus « subtil » : puisque les articles L.442-10 et en toute hypothèse L.442-11 s’appliquent y compris lorsque le lotissement est caduc sur le plan règlementaire, faut-il en déduire que, même dans cette hypothèse, le contrôle des subdivisions subsiste au regard de l’article R.442-21 qui précise que « les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 » ? (JML ? :))
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés

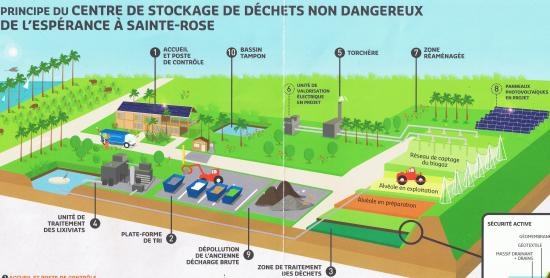
 Ce permis d’aménager devait toutefois être contesté ; les communes requérantes soutenant notamment que le projet aurait du donner lieu dans son ensemble à un permis de construire comme le permettait l’article R.421-19 k) du Code de l’urbanisme dont on rappellera qu’il soumet à permis d’aménager « à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ». Mais ce moyen devait donc être rejeté par le Tribunal administratif d’Orléans au motif suivant :
Ce permis d’aménager devait toutefois être contesté ; les communes requérantes soutenant notamment que le projet aurait du donner lieu dans son ensemble à un permis de construire comme le permettait l’article R.421-19 k) du Code de l’urbanisme dont on rappellera qu’il soumet à permis d’aménager « à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ». Mais ce moyen devait donc être rejeté par le Tribunal administratif d’Orléans au motif suivant :